Par Alain Bagnoud
Le texte ci-dessous a été écrit pour la Maison de Rousseau et de la littérature (40, Grand-Rue, Genève), où il a été lu le samedi 17 mars dans le cadre de la manifestation Rousseau et moi, lectures de textes inédits d’écrivains romands, avec la saxophoniste Juliane Rickenmann. Il est publié dans le journal littéraire Le Persil en compagnie des textes d'autres auteurs romands (Anne Brécart, Benoît Damon, Yves Laplace, Catherine Lovey, Guy Poitry, Daniel de Roulet, Marie-Jeanne Urech, Dominique Ziegler, Pierre Chappuis, Claude Darbellay, Claire Genoux, Michel Layaz, Amélie Plume, Thomas Sandoz, Pierre Voélin, Alexandre Voisard). Journal en vente dans tous les bons lieux (10 francs).
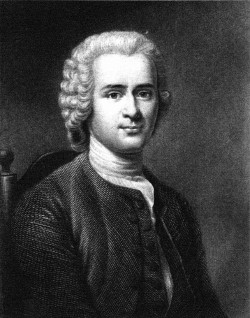 Je crois en l’amitié. Jean-Jacques Rousseau aussi y a cru. Ce qu’il pensait d’elle, c’est qu’elle devait être un réservoir de vertus. Quel choc alors, quand il a constaté à plus de quarante ans que les amis sont tracassiers parfois, cancaniers souvent, médisants, prêts à faire votre bonheur malgré vous et à vous expédier où vous n'avez nulle intention et nul goût d'aller. Qu'ils se régalent des intrigues et des commérages, trouvent leur bonheur à fabriquer les unes et propager les autres.
Je crois en l’amitié. Jean-Jacques Rousseau aussi y a cru. Ce qu’il pensait d’elle, c’est qu’elle devait être un réservoir de vertus. Quel choc alors, quand il a constaté à plus de quarante ans que les amis sont tracassiers parfois, cancaniers souvent, médisants, prêts à faire votre bonheur malgré vous et à vous expédier où vous n'avez nulle intention et nul goût d'aller. Qu'ils se régalent des intrigues et des commérages, trouvent leur bonheur à fabriquer les unes et propager les autres.
Diderot querelle Rousseau afin qu’il accepte la pension royale proposée après le Devin du village, pour le bien de Thérèse et de sa mère, dit-il. Le même Diderot indiscret, brouillon, dirigiste, se choque de voir Jean-Jacques à l'Hermitage parce qu'il aime Paris et qu'il veut que son ami l’y rejoigne, insiste pour qu’il accompagne Mme d’Epinay à Genève, donne des ordres et des conseils, se mêle de tout. Ce que Rousseau ne peut pas comprendre, c'est que dans tout ça, les amis vous considèrent comme une partie d'eux-mêmes, ce qui fait qu'ils vous traitent sans égards particuliers, qu'ils valorisent ce qui leur ressemble et veulent réformer ce qui se différencie d'eux.
Bien entendu, il y a aussi autre chose qui sépare essentiellement nos deux écrivains. Deux positions éthiques inconciliables font que chacun deviendra l’envie ou le remords de l’autre. Deux positions entre lesquelles chacun de nous doit choisir. Voilà qui m’intéresse beaucoup.
Diderot croit qu’on peut transformer les choses de l’intérieur. Jean-Jacques donne l’exemple de la vertu et refuse de se compromettre dans le monde. Il pense qu’on ne doit pas sacrifier le profit à la morale, se frotter complaisamment au pouvoir tout en faisant la révolution dans son cabinet, que l’implication sociale conduit forcément à une hypocrisie développée par les lois et les institutions, liée au développement des sciences et des arts qui « étendent des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer. »
Au départ, dans une sorte d'âge d'or indéfini, quand l’Etat n’existait pas encore, dit le Discours sur les sciences et les arts il y avait la franchise rustique, la liberté originelle, la pauvreté, la vertu. Les vraies valeurs. Amour de la liberté, de la patrie, de la religion, frugalité, simplicité. Toutes ces qualités morales qui se sont perdues. Nombreux exemples, partout dans l'histoire. Et pas besoin de philosophie pour les connaître ! Les « principes ne sont-ils pas gravés dans tous les cœurs » ?
On peut en douter, évidemment. Comme aussi de la valeur de ces valeurs. Peu importe. L’important, c’est que ce fantasme original lié à l’esprit romain et sourcilleux de Jean-Jacques, à son ignorance des accommodements, à ce refus des alternances, des complexités, des paradoxes humains, lui fournit une conception de l’Homme vertueux, majusculé, idéal. Et voir l'homme tel qu'on voudrait qu'il fût et non tel qu'il est peut amener un gouvernement qui impose aux citoyens de se plier à des règles incompatibles avec leur nature compliquée.
Il y a dans la quatrième partie de la Nouvelle Héloïse un projet de codification de la société idéale. A Clarens, l'organisation de la domesticité, de ses loisirs clos, oblige à la vertu, aux jeux et aux exercices dominicaux. Bien sûr, les domestiques n'y sont pas forcés, mais celui qui s'en va seul, échappant au groupe, se fait remarquer: « nous regardons ce goût de licence comme un indice très suspect, et nous ne tardons pas à nous défaire de ceux qui l'ont. » Nous défaire de ceux qui l’ont.
Scène des vendanges. Le soir, tout le monde se rassemble, possédants, ouvriers, dans une salle où « la douce égalité [...] rétablit l'ordre de la nature » « chacun se lève indifféremment pour servir, sans exclusion, sans préférence » Mais: « la présence de maîtres si respectés contient tout le monde. » D'ailleurs, bien entendu: « s'il arrive à quelqu'un de s'oublier, [...] il est congédié sans rémission dès le lendemain. »
Ces maîtres très malins se préservent d'avance de la révolution: « pour prévenir l'envie et les regrets, on tâche de ne rien étaler aux yeux de ces bonnes gens qu'ils ne puissent retrouver chez eux... »
Plus loin, on trouve une description des héros du travail: on teille du chanvre, sépare la filasse de l'écorce, la chenevotte, qu'on ramasse en tas pour y mettre le feu. « Mais n’a pas cet honneur qui veut; Julie l'adjuge en présentant le flambeau à celui ou celle qui a fait ce soir-là le plus d'ouvrage [...]. L'auguste cérémonie est accompagnée d'acclamations et de battements de mains. ».
Donc, proclamation d'égalité alors que les maîtres dirigent en cachant leurs privilèges, et célébration des héros du travail stakhanovistes.
Mais plutôt que remâcher quelques agacements, pourquoi ne pas me remettre aux Confessions. Son premier mot. Je. « Je forme une entreprise... » Dans cette phrase à structure binaire (deux époques, deux pronoms relatifs, doublet négatif), il y a ce je central, placé entre le passé et le futur, poursuivi et désirant. Un je qui veut montrer « la vérité de la nature », ce qui est-delà des apparences, plus vrai qu'elles.
« Moi seul », dit-il. Moi seul est unique, moi seul va se retracer tel qu’il est, avec ses différences, ses écarts, mais de cette manière, il va révéler quelque chose à ses semblables. Oui, c’est ainsi que Rousseau appelle les autres. Ses semblables. Ils sont uniques eux aussi, une identité non identique, mais nul n'est meilleur ni pire que Jean-Jacques, que chacun, que tous, que moi. A l’intérieur, il y a la grande fraternité humaine du composite, un peu de bon, un peu de mauvais, des élans, des chutes, à l’extérieur le poids des circonstances.
On est bien loin de l’homme idéal, vertueux, originel. On est dans un projet d'artiste d’un nouveau genre, qui transformera la littérature. Une subjectivité face au monde. Et une ambition énorme. Arriver devant la trompette du jugement dernier avec un livre à la main. Ça va devenir le rêve de tout écrivain. Un livre qui justifie toute une existence. Chateaubriand, cet héritier direct, se demande s’il l’a réussi quand il trace les derniers mots des Mémoires d'outre tombe, le 16 novembre 1841 à six heures du matin alors que la lune « pâle et élargie » se couche. « Maintenant, je peux mourir », dit Marcel Proust à Céleste Albaret au début du printemps 1922, après qu’il lui a annoncé avoir écrit le mot Fin au bas d’une page.
Mais bien entendu, il y a toujours des choses à dicter, à compléter, à refaire. Le livre n'est jamais fini.
Rousseau n'a pas terminé le sien. L'objectif était trop ambitieux. Le livre monumental qu'on apporte au jugement dernier mais, c’est le problème, c’est l’aubaine, qu’on ne peut s’empêcher aussi de dérouter pour son propre plaisir de conteur.
« Je sais bien que le lecteur n’a pas grand besoin de savoir tout cela », écrit Rousseau à la page 46 de l’édition du Livre de poche, « mais j’ai besoin, moi, de le lui dire. Que n’osé-je lui raconter de même toutes les petites anecdotes de cet heureux âge, qui me font encore tressaillir d’aise quand je me les rappelle! Cinq ou six surtout... Composons. Je vous fais grâce des cinq; mais j’en veux une, une seule, pourvu qu’on me la laisse conter le plus longuement qu’il me sera possible, pour prolonger mon plaisir. »
Son plaisir. Et le nôtre.




 — En tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, je pense que j'appartiens au monde. Je pense aussi qu'un banquier de Genève ou un pêcheur de l'Inde sont animés par les mêmes sentiments : l'amour, la joie, la tristesse, le désir… J'écris sur des choses universelles et je me suis toujours refusé à faire la chronique de l'immédiat. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme dans ses manifestations, toutes ses manifestations, et je peux rencontrer n'importe où un personnage qui fascine, que ce soit en Inde ou en Afrique, dans mon village ou à Genève.
— En tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, je pense que j'appartiens au monde. Je pense aussi qu'un banquier de Genève ou un pêcheur de l'Inde sont animés par les mêmes sentiments : l'amour, la joie, la tristesse, le désir… J'écris sur des choses universelles et je me suis toujours refusé à faire la chronique de l'immédiat. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme dans ses manifestations, toutes ses manifestations, et je peux rencontrer n'importe où un personnage qui fascine, que ce soit en Inde ou en Afrique, dans mon village ou à Genève.



 Deux anecdotes parmi des dizaines d’autres qui soulignent cette tâche monstrueuse. Pour témoigner de la tournée américaine de 1972, les Stones demandent à un journaliste (Robert Greenfield), un cinéaste (Robert Frank) et un écrivain (Truman Capote) d’inscrire la tournée dans la légende, comme Louis XIV demandait à Racine et à Boileau de fabriquer son Histoire. Le groupe (Charlie Watts et Bill Wyman se sont distancés de ces provocations infantiles) va alors s’ingénier à pratiquer l’excès systématique simplement parce qu’il a payé un écrivain pour le raconter et un cinéaste pour le filmer. Tel ce soir où Truman Capote les a rejoints au Kansas, accompagné par la sœur de Jackie Onassis, une princesse Lee Radziwill, qui partage sa chambre. Comme par hasard, une caméra a été installée dans le couloir quand Keith Richards cogne à la porte au milieu de la nuit en beuglant: «Princess Radish, come on! you old tart, there’s a party downstairs». Capote n’ouvre pas. Les autres font alors éclater des boîtes de concentré de tomates sur la porte…
Deux anecdotes parmi des dizaines d’autres qui soulignent cette tâche monstrueuse. Pour témoigner de la tournée américaine de 1972, les Stones demandent à un journaliste (Robert Greenfield), un cinéaste (Robert Frank) et un écrivain (Truman Capote) d’inscrire la tournée dans la légende, comme Louis XIV demandait à Racine et à Boileau de fabriquer son Histoire. Le groupe (Charlie Watts et Bill Wyman se sont distancés de ces provocations infantiles) va alors s’ingénier à pratiquer l’excès systématique simplement parce qu’il a payé un écrivain pour le raconter et un cinéaste pour le filmer. Tel ce soir où Truman Capote les a rejoints au Kansas, accompagné par la sœur de Jackie Onassis, une princesse Lee Radziwill, qui partage sa chambre. Comme par hasard, une caméra a été installée dans le couloir quand Keith Richards cogne à la porte au milieu de la nuit en beuglant: «Princess Radish, come on! you old tart, there’s a party downstairs». Capote n’ouvre pas. Les autres font alors éclater des boîtes de concentré de tomates sur la porte…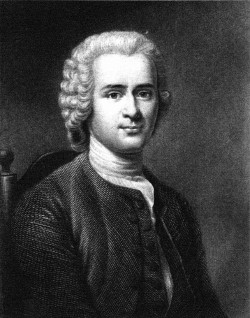 Je crois en l’amitié. Jean-Jacques Rousseau aussi y a cru. Ce qu’il pensait d’elle, c’est qu’elle devait être un réservoir de vertus. Quel choc alors, quand il a constaté à plus de quarante ans que les amis sont tracassiers parfois, cancaniers souvent, médisants, prêts à faire votre bonheur malgré vous et à vous expédier où vous n'avez nulle intention et nul goût d'aller. Qu'ils se régalent des intrigues et des commérages, trouvent leur bonheur à fabriquer les unes et propager les autres.
Je crois en l’amitié. Jean-Jacques Rousseau aussi y a cru. Ce qu’il pensait d’elle, c’est qu’elle devait être un réservoir de vertus. Quel choc alors, quand il a constaté à plus de quarante ans que les amis sont tracassiers parfois, cancaniers souvent, médisants, prêts à faire votre bonheur malgré vous et à vous expédier où vous n'avez nulle intention et nul goût d'aller. Qu'ils se régalent des intrigues et des commérages, trouvent leur bonheur à fabriquer les unes et propager les autres.
 Un autre débat, passionnant, a tourné autour de l’éducation. Les idées défendues par Rousseau dans son Émile
Un autre débat, passionnant, a tourné autour de l’éducation. Les idées défendues par Rousseau dans son Émile
 Judicieusement publiée en cette année où on célèbre le tricentenaire de la naissance de Rousseau, la biographie de Madame de Warens par Anne Noschis commence par toutes sortes de détails intéressants qui concernent la vie quotidienne à Vevey dans les premières années du XVIIIème siècle.
Judicieusement publiée en cette année où on célèbre le tricentenaire de la naissance de Rousseau, la biographie de Madame de Warens par Anne Noschis commence par toutes sortes de détails intéressants qui concernent la vie quotidienne à Vevey dans les premières années du XVIIIème siècle.
