Solal Aronowicz, Une résistance à toute épreuves, faut-il s'en réjouir pour autant? - Mais oui.
Florian Eglin avait publié en 2014 Cette malédiction qui ne tombe finalement pas si mal, roman brutal et improbable, dont on avait du bien ici. Voici que sort cette année, toujours aux Editions la Baconnière, la suite des aventures de son anti-héros. Ce nouveau volume a lui aussi un titre choc : Solal Aronowicz, Une résistance à toute épreuves, faut-il s'en réjouir pour autant? C'est l'occasion de quelques questions à l'auteur.
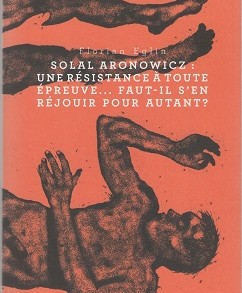 Ce volume est le deuxième d'une trilogie : comment se compose-t-elle, comme évolue-t-elle ? En d'autres termes, considères-tu les trois volumes comme les trois chapitres d'un seul texte ou se veulent-ils différents, et en quoi ?
Ce volume est le deuxième d'une trilogie : comment se compose-t-elle, comme évolue-t-elle ? En d'autres termes, considères-tu les trois volumes comme les trois chapitres d'un seul texte ou se veulent-ils différents, et en quoi ?
Florian Eglin : Lorsque je suis arrivé à la fin de mon premier livre, tout de suite, je me suis rendu compte que non seulement je voulais continuer à écrire, mais encore que je ne voulais pas quitter mon personnage. Donc, quasiment dans la foulée, avant même d'avoir achevé la relecture des épreuves du premier, je me suis mis à écrire le deuxième. Cependant, ce qui me guide, c'est plutôt le plaisir et la nécessité d'écrire, « le projet littéraire », c'est sans doute un peu pompeux de le dire comme ça, est venu ensuite. Je me suis rendu compte de la direction que les choses prenaient alors que je rédigeais la fin du volume II. Arrivé à ce stade, j'ai décidé que l'ensemble formerait une trilogie, parce que la figure de Solal le mérite, parce que j'avais besoin d'un troisième opus pour lui donner sa véritable dimension et creuser un peu plus mon propos. Bien sûr, il y a chez moi le fantasme d'écrire dix tomes en tout, j'ai d'ailleurs en tête tout un cheminement qui le conduirait, après un périple méditerranéen et indien, (Venise, Alexandrie et Bénarès) jusqu'au Japon, mais le risque de stérilité et de redites me fait reculer, et puis, après trois ans, j'ai envie d'explorer d'autres chemins de traverse. Plus techniquement, je dirais que les deux premiers volumes se répondent et sont très liés, ils forment pour ainsi dire un diptyque, le troisième sera un peu à part, tant sur la forme que sur le fond, et il clôturera le cycle de manière assez nette, ce tout en ménageant, parce que je ne peux pas m'en empêcher, certaines ambiguïtés, des ambiguïtés qui pourraient par la suite servir, on ne sait jamais !
Il y a un premier niveau de lecture délirant, dans ton texte, qui concerne les péripéties de l'histoire, mais il me semble que ton ambition soit beaucoup plus élevée, que tu aimerais que le lecteur n'oublie pas de "rompre l'os et sucer la substantifique moelle". Peux-tu dire quelques mots là-dessus ?
Florian Eglin : De mon point de vue, Solal, c'est surtout un jeu littéraire, un jeu dans le sens où le fond, la substantifique moelle dont tu parles réside dans la forme. Lorsque j'écris, mon attention va d'abord aux mots, ensuite aux phrases et à leur agencement, puis aux références dont je peux truffer mon texte. Bien sûr, j'ai constamment en tête, ou presque, l'alchimique abréviation latine VITRIOL, je fais d'ailleurs en sorte que mon personnage ait cette possibilité à portée de mains (avec l'avertissement d'Élisa ou le cadeau de la pierre à la fin), mais sans qu'il la saisisse, ce con. La surface lui suffit. Comme s'il y avait un enseignement à tirer, un enseignement que je souhaite perceptible, mais pas trop, j uste pour le lecteur. Ensuite, je dois reconnaître que si je lisse beaucoup le travail de la langue, les idées, je les laisse venir comme elles veulent, je prends ce qui monte. Par exemple, la mariée morte, c'est une ancienne terreur nocturne, je l'ai mise là, espérant m'en débarrasser, mais que faire de tout cela ? Les aventures de Solal, c'est un capharnaüm bien étrange dont certains recoins sont obscurs à moi-même et le côté maniaque de l'écriture, grammaticalement si complexe que l'ordre est parfois à la limite du compréhensible, c'est comme pour montrer que la barrière contre des forces noires et violentes à l'oeuvre sans cesse sous la surface est fragile. Des fois, j'ai l'impression qu'écrire Solal, c'est presque une tentative de soigner quelque chose chez moi.
uste pour le lecteur. Ensuite, je dois reconnaître que si je lisse beaucoup le travail de la langue, les idées, je les laisse venir comme elles veulent, je prends ce qui monte. Par exemple, la mariée morte, c'est une ancienne terreur nocturne, je l'ai mise là, espérant m'en débarrasser, mais que faire de tout cela ? Les aventures de Solal, c'est un capharnaüm bien étrange dont certains recoins sont obscurs à moi-même et le côté maniaque de l'écriture, grammaticalement si complexe que l'ordre est parfois à la limite du compréhensible, c'est comme pour montrer que la barrière contre des forces noires et violentes à l'oeuvre sans cesse sous la surface est fragile. Des fois, j'ai l'impression qu'écrire Solal, c'est presque une tentative de soigner quelque chose chez moi.
La langue que tu utilises est très soutenue (passé simple, longues phrases balancées, construites, figures), rompue par instants d'effets oraux qui provoquent la surprise et induisent du comique. L'as-tu spécialement forgée pour raconter l'histoire de Solal ? Comment t'es-t-elle venue ? Vises-tu à travers elle des effets parodiques ?
Florian Eglin : Pour l'instant, c'est la langue solalienne, ça m'est venu comme ça, les incises, les subordonnées, cet écartement maximal entre le verbe et son sujet. J'avais écrit il y a plusieurs années un premier roman, mais le style était plus classique, moins sinueux. Je trouve que c'est une manière de donner de l'épaisseur au texte, de rendre semblable à une ligne de crête qui monte et qui descend. Pour l'oralité, l'argot, j'aime la rupture, je trouve que ça convient bien au style du personnage et puis certains mots sont simplement magnifiques. C'est peut-être une façon pour moi de me libérer des contraintes de mon métier qui demande que j'enseigne de manière normative. Description, narration, dialogue, langue soutenue, vulgaire, etc. Je me rends compte que j'aime explorer l'espace de la langue, un espace sans limites au sein duquel je peux articuler, plus ou moins discrètement, ce qui a construit mon rapport à la littérature, comme la mythologie ou, plus tard, les romans de chevalerie. Alors oui, ça crée des effets comiques, par le décalage, et c'est justement un des objectifs. Je dirais que ce qui se joue avec Solal, selon moi, est très grave, mais je ne voudrais pas que ce soit pris au sérieux. Ce qui arrive à ce type n'est pas drôle, cette incapacité à mourir enfin, mais il faut en rire et les effets de langue sont là pour ça.




 Le premier roman de Julien Sansonnens, Jours adverses, décrit la vie d'un trentenaire actuel. On y retrouvera les processus, les tics, les ambiances, les non-valeurs de la société actuelle. On y repérera aussi une recherche de sens, qui saisit Sam, le personnage principal, emblématique de cette génération, et perdu dans un labyrinthe carriériste absurde. Porté par une écriture contemporaine qui joue sur les niveaux de langue, le roman fonctionne bien et sa tentative de faire le portrait critique et ample d'une génération est réussie.
Le premier roman de Julien Sansonnens, Jours adverses, décrit la vie d'un trentenaire actuel. On y retrouvera les processus, les tics, les ambiances, les non-valeurs de la société actuelle. On y repérera aussi une recherche de sens, qui saisit Sam, le personnage principal, emblématique de cette génération, et perdu dans un labyrinthe carriériste absurde. Porté par une écriture contemporaine qui joue sur les niveaux de langue, le roman fonctionne bien et sa tentative de faire le portrait critique et ample d'une génération est réussie. Deuxième partie, très différente. Sam choisit de reprendre une buvette d'alpage au Crêt-Meuron, au-dessus de Neuchâtel. C'est un nouveau départ, qui semble lui réussir. Nouvelle fiancée, contacts humains, rencontre d'un vieux militant ouvrier, ancien horloger, avec qui il parle politique, lui, un ancien du Front Révolutionnaire Internationaliste des Travailleurs Solidaires, un mouvement trotskiste, dans lequel il a d'ailleurs rencontré un certain Julien Sansonnens, dont il n'a pas gardé un très bon souvenir. « Le pire c'était encore Julien Sansonnens, dont on lisait qu'il était l’étoile montante de notre organisation : ce petit merdeux se la jouait Che Guevara alors que ses parents étaient prof, son grand-père pharmacien et son arrière-grand-père directeur de banque ! Tu te rends compte ? »
Deuxième partie, très différente. Sam choisit de reprendre une buvette d'alpage au Crêt-Meuron, au-dessus de Neuchâtel. C'est un nouveau départ, qui semble lui réussir. Nouvelle fiancée, contacts humains, rencontre d'un vieux militant ouvrier, ancien horloger, avec qui il parle politique, lui, un ancien du Front Révolutionnaire Internationaliste des Travailleurs Solidaires, un mouvement trotskiste, dans lequel il a d'ailleurs rencontré un certain Julien Sansonnens, dont il n'a pas gardé un très bon souvenir. « Le pire c'était encore Julien Sansonnens, dont on lisait qu'il était l’étoile montante de notre organisation : ce petit merdeux se la jouait Che Guevara alors que ses parents étaient prof, son grand-père pharmacien et son arrière-grand-père directeur de banque ! Tu te rends compte ? »

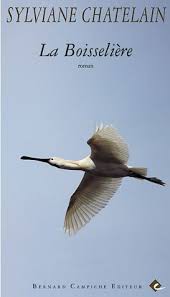 Un vieux château au cœur de la forêt, ancienne maison de retraite, perd ses pensionnaires, son personnel, sa mémoire, dans une ambiance de fin du monde. Il reste cependant pour ceux qui s'y trouvent un lieu de paix, une protection contre le monde qui l'assiège.
Un vieux château au cœur de la forêt, ancienne maison de retraite, perd ses pensionnaires, son personnel, sa mémoire, dans une ambiance de fin du monde. Il reste cependant pour ceux qui s'y trouvent un lieu de paix, une protection contre le monde qui l'assiège.