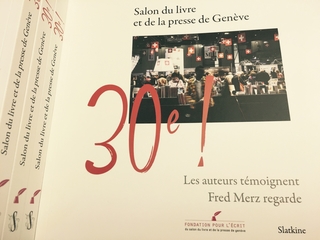Par Pierre Béguin
 La problématique migratoire qui préoccupe tant l’Union européenne, qui la secoue dans ses principes, qui l’enfonce dans ses contradictions et qui ne la laissera certainement pas indemne, me renvoie à ce passage du roman d’André Gide, Les Faux-Monnayeurs, où Laura raconte à Vincent le naufrage de La Bourgogne*:
La problématique migratoire qui préoccupe tant l’Union européenne, qui la secoue dans ses principes, qui l’enfonce dans ses contradictions et qui ne la laissera certainement pas indemne, me renvoie à ce passage du roman d’André Gide, Les Faux-Monnayeurs, où Laura raconte à Vincent le naufrage de La Bourgogne*:
«… J’avais dix-sept ans, j’étais excellente nageuse; et pour te prouver que je n’avais pas le cœur trop sec, je te dirai que, si ma première pensée a été de me sauver moi-même, ma seconde a été de sauver quelqu’un. Rien ne me dégoûte autant que ceux qui, dans ces moments-là, ne songent qu’à eux-mêmes. Il y eut un premier canot de sauvetage qu’on avait empli principalement de femmes et d’enfants. La manœuvre fut si mal faite que le canot, au lieu de poser à plat sur la mer, piqua du nez et se vida de tout son monde avant même de s’être empli d’eau (…) Je ne comprends même plus bien ce qui a pu se passer; je sais seulement que j’avais remarqué, dans le canot, une petite fille de cinq ou six ans, un amour; et tout de suite, quand j’ai vu chavirer la barque, c’est elle que j’ai résolu de sauver (…) Je me souviens seulement d’avoir nagé assez longtemps avec l’enfant cramponnée à mon cou. Elle était terrifiée et me serrait la gorge si fort que je ne pouvais plus respirer. Heureusement, on a pu nous voir du canot et nous attendre, ou ramer vers nous. Le souvenir qui est demeuré le plus vif, celui que jamais rien ne pourra effacer de mon cerveau ni de mon cœur: dans ce canot, nous étions entassés, une quarantaine, après avoir accueilli plusieurs nageurs désespérés, comme on m’avait recueilli moi-même. L’eau venait presque à ras du bord. J’étais à l’arrière et je tenais pressée contre moi la petite fille que je venais de sauver, pour la réchauffer et pour l’empêcher de voir ce que, moi, je ne pouvais pas ne pas voir: deux marins, l’un armé d’une hache et l’autre d’un couteau de cuisine; et sais-tu ce qu’ils faisaient? … Ils coupaient les doigts, les poignets de quelques nageurs qui, s’aidant des cordes, s’efforçaient de monter dans notre barque. L’un des deux marins s’est retourné vers moi qui claquais des dents de froid, d’épouvante et d’horreur: «S’il en monte un seul de plus, nous sommes tous foutus. La barque est pleine.» Il a ajouté que dans tous les naufrages on est forcé de faire comme ça; mais que naturellement on n’en parle pas…»
Bien entendu, dans l’intention d’André Gide, ce récit n’est pas à prendre au premier degré: il sert avant tout de métaphore propre à illustrer les fondements de son éthique individualiste. La barque, c’est le moi qu’une foule de sentiments délicats assaille, sentiments qui s’agrippent à la sensibilité et auxquels il convient de couper les doigts et les poignets pour les empêcher de prendre pieds et de faire sombrer le cœur. Ainsi toutefois se dessinent les prémices de l’Übermensch: «j’abomine les médiocres et ne puis aimer qu’un vainqueur» précise Laura à Vincent en conclusion de son récit. Et le vainqueur est celui qui sait le mieux couper les doigts et les poignets des sentiments qui pourraient l’affaiblir. Reste à savoir si un tel vainqueur, au dangereux potentiel, est digne d’admiration… Retenons toutefois que, dans l’exemple qu’en donne André Gide, cette sorte d’éthique du surhomme provient directement du sentiment d’impuissance, et donc de honte, qu’éprouve Laura devant la tragédie qui s’est déroulée sous ses yeux. Comme si le dégoût de soi pouvait se transcender par la conceptualisation d’une morale qui justifie l’élimination du plus faible…
Si l’on éclaire ce récit à la lumière de la problématique migratoire actuelle, on y trouve le condensé des sentiments qui ont agité l’Europe, de l’empathie et des mains tendues à la fermeture des frontières, de l’acceptation résignée d’une situation intolérable à ses tentatives de justification, voire, de plus en plus, à ses brutalités qui s’exercent parfois sur les femmes et les enfants migrants. Certes, me direz-vous, la barque européenne est loin d’être pleine, mais un tel constat, livré à la peur des eaux tourmentées, reste très subjectif: pour beaucoup, la barque est déjà pleine; pour les autres, il pourrait s’agir d’une question de temps: à quel moment la peur du flux migratoire – cette peur qui fait ressurgir la bête – justifiera aux yeux du plus grand nombre qu’on coupe les mains et les poignets de celles et ceux qui s’accrochent désespérément au rêve européen? Car l’intégration économique n’est pas le volet principal du problème, même s’il focalise tous les débats; les événements du 31 décembre dernier, à Cologne et ailleurs – et s’ils étaient concertés, murmure-ton? – ont montré qu’il en était d’autres, plus complexes, plus redoutables, plus sournois peut-être, dans tous les cas à même de faire chavirer les valeurs de l’Occident. Comment, par exemple, gérer les pulsions sexuelles frustrées des centaines de milliers d’hommes en pleine force de l’âge qui sont déjà montés – ou qui s’apprêtent à monter – dans la barque? En leur expliquant les bonnes manières et le respect occidental, comme le proposent Messieurs Sérieux et Mesdames Raffinement? Sur le long terme éventuellement, mais dans l’immédiat…
Dans son récit du naufrage de La Bourgogne, Laura, bien que d’emblée dégoûtée par l’égoïsme du sauve-qui-peut et risquant sa vie pour en sauver une autre, n’en vient-elle pas à accepter l’insoutenable, avant de transformer son expérience en une éthique du surhomme pour justifier la honte de sa passivité forcée? La logique migratoire poussée à l’extrême – et si on n’en était qu’au début? –, il est à redouter que ce choix s’impose à chacun d’entre nous, à un moment ou à un autre. Quant à moi, je le confesse, j’espère lâchement ne pas vivre l’instant où il pourrait m’incomber. Cet instant révélateur où je me retrouverai face à mes principes, et vraisemblablement face à ma propre incohérence…
*La Bourgogne était un paquebot éperonné par un navire anglais dans la nuit du 3 au 4 juillet 1898. En proie à une ablutophobie démentielle et contagieuse, les passagers ont jeté femmes et enfants hors des canots de sauvetage, tapé avec les rames sur la tête de celles et ceux qui nageaient à proximité, mordu ou coupé les mains de tous les autres qui s’agrippaient aux rebords. Le lendemain, les survivants avaient complètement oublié leurs atrocités et se pressaient en larmes au bureau de la Compagnie, implorant des nouvelles des femmes et des enfants qu’ils avaient eux-mêmes tués…
 Quand je pense au recueil En plein vol, les images qui me reviennent sont d'abord suscitées par la dernière nouvelle. Elle se passe en Inde. Une jeune voyageuse arrive dans un milieu de routards et de junkies occidentaux où elle croise quelques personnages marginaux. Ou, plutôt, ils seraient marginaux en Europe, mais ils sont tolérés et même respectés en Inde, où le rapport à la drogue n'est pas le même, où il est parfois sacré.
Quand je pense au recueil En plein vol, les images qui me reviennent sont d'abord suscitées par la dernière nouvelle. Elle se passe en Inde. Une jeune voyageuse arrive dans un milieu de routards et de junkies occidentaux où elle croise quelques personnages marginaux. Ou, plutôt, ils seraient marginaux en Europe, mais ils sont tolérés et même respectés en Inde, où le rapport à la drogue n'est pas le même, où il est parfois sacré. Ceux-ci, surtout des femmes, sont analysés avec finesse. Certaines d'entre elles assument le rôle traditionnel que la société leur destine : par exemple cette vacancière qui rêve d'enfant, d'amis et de chez soi alors que son compagnon, bien loin de cette utopie familiale, ne songe qu'à fumer des pétards. D'autres échappent à leurs rôles : on voit dans les récits d'Anne Pitteloud que les femmes ne sont pas forcément maternelles avec les enfants, ou se montrent parfois dégourdies lorsqu'il s'agit de fantaisies érotiques très poussées... Pour les détails, lire le recueil !
Ceux-ci, surtout des femmes, sont analysés avec finesse. Certaines d'entre elles assument le rôle traditionnel que la société leur destine : par exemple cette vacancière qui rêve d'enfant, d'amis et de chez soi alors que son compagnon, bien loin de cette utopie familiale, ne songe qu'à fumer des pétards. D'autres échappent à leurs rôles : on voit dans les récits d'Anne Pitteloud que les femmes ne sont pas forcément maternelles avec les enfants, ou se montrent parfois dégourdies lorsqu'il s'agit de fantaisies érotiques très poussées... Pour les détails, lire le recueil !

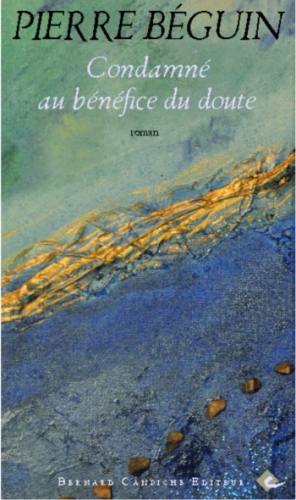
 On peut beaucoup admirer, ces temps-ci, dans les journaux et sur les réseaux sociaux, les poses viriles, tatouées, testostéronées, des jeunes auteurs romands qui squattent le devant de la scène littéraire. Ces beaux jeunes gens musclés prennent tellement de place qu'on en oublierait qu'il y a également des femmes talentueuses dans le mouvement de renouveau actuel de la littérature romande!
On peut beaucoup admirer, ces temps-ci, dans les journaux et sur les réseaux sociaux, les poses viriles, tatouées, testostéronées, des jeunes auteurs romands qui squattent le devant de la scène littéraire. Ces beaux jeunes gens musclés prennent tellement de place qu'on en oublierait qu'il y a également des femmes talentueuses dans le mouvement de renouveau actuel de la littérature romande! lle. Dans la plus grande incompréhension des valeurs de son épouse, qui, elle, voulait épouser un Occidental pour acquérir un mode de vie que son mari refuse. L'histoire douce-amère se termine de façon paradoxale, le tulou devenant finalement une discothèque branchée.
lle. Dans la plus grande incompréhension des valeurs de son épouse, qui, elle, voulait épouser un Occidental pour acquérir un mode de vie que son mari refuse. L'histoire douce-amère se termine de façon paradoxale, le tulou devenant finalement une discothèque branchée.