quid des pamphlets de Céline?
par antonin moeri
Dans la première partie de son essai écrit à la fin du siècle passé, Eric Seebold présente un descriptif des quatre pamphlets, dans lesquels Louis-Ferdinand Céline donne libre cours à un délire raciste qui a consterné la plupart des critiques de l’époque.
En effet, Céline était, jusqu’à Mea Culpa, considéré comme un écrivain de gauche: pacifiste, pourfendeur des hypocrites, proche du populo, critique féroce de la bourgeoisie, vengeur des faibles. Quelques motivations de cette oeuvre pamphlétaire sont avancées: mésaventures personnelles, angoisse de mort à l’approche de la guerre, antisémitisme du père qui lisait avec passion les livres de Drumont.
La question que pose Eric Seebold est la suivante: comment un auteur qui, dans ses deux premiers romans, a ridiculisé le patriotisme, le courage, la famille, le travail, l’amitié, la foi, comment cet auteur a-t-il pu écrire des textes partisans dont l’invective farcie d’argot, la verdeur ordurière, l’outrance, la férocité forcenée sont telles qu’aucun antisémite de l’époque, ou presque, n’a pu les prendre au sérieux, ces textes?
Dans la seconde partie, Eric Seebold donne la parole à ceux qui ont parlé de ces pamphlets dans la presse de l’époque. On est étonné, aujourd’hui, de lire, à propos de «Bagatelles pour un massacre» et de «L’Ecole des cadavres», des phrases du genre: «chef d’oeuvre de la plus haute classe», «Céline n’est jamais meilleur que lorsqu’il est moins mesuré» (André Gide), «Céline est un sceptique qui s’amuse», «Le cri nécessaire et averti du suprême danger qui menace la civilisation», «un certain plaisir littéraire qu’il est seul à nous apporter», «il y a une manière de démesure qui touche à la grandeur» (Henri Guillemin), «je reconnais toujours un vrai livre quand j’en vois un» (Ezra Pound).
Sur le plan politique, personne ne considérait alors Céline comme fiable. Droite et gauche rejetaient cet agité farfelu qu’ils voyaient comme un dément, un paumé provocateur, un cinglé halluciné, donc un mauvais propagandiste...
Dans la presse plus récente (post-holocauste), on met l’accent sur l’irresponsabilité d’un Céline ayant «exprimé des passions qui menaient aux camps», on insiste sur la nausée que provoque la lecture de ces textes, on porte un jugement définitif sur ce «salaud», ce «vendu», ce «traître»!!!
Dans la troisième partie, Seebold étudie quelques procédés stylistiques utilisés par Céline dans les pamphlets (enchâssements, formules répétées, exclamations, superlatifs, néologismes, insultes, comique...) et il émet une hypothèse: ces quatre textes pourraient être considérés comme la recherche d’un second souffle. En effet, c’est à partir d’eux que la syntaxe se hache, vole en éclats, que les points d’exclamation et de suspension prolifèrent, que les trouvailles et les acrobaties verbales se succèdent à un tempo d’enfer, que ce qu’il est convenu d’appeler le style célinien se structure avec force.
Ce que suggère Seebold, c’est que, sans cette plongée dans les régions les plus nauséabondes de l’âme humaine, Céline n’aurait pas écrit, comme il les a écrits, les chefs-d’oeuvre incomparables que sont Féerie pour une autre fois, D’un château l’autre, Nord et Rigodon.
Ce petit livre, publié en 1985 et écrit par un partisan de la réédition des pamphlets (toujours interdits selon le voeu de leur auteur), pourrait intéresser tout lecteur que le scandale Céline irrite, révolte, sidère, ne laisse pas indifférent.
Eric Seebold: Essai de situation des pamphlets de Céline, Ed.Du Lérot, 1985
 Voici le premier roman d'un nouvel écrivain valaisan. Valaisan, car même si Olivier Pitteloud vit et travaille dans le canton de Fribourg, son livre évoque les montagnes et les villages des Alpes ; les ambiances qu'il suscite et l'écriture qu'il façonne sont liés au Valais.
Voici le premier roman d'un nouvel écrivain valaisan. Valaisan, car même si Olivier Pitteloud vit et travaille dans le canton de Fribourg, son livre évoque les montagnes et les villages des Alpes ; les ambiances qu'il suscite et l'écriture qu'il façonne sont liés au Valais.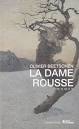

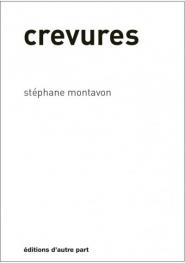 Il semble que les textes de Crevures aient été rédigés il y a une vingtaine d'années, puis retravaillés, revivifiés. Le résultat en tout cas inhabituel.
Il semble que les textes de Crevures aient été rédigés il y a une vingtaine d'années, puis retravaillés, revivifiés. Le résultat en tout cas inhabituel. Parfois c'est beaucoup, c'est trop, il y a comme un surplus de distillation. Le lyrisme tourne en préciosité, le lecteur perd sa respiration et choppe le tournis, les phrases deviennent un jeu formel qui paraît gratuit.
Parfois c'est beaucoup, c'est trop, il y a comme un surplus de distillation. Le lyrisme tourne en préciosité, le lecteur perd sa respiration et choppe le tournis, les phrases deviennent un jeu formel qui paraît gratuit. Avec La Dame rousse, Olivier Beetschen nous propose un roman à plusieurs niveaux qui s'emboîtent habilement et qui tournent autour d'un thème, annoncé par le titre.
Avec La Dame rousse, Olivier Beetschen nous propose un roman à plusieurs niveaux qui s'emboîtent habilement et qui tournent autour d'un thème, annoncé par le titre.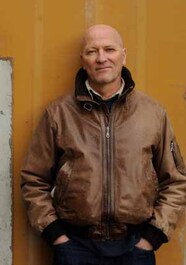 Le roman, outre les portraits bien menés de ces deux personnages, propose également une histoire de leur amitié. Très bien écrit, il balade le lecteur à travers différents lieux de Suisse romande.
Le roman, outre les portraits bien menés de ces deux personnages, propose également une histoire de leur amitié. Très bien écrit, il balade le lecteur à travers différents lieux de Suisse romande.
 C’est vous dire le plaisir – que dis-je, la jubilation! – que j’ai éprouvé à la lecture du dernier «roman» de Delphine de Vigan, D’après une histoire vraie. Diaboliquement habile! Et jouissif! L’histoire commence le plus simplement par la rencontre d’une auteure – qui est aussi la narratrice – en panne d’inspiration, cherchant à renouer avec la fiction pour ne plus à avoir de compte à rendre avec le réel, et d’une lectrice rapidement intrusive et manipulatrice qui, elle, exige d’un livre du vrai, de l’authentique. Une rencontre qui semble placer l’histoire dans le registre d’un thriller psychologique, impression renforcée par l’exergue: une citation d’un célèbre roman de Stephan King dans lequel un écrivain, recueilli par une lectrice fan après un accident, est torturé par celle qui l’a sauvé et qui exige de son auteur idolâtré une autre fin à son dernier manuscrit. Sauf que, dans D’après une histoire vraie, comme le signifie le titre, l’auteure personnage et narratrice s’appelle Delphine de Vigan, que les lieux, les événements, les personnages, à commencer par son compagnon François (Busnel), se donnent pour véridiques, ce que le lecteur peut facilement vérifier et authentifier. La romancière multiplie à ce point les effets de réel que le lecteur – à commencer par moi –, tout naturellement influencé encore par le titre, s’installe dans un récit dont il déchiffre a priori les événements comme s’ils relevaient de la biographie. Et il souffre pour cette pauvre Delphine tout en s’offusquant de son inconscient de François devant la manipulation qui menace de tourner au drame, d’autant plus qu’il croit que ce qui est raconté a véritablement eu lieu. Avant de réaliser (pour moi, ce fut au tiers du livre, pour d’autres ce pourrait être avant ou après) qu’il est dupe d’un récit qui se donne pour la vérité par la seule accumulation des effets de réel, alors que tout – ou presque, probablement – n’est qu’invention, travestissement, imagination. Et de comprendre que l’unique personne réellement manipulée dans cette histoire, ce n’est pas cette pauvre Delphine mais le lecteur lui-même, et qui plus est manipulé par cette pauvre Delphine elle-même… Diabolique! Il y a du Barbey d’Aurevilly dans ce roman, dans la nature de la relation narrateur lecteur, dans la stratégie perverse du narrateur – de la narratrice en l’occurrence – qui attire le lecteur par une promesse non tenue, qui jouit de l’exigence de ce dernier en manipulant son désir, qui affirme son pouvoir pour mieux tenir sa victime dans l’évidence de sa dépendance.
C’est vous dire le plaisir – que dis-je, la jubilation! – que j’ai éprouvé à la lecture du dernier «roman» de Delphine de Vigan, D’après une histoire vraie. Diaboliquement habile! Et jouissif! L’histoire commence le plus simplement par la rencontre d’une auteure – qui est aussi la narratrice – en panne d’inspiration, cherchant à renouer avec la fiction pour ne plus à avoir de compte à rendre avec le réel, et d’une lectrice rapidement intrusive et manipulatrice qui, elle, exige d’un livre du vrai, de l’authentique. Une rencontre qui semble placer l’histoire dans le registre d’un thriller psychologique, impression renforcée par l’exergue: une citation d’un célèbre roman de Stephan King dans lequel un écrivain, recueilli par une lectrice fan après un accident, est torturé par celle qui l’a sauvé et qui exige de son auteur idolâtré une autre fin à son dernier manuscrit. Sauf que, dans D’après une histoire vraie, comme le signifie le titre, l’auteure personnage et narratrice s’appelle Delphine de Vigan, que les lieux, les événements, les personnages, à commencer par son compagnon François (Busnel), se donnent pour véridiques, ce que le lecteur peut facilement vérifier et authentifier. La romancière multiplie à ce point les effets de réel que le lecteur – à commencer par moi –, tout naturellement influencé encore par le titre, s’installe dans un récit dont il déchiffre a priori les événements comme s’ils relevaient de la biographie. Et il souffre pour cette pauvre Delphine tout en s’offusquant de son inconscient de François devant la manipulation qui menace de tourner au drame, d’autant plus qu’il croit que ce qui est raconté a véritablement eu lieu. Avant de réaliser (pour moi, ce fut au tiers du livre, pour d’autres ce pourrait être avant ou après) qu’il est dupe d’un récit qui se donne pour la vérité par la seule accumulation des effets de réel, alors que tout – ou presque, probablement – n’est qu’invention, travestissement, imagination. Et de comprendre que l’unique personne réellement manipulée dans cette histoire, ce n’est pas cette pauvre Delphine mais le lecteur lui-même, et qui plus est manipulé par cette pauvre Delphine elle-même… Diabolique! Il y a du Barbey d’Aurevilly dans ce roman, dans la nature de la relation narrateur lecteur, dans la stratégie perverse du narrateur – de la narratrice en l’occurrence – qui attire le lecteur par une promesse non tenue, qui jouit de l’exigence de ce dernier en manipulant son désir, qui affirme son pouvoir pour mieux tenir sa victime dans l’évidence de sa dépendance.