Michel Vinaver, 11 septembre 2001 (18/09/2011)
Par Pierre Béguin
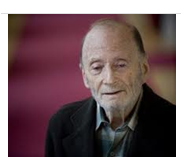
La pièce de Michel Vinaver, 11 septembre 2001, écrite dans les semaines qui ont suivi les attentats – ou plutôt composée, devrais-je dire, comme un montage de phrases récupérées ça et là dans les médias – semble effectivement évacuer la dimension tragique de l’événement. Le chœur n’a pour fonction que de faire entendre inlassablement l’importance du bruit américain qui continue en arrière-plan du drame, de souligner le cynisme du système financier et l’omniprésence des slogans publicitaires. Quant aux deux chefs, ils n’incarnent pas des héros mais des personnages communs, des sortes de marionnettes conditionnées par leur dogme respectif. Bush et Ben Laden, réunis le temps d’un faux dialogue en contrepoints et similitudes qui frisent le grotesque, n’ont rien d’Achille et d’Hector, et leur pseudo croisade n’a pas la grandeur de la guerre de Troie. La dimension du mal est inexistante, si ce n’est dans le discours stéréotypé des deux chefs. Elle n’est en réalité que manifestation de violence sauvage à laquelle répond une même violence sauvage. Quant aux personnages, hors de toute dimension psychologique, et même s’ils empruntent leur nom à des hommes et des femmes «réels», ils s’apparentent à des fragments de voix désincarnées qui font sourdre le chaos angoissant des attentats. Le seul personnage, en fait, c’est le système économique, personnage caricatural dont l’unique caractéristique est le cynisme. Le monde moderne semble avoir tué tous les ingrédients du tragique antique. Même si le 11 septembre 2001 de Vinaver s’inscrit dans la tradition de Les Perses d’Eschyle, en posant la question de cette dimension particulière de la vie politique que l’on nomme événement, et en tenant en contrepoint, ou en écho, les rapports que peuvent entretenir le Pouvoir et le peuple, elle souligne à l’évidence que l’aube du 21e siècle est le crépuscule des héros, que les humains ne sont plus que des rouages souvent sacrifiés sur l’autel d’un système inhumain.
Que reste-t-il donc? Dans la vision de Vinaver, l’éviction du tragique livre l’espace théâtral à l’ironie exclusivement. Mais comment traiter de l’ironie, voire de la drôlerie, dans une pièce au sujet essentiellement dramatique sans tomber dans le mauvais goût? L’ironie, ici, ne touche pas les personnages, elle ne s’inscrit pas dans leurs discours, leurs témoignages ou leurs répliques, elle se situe essentiellement dans les jointures des discours, dans les rapprochements ou les collusions qui détournent le sens des propos (notamment dans le faux dialogue entre Bush et Ben Laden), dans les accidents du texte, les trous, les pannes dans les dialogues, les surgissements incongrus de rimes ou les témoignages entrecoupés. Elle est avant tout décalage entre ce qui est attendu et ce qui se produit réellement, dans le langage comme dans les faits rapportés (par exemple dans l’anecdote du laveur de vitre du World Trade Center, rescapé miraculeux alors qu’il était particulièrement exposé à recevoir le Boeing sur la figure, ou plus généralement lorsqu’un «rouage» ne fait pas ce qu’on attend de lui).
En ce sens, l’ironie, véritable ciment des répliques, est constitutive du texte, elle lui est en quelque sorte consubstantielle. Si on l’enlève, la pièce s’écroule aussi sûrement que les «Twin Towers». Elle montre surtout que le montage de Vinaver, provenant de la lecture de la presse quotidienne américaine dans les semaines qui ont suivi les attentats (et traduite par l’auteur), pour facile qu’il pourrait paraître à certains, est en réalité un minutieux travail sur la langue où les phrases s’enchaînent les unes aux autres selon une organisation musicale proche «de la cantate ou de l’oratorio» (dixit l’auteur), avec alternances de parties chorales et solistes. C’est bien par l’ironie et non par le tragique, semble dire Vinaver, que l’on peut aujourd’hui «comprendre notre relation au monde».
Pour celles ou ceux qui voudraient découvrir cet événement sous un angle différent, plus complexe, moins réducteur que les habituelles interprétations manichéennes qui divisent le monde en axes du mal et du bien:
Michel Vinaver, 11 septembre 2001, Edition de l’Arche
A voir aussi jusqu’au 23 septembre à Pulloff, Lausanne, Rue de l’Industrie 10, sur une mise en scène d’Yvan Walther, texte déclamé par François Florey.
09:06 | Lien permanent | Commentaires (1)
Commentaires
Cela me rappelle Valère Novarina, dans l'esprit. Je ne suis pas très attiré, a priori, car en fait, je pense qu'il y a bien une dimension tragique, un fond qui est bien le conflit entre une vision du monde "occidentale" fondée sur les progrès techniques et scientifiques, et une vision du monde "orientale" fondée sur des principes moraux (bons ou mauvais, ce n'est pas le problème). Il n'y a qu'à voir comment au Pakistan par exemple on a regretté la mort de Ben Laden. Je m'intéresse en ce moment à la Thaïlande et il y a une vraie crise dans ce pays entre les valeurs traditionnelles du Bouddhisme et ce qui vient de l'Occident, l'argent lié aux progrès techniques et à la recherche d'une vie matérielle meilleure - aux produits à "forte valeur ajoutée", comme on dit pudiquement. Ce qui est tragique, c'est l'impossibilité apparente de concilier les deux mondes, y compris chez l'individu. Je pense qu'il faut aussi savoir prendre certains problèmes humains au sérieux. Cela fait un peu "intellectuel de l'élite européenne qui ne croit plus en rien". Mais le rien qui est entre l'Orient et l'extrême Occident (représenté par les Etats-Unis) ne résout aucun problème. On dirait une forme de dépit de constater que la culture européenne ne compte plus.
Écrit par : R.M. | 18/09/2011