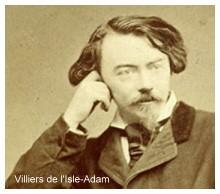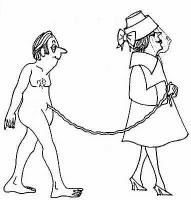Mamco
Par Alain Bagnoud
 La chose la plus amusante, au musée, ce sont les guides. Les guides vivants, je veux dire, ceux qui se tiennent dans les salles à disposition du visiteur, comme il y en a au Mamco http://www.mamco.ch/ lors des journées portes ouvertes. Un louable effort pédagogique pour expliquer, convaincre.
La chose la plus amusante, au musée, ce sont les guides. Les guides vivants, je veux dire, ceux qui se tiennent dans les salles à disposition du visiteur, comme il y en a au Mamco http://www.mamco.ch/ lors des journées portes ouvertes. Un louable effort pédagogique pour expliquer, convaincre.
J'y étais mercredi soir, en famille.
Donc on visite, on regarde les pièces, on apprécie ou moins, c'est selon (je vous conseille le cycle Philippe Ramette (voir l'illustration), Gardons nos illusions : beaucoup d'humour, d'absurde, des photos drôles et hardies, des sculptures parfois inquiétantes...)
Finalement, on se retrouve devant une chose qui intrigue mon fils, quatorze ans et assez curieux de tout. C'est un socle de béton avec un pilier en acier boulonné sur lequel sont pendus trois sacs de cuir genre punching-ball en Y. Il me pose des questions, je ne sais que répondre.
- Je vais demander au guide, dit-il.
Je soupire, je tente de le retenir. Trop tard. Une sémillante personne est déjà là, avec un écriteau « guide volant ».
« Alors, dit-elle, c'est un socle de béton avec un pilier boulonné sur lequel sont pendus trois sacs en cuir. Le Y des sacs peut faire penser aux chromosomes, le cuir à des punching-ball, il y a des sangles donc ça évoque un peu le sado-masochisme... » Et de continuer à décrire longuement ce que nous avions fort bien vu.
Nous réussissons enfin à l'interrompre.
- Ce sont donc deux oeuvres différentes? Le pilier et les sacs en Y.
- Non, c'est une oeuvre qui veut confronter le pilier et les sacs en Y, le cuir et l'acier, le béton au-dessous... violence... contraste... etc.
Inarrêtable. On y parvient quand même.
- Mais il y a deux titres d'oeuvres, au mur.
On lui montre les notices. « Pilier », et, séparé, au-dessous « Y ».
- Ah, dit-elle, je ne savais pas.
Elle regarde de nouveau et explique:
- J'ai toujours vu les piliers et les sacs ensemble.
Puis indémontable:
- Donc, il s'agit en fait d'un assemblage. Il y a deux oeuvres : le pilier, le béton, et puis le cuir, violence, punching-ball, sangles, mais l'artiste les a rassemblées, pour que les sacs en Y questionnent la verticalité du pilier, lequel, sur son socle de béton... Etc.
Allez au Mamco. Si vous ne vous intéressez pas aux oeuvres, parlez aux guides (ou plutôt écoutez-les). Leurs performances sont tout à fait étonnantes. Une interrogation constante des oeuvres et de leurs rapports au commentaire. Une oeuvre d'art en soi.
(Publié aussi dans Le blog d'Alain Bagnoud)