Par Alain Bagnoud
Les trois journaux publiés par les Editions de L'Aire cet automne, il est d'usage de les traiter ensemble, si on en croit la presse, ou l'intéressant débat qui a été mené par Reynald Feudiger le jeudi 8 octobre au Palais de Rumine, à l'occasion du vernissage de l'exposition Une Aire de liberté (voir ici).
Qui sommes-nous pour déroger à un usage désormais si établi? Donc, obéissons à la coutume. Petit répertoire.
Des trois, celui de Raphaël Aubert a été le plus violemment attaqué, notamment dans une pseudo émission culturelle donc l'incurie n'a pas fini de faire du bruit (voir par exemple ici, ici et ici - particulièrement les volées de bois vert assénés à son animateur dans les commentaires).
Peut-être parce que Chronique des treize lunes est ce qui se rapproche le plus du journal traditionnel. Il y a une entrée pour chaque jour, dans un travail constant de discipline et d'expression. « Je voulais savoir où passe la vie », a dit Aube rt dans le débat dont je parlais ci-dessus.
rt dans le débat dont je parlais ci-dessus.
Cette démarche quotidienne produit toutes sortes de textes dont la variété ou l'abondance laissent bien sûr des latitudes à la critique. Il est possible par exemple de dire de l'auteur ce que disait Léon Bloy de Huysmans: « Il ne se hait point. » On peut avec la plus mauvaise foi du monde recenser quelques maniérismes dans le projet. Je citerai cette manie de décrire chaque jour le temps qu'il fait. (Raphaël Aubert s'en est d'ailleurs expliqué: il s'agit d'une référence personnelle au journal de son père, qui faisait de même sur un agenda.)
Mais il serait tout à fait injuste de réduire son livre à quelques aspects finalement mineurs. Chronique des treize lunes n'est d'abord pas un journal psychologique. Raphaël Aubert y décrit plus son emploi du temps et ses réflexions qu'il n'analyse son moi.
Outre le compte-rendu des événements politiques de l'année 2008, qui nous semble déjà, à la lecture, étonnement lointaine (c'est l'année d'investitude américaine, les luttes entre Hillary Clinton et Obama, la désignation par MacCain de sa colistière Sarah Palin...), une grande part de ce journal est consacrée à l'art.
Raphaël Aubert est le fils de l'artiste Pierre Aubert (1910 – 1987), dont on voit un bois gravé en illustration de cet article.
Ses réflexions sur la peinture, l'art contemporain, la création sont tout à fait intéressantes. Il défend avec ardeur ses admirations littéraires (BHL, Houellebecq...) Son journal a en plus une singularité: il est le miroir du très bon roman publié en même temps que lui: La Terrasse des éléphants, dont on reparlera bientôt ici. Aubert y consigne l'avancée de son travail et ses inflexions. De la matière, donc, à se mettre sous la dent...
Quant au reproche de nombrilisme... Bien évidemment, quand on laisse publier un journal intime, on court le risque d'en être accusé. Le genre veut qu'on parle de soi. On s'affiche en public et il faut évidemment s'attendre à des réactions. Une telle publication affirme en effet l'importance que l'auteur prête à sa vie (que celui qui n'a jamais péché lui jette la pierre). Il prétend que celle-ci peut intéresser, à cause de la singularité des actes ou des, pensées ou de la sensibilité, ou à cause de l'importance de l'œuvre. C'est le cas des journaux d'écrivains, que l'usage est en général de rendre public quelques années après la mort de l'auteur.
Si on n'aime pas ce genre, il vaut mieux éviter l'irritation qu'un tel étalage de moi peut provoquer. Personnellement, je suis amateur, et je me rappelle avec le plaisir d'un gastronome qui évoque un repas savoureux aux plats variés les journaux des Goncourt, de Benjamin Constant, Jules Renard, Gide, Léautaud, Ramuz, Kafka...
Le Journal de Michel Moret, lui, évite les écueils dont nous parlions.
Danser dans l'air et la lumière est plus précisément une suite. En 2006, Moret avait publié Beau comme un vol de canards, ou cent jours dans la vie d'un éditeur à un moment charnière, quand il se demandait s'il allait poursuivre son activité professionnelle. Le succès de ce premier opus (édition rapidement épuisée, nombreuses lettres de lecteur...) l'a encouragé à reprendre la plume et c'est tant mieux.
Journal en grande partie professionnel, Danser dans l'air et la lumière tourne autour de l'édition et fourmille de notes passionnantes sur la réalité du métier d'éditeur. Ce n'est pas son seul intérêt. On y découvre un homme serein face à l'avancée de l'âge et de la mort qui approche, irénique, généreux, doué d'un grand appétit de la vie, passionné par le livre, l'édition. Un être recommandable en tous points et un écrivain juste et ensoleillé.
Quant au dernier journal dont on va parler ici, il s'agit d'un ouvrage de Gérard Delaloye, Le Voyageur (presque) immobile. Ce livre contient les notes de lectures prises entre 1998 et 2008. Et c'est passionnant! Impossible de lâcher le bouquin avant de l'avoir terminé.
Intéressé par les journaux intimes qu'il lit à grand flux, Gérard Delaloye montre à quel point ils peuvent dire une situation historique, l'éclairer de l'intérieur (la condition des juifs en Allemagne pendant la guerre, des Roumains sous Ceaucescu...) mieux que les études historiques. Intéressé surtout par les diaristes  liés aux événements de la vie publique, Delaloye y trouve un terreau pour l'historien qu'il est. Il nous parle de ses auteurs fondamentaux, Ernest Jünger, Günter Grass, André Malraux, Robert Walser surtout, avec un goût et une saveur qui nous donnent précisément envie de nous ruer sur leurs œuvres. Tout ceci servi par une grande culture historique et littéraire, des mises en relation avec les époques... Palpitant, on vous dit.
liés aux événements de la vie publique, Delaloye y trouve un terreau pour l'historien qu'il est. Il nous parle de ses auteurs fondamentaux, Ernest Jünger, Günter Grass, André Malraux, Robert Walser surtout, avec un goût et une saveur qui nous donnent précisément envie de nous ruer sur leurs œuvres. Tout ceci servi par une grande culture historique et littéraire, des mises en relation avec les époques... Palpitant, on vous dit.
Raphaël Aubert, Chronique des treizes lunes, L'Aire, 2009
Michel Moret, Danser dans l'air et la lumière, Journal d'un éditeur romand, L'Aire 2009
Gérard Delaloye, Le Voyageur (presque) immobile, L'Aire 2009
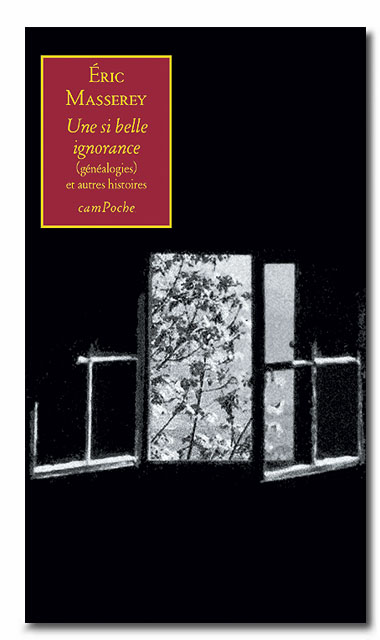 Les rentrées littéraires ont ceci de plaisant qu'elles nous offrent toutes sortes de productions d'amis dont il est agréable de parler. Vous vous en êtes aperçu, d'ailleurs, si vous lisez régulièrement ce blog.
Les rentrées littéraires ont ceci de plaisant qu'elles nous offrent toutes sortes de productions d'amis dont il est agréable de parler. Vous vous en êtes aperçu, d'ailleurs, si vous lisez régulièrement ce blog.

 rt dans le débat dont je parlais ci-dessus.
rt dans le débat dont je parlais ci-dessus. liés aux événements de la vie publique, Delaloye y trouve un terreau pour l'historien qu'il est. Il nous parle de ses auteurs fondamentaux, Ernest Jünger, Günter Grass, André Malraux, Robert Walser surtout, avec un goût et une saveur qui nous donnent précisément envie de nous ruer sur leurs œuvres. Tout ceci servi par une grande culture historique et littéraire, des mises en relation avec les époques... Palpitant, on vous dit.
liés aux événements de la vie publique, Delaloye y trouve un terreau pour l'historien qu'il est. Il nous parle de ses auteurs fondamentaux, Ernest Jünger, Günter Grass, André Malraux, Robert Walser surtout, avec un goût et une saveur qui nous donnent précisément envie de nous ruer sur leurs œuvres. Tout ceci servi par une grande culture historique et littéraire, des mises en relation avec les époques... Palpitant, on vous dit. Dimanche 18 octobre, 17 h Jean-Christophe Aeschlimann présentera Ce présent qui revient, (récits, L’Aire, 2007) à La Compagnie des mots, arcade « Au bonheur des mots », 33, rue Vautier, 1227 Carouge. Une bonne occasion de rencontrer cet écrivain, qui est également rédacteur en chef de la revue Coopération.
Dimanche 18 octobre, 17 h Jean-Christophe Aeschlimann présentera Ce présent qui revient, (récits, L’Aire, 2007) à La Compagnie des mots, arcade « Au bonheur des mots », 33, rue Vautier, 1227 Carouge. Une bonne occasion de rencontrer cet écrivain, qui est également rédacteur en chef de la revue Coopération.
![barbey3[1].jpg](http://blogres.blogspirit.com/media/01/01/216680835.jpg)
 « Plus je connais les hommes, plus j'aime les bêtes. » Gilbert Pingeon pourrait retourner le dicton: « plus j'aime les bêtes, et plus je connais les hommes. »
« Plus je connais les hommes, plus j'aime les bêtes. » Gilbert Pingeon pourrait retourner le dicton: « plus j'aime les bêtes, et plus je connais les hommes. »