Anne-Sophie Subilia, Jours d'agrumes
Par Alain Bagnoud
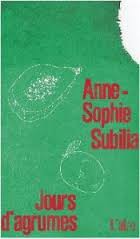
Les crises existentielles sont propices à la littérature. Elles amènent au questionnement sur soi, aux ruptures, aux errances, aux découvertes de l'ailleurs. Anne-Sophie Subilia s'est emparée avec talent de ce filon pour son roman Jours d’agrumes, qui inaugure une nouvelle collection aux Editions de L'Aire, réservée aux premiers romans : Alcantara.
Franca Charbonnier, suisse par son père et italienne par sa mère, a tout pour réussir. Elle est jeune, issue d'une famille comme il faut, étudiante en médecine qui termine ses études à Turin, programmée pour une certaine existence liée aux valeurs et aux ambitions de ses parents (la relation avec la mère est donnée comme une clé de ce personnage).
Mais soudain, se questionnant sur son identité, en recherche d'elle-même, elle abandonne tout, quitte l'Europe et se retrouve à Montréal, employée tout au fond de l'échelle, à trier des légumes au marché Jean-Talon. Cette rébellion lui permet de passer de l'esprit au corps, et de trouver sa propre voie, qui la mène vers la création théâtrale.
Certes, le thème de l'enfant de la bourgeoisie qui se fond dans un milieu populaire, découvre les vraies valeurs et se retrouve soi-même est un classique. Mais ce qu'on retient surtout de ce roman, c'est une maîtrise de la langue et de ses différents niveaux, une sensibilité aux matières, une vitalité.
Les meilleurs passages sont, pour moi, les descriptions du marché Jean-Talon, qui mettent le lecteur au milieu même de cette machinerie de bruits, de sons, de gestes, de couleurs, d'agitation et d'odeurs. Le roman s'amplifie à partir du moment où ce monde savoureux se déploie. Les portraits par touches des personnages sont très réussis : les employeuses de Franca, les soeurs Brassard, ses collègues, Gisèle, Rosa, Laura, Agathe, Violette et Charles, un aspirant comédien.
Avec un mystère en plus dans ce thème de l'identité et de la recherche de soi : tout au long du livre, le lecteur et le personnage s'interrogent pour savoir ce qui a jeté cette jeune femme hors des sentiers battus.
Anne-Sophie Subilia, Jours d’agrumes, Editions de l'Aire



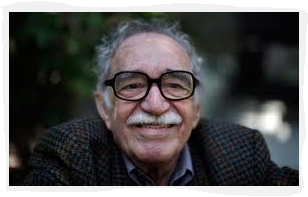
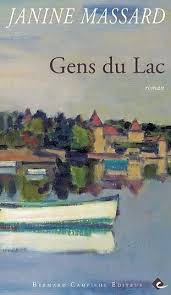 Secrets de famille. Celui qui a été confié à Janine Massard il y a quelques années n'a pas dû lui déplaire. Un certificat jauni, daté de 1947 et timbré du sceau de la République française, lui a révélé que «
Secrets de famille. Celui qui a été confié à Janine Massard il y a quelques années n'a pas dû lui déplaire. Un certificat jauni, daté de 1947 et timbré du sceau de la République française, lui a révélé que « 
