Florian Eglin, Cette malédiction qui ne tombe finalement pas si mal
Par Alain Bagnoud
 « Roman brutal et improbable », assure le sous-titre. C'est un euphémisme. Gore, punk, trash, anar, détaché, drôle, pléthorique et jubilatoire, voici à peu près ce qui vient quand on veut définir Cette malédiction qui ne tombe finalement pas si mal, de Florian Eglin.
« Roman brutal et improbable », assure le sous-titre. C'est un euphémisme. Gore, punk, trash, anar, détaché, drôle, pléthorique et jubilatoire, voici à peu près ce qui vient quand on veut définir Cette malédiction qui ne tombe finalement pas si mal, de Florian Eglin.
Je ne serais jamais tombé sur ce livre sans Corinne Desarzens. Elle l'a signalé dans son recueil Dévorer les pages, et le conseille à toute occasion depuis sa sortie toute récente (cet automne). Notamment à une rencontre à la librairie le Rameau d'or où elle présentait son ouvrage. En lisant Florian Eglin, on comprend cet engouement. L'histoire et le style de Cette malédiction qui ne tombe finalement pas si mal sont insolites et remarquables.
Le narrateur, Solal Aronowicz, commence par assassiner une nonagénaire dans un supermarché en lui passant dessus avec une tracteur pour tondre le gazon. Un beau modèle, à double rotor pour trancher les racines récalcitrantes. En agonisant celle-ci lui lance une malédiction mystérieuse.
Il n'en a cure et regagne l'Institut dont il est le factotum incompétent, haï, surpayé à cause d'une erreur administrative. Évidemment, c'est pour y glander. Rien d'autre ne l'intéresse que fumer des cigares de luxe, boire des whiskys rares et porter des chaussures princières.
Ah si, quand même. Ce docteur en littérature, qui avait commencé « une carrière poussive » à l'université avant qu'une supercherie découverte dans un colloque ne l'en exclue, collectionne les éditions rares.
Après d'autres épisodes sanglants (le syndicaliste de l'institut le cogne et lui pisse dessus, la Séide du directeur charcute des élèves...) ou mystérieux (il reçoit une lettre bizarre qu'il n'ouvre pas) le voilà à Barcelone pour acquérir une édition rare d'Huysmans, Là-bas, roman qui, comme chacun le sait, parle de satanisme et de messes noires...
 La suite est à la hauteur. L'insupportable, immoral, prétentieux et drôlissime Solal s'ouvre le ventre pour en faire sortir une pieuvre. Une prof de français assez à cheval sur le programme lui mord la nuque. Il perd successivement un œil, un rein, un cœur. Les armes apparaissent. Des élèves sont massacrés... Et plus ça gicle, plus on en redemande.
La suite est à la hauteur. L'insupportable, immoral, prétentieux et drôlissime Solal s'ouvre le ventre pour en faire sortir une pieuvre. Une prof de français assez à cheval sur le programme lui mord la nuque. Il perd successivement un œil, un rein, un cœur. Les armes apparaissent. Des élèves sont massacrés... Et plus ça gicle, plus on en redemande.
L'auteur a composé son roman à partir des textes d'un blog, centré sur le personnage de Solal, nommé Le journal d'un con : le blog de Solal Aronowicz. Il se veut inscrit « dans deux lignées littéraires, l'une classique issue du genre épique et symbolique et l'autre moderne issue des romans d'horreur noirs et ironiques. »
Il y a un dispositif de roman policier, dans ce texte hénaurme, mais aussi du fantastique, du masochisme, du sadisme, évidemment, et beaucoup de parodie. On rit souvent. On se laisse aussi prendre par le désespoir qui sourd de cette écriture paradoxale, rythmée, précise, jouissive.
Florian Eglin, Cette malédiction qui ne tombe finalement pas si mal, La Baconnière

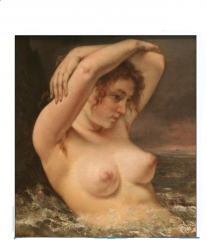





 Alexandre Voisard se nourrit de sa famille et c’est une digestion lente, qui prend du temps, mais se savoure avec d’autant plus d’appétit, qui, le concernant, vient en mangeant, et en prenant de l’âge : le poète a fêté ses 83 ans. Et pour notre plaisir, il sort son meilleur livre de prose, un roman familial qui fait suite à Le Mot Musique, portrait fraternel de son père, écrit il y a dix ans déjà, et qui dans son ton, en un peu plus compassé, fait penser à cet Oiseau de Hasard. Ici, c’est le grand-père qui fait le modèle, un grand-père absent de la saga familial, un nom tu par la mémoire familiale comme un secret trop lourd à porter : c’est que le Louis était un sacré oiseau, noceur comme pas deux, un peu voleur, doué pour trousser les femmes autant que réparer des montres. C’est un chant entre deux siècles, la fin du XIXe et le début du XXe, un temps de petite misère mais aussi d’échappées belles, de rencontres au marché, de départ à la légion… Voisard excelle dans ce récit de
Alexandre Voisard se nourrit de sa famille et c’est une digestion lente, qui prend du temps, mais se savoure avec d’autant plus d’appétit, qui, le concernant, vient en mangeant, et en prenant de l’âge : le poète a fêté ses 83 ans. Et pour notre plaisir, il sort son meilleur livre de prose, un roman familial qui fait suite à Le Mot Musique, portrait fraternel de son père, écrit il y a dix ans déjà, et qui dans son ton, en un peu plus compassé, fait penser à cet Oiseau de Hasard. Ici, c’est le grand-père qui fait le modèle, un grand-père absent de la saga familial, un nom tu par la mémoire familiale comme un secret trop lourd à porter : c’est que le Louis était un sacré oiseau, noceur comme pas deux, un peu voleur, doué pour trousser les femmes autant que réparer des montres. C’est un chant entre deux siècles, la fin du XIXe et le début du XXe, un temps de petite misère mais aussi d’échappées belles, de rencontres au marché, de départ à la légion… Voisard excelle dans ce récit de