canapé des confidences
par antonin moeri

Les scènes de cul, c’est pas mon fort. Je m’y suis pourtant essayé. J’ai lu la chose devant un jeune poète talentueux. Il a dit: J’aime ta séquence, c’est pas facile de raconter ça. J’avais adopté le point de vue de Loulia. Je me sentais mieux dans la peau d’une femme pour évoquer le frisson et les organes. Pour raconter ces secondes où tout bascule dans l’inconnu, Eric Holder choisit la crudité du sexe.
Ainsi voit-on le membre que Youssef exhibe en pleine classe ou accompagne-t-on Francis dans une chambre où celui-ci, tétanisé («il hochait la tête, s’épongeant le front, écoutant avec honte ses propres gémissements»), va jouir «comme il ne jouirait sans doute plus jamais». Charles, 21 ans, découvre l’amour tarifé avec une fausse blonde dont le bébé dort à côté et dont le mari, chauffeur routier, travaille la nuit. «Cambrée, la tête renversée en arrière, les seins tressautant, elle se griffait les flancs. Elle ne s’entendit pas japper son plaisir, des cris rauques qui firent craindre à son partenaire que le bébé se réveillât».
Dans une des plus belles nouvelles, «Aurore à Paris», une attachée de presse raconte au narrateur comment elle tomba amoureuse d’un petit Polonais roux, avec qui elle vit toujours, 25 ans plus tard. Lors d’un cocktail dans une galerie d’art, Aurore rencontre Joseph, un courtier élégant, superbe Libanais qu’elle décide de s’offrir. Le courtier l’emmène chez lui, où un jeune réfugié lit Baudelaire. Champagne. Elle a aussitôt envie de connaître la vie de Pawel. Le Libanais caresse ses hanches. Pawel lui ôte ses bas, sa phalange glisse dans le sillon de ses fesses. «Elle accepte tout ensemble celui qui dévore sa bouche, son oreille, celui qui se glisse profondément en elle, prenant appui sur l’envers crémeux des cuisses qu’il a repliées sur ses seins». Elle mord Pawel à la bouche. C’est avec lui qu’elle connaîtra l’extase pendant que Joseph se branle, vautré dans un fauteuil.
Laetitia Bercoff travaille dans le culturel. Elle organise des salons du livre. Elle vit depuis vingt ans avec un homme plus âgé qu’elle, «un ingénieur souvent à l’étranger». Elle a sorti un livre au Seuil. Un employé de la commune, Virgile, lui rend des services: il lui installe le nouveau sèche-linge, soigne son jardin, lui empile des stères dans le bûcher. Un jour, en empilant des tuiles, Virgile tombe sur un nid de guêpes. Deux insectes s’insinuent dans son pantalon. Plusieurs piqûres. Après avoir cherché l’Aspivenin, Laetitia déboutonne le pantalon de l’homme à tout faire. La dernière inflammation se trouve sur le testicule gauche. Fascinée par le membre de taureau, elle ne peut s’empêcher de le gober. Dans la chambre d’amis, elle saisit le gourdin qu’elle veut sentir dans son ventre. Ses jambes à elle, il les écarte, les maintient en hauteur par les talons. «Agenouillé au milieu, il ne remue, à petits coups de ventre, que la pointe dans l’anneau. Il l’élargit par degrés si discrets...» «Elle s’épouvante de ce qui la traverse. Pas au fond, il ne va pas... Si!» Le narrateur trouve Laetitia changée au salon du livre, «sur le qui-vive, rapidement agacée». Quand Laetitia partira en Italie avec son mari, Virgile poussera le cri de Tarzan en levant le pouce.
La posture qu’adopte Holder dans ces nouvelle est à la fois distante et d’une infinie tendresse. Ces instants où tout bascule dans l’inconnu sont narrés avec une précision d’entomologiste. Jamais le lecteur ne se sent voyeur, mais plutôt entraîné dans un vertige. Ce vertige qu’il a connu quand... «Embrasez-moi» est un livre magnifique de grâce et de légèreté, qui pulse à chaque page, d’une férocité roborative, qu’on a envie d’offrir à ses amis et, surtout, qu’on brûle de relire pour retrouver Cathy, Marie, Blandine, Aurore, Brigit, Pauline et Laetitia. Quel bonheur de pouvoir se dire: ce genre de livre existe!
ERIC HOLDER: EMBRASEZ-MOI, Le Dilettante, 2011
 Depuis qu’un homme respectable, à la trajectoire et à l’âge respectables, a lancé ce mot d’ordre respectable sur quelques pages, il est de bon ton de s’indigner.
Depuis qu’un homme respectable, à la trajectoire et à l’âge respectables, a lancé ce mot d’ordre respectable sur quelques pages, il est de bon ton de s’indigner.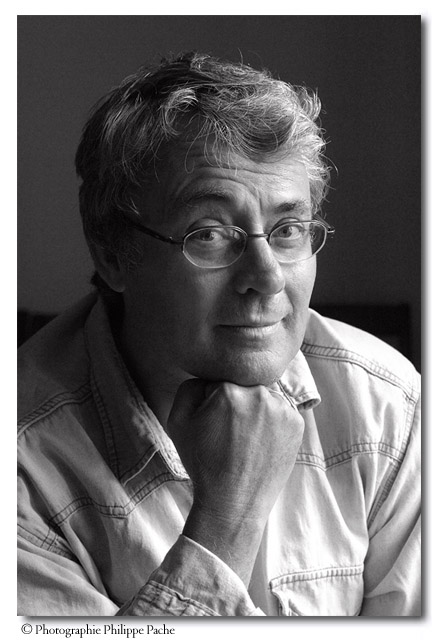 Quand j'avais lu ces livres, j'avais été frappé par l'originalité de cette voix neuve. L'écriture y est servie par une distance ironique qui rend certains passages d'une drôlerie irrésistible. Elle est précise et joue sur des expressions toutes faites reprises avec ce même tremblement qu'on trouve chez Flaubert lorsqu'il utilise des clichés: un écho de pièce vide fait résonner les mots, empêche qu'on les prenne au premier degré mais refuse le deuxième degré souligné, reste entre deux.
Quand j'avais lu ces livres, j'avais été frappé par l'originalité de cette voix neuve. L'écriture y est servie par une distance ironique qui rend certains passages d'une drôlerie irrésistible. Elle est précise et joue sur des expressions toutes faites reprises avec ce même tremblement qu'on trouve chez Flaubert lorsqu'il utilise des clichés: un écho de pièce vide fait résonner les mots, empêche qu'on les prenne au premier degré mais refuse le deuxième degré souligné, reste entre deux.
 Bucky Wunderlick, une superstar du rock des années 70 en a assez. Il quitte son groupe en pleine tournée, disparaît et se réfugie dans une piaule sur Great Jones Street, New York.
Bucky Wunderlick, une superstar du rock des années 70 en a assez. Il quitte son groupe en pleine tournée, disparaît et se réfugie dans une piaule sur Great Jones Street, New York.
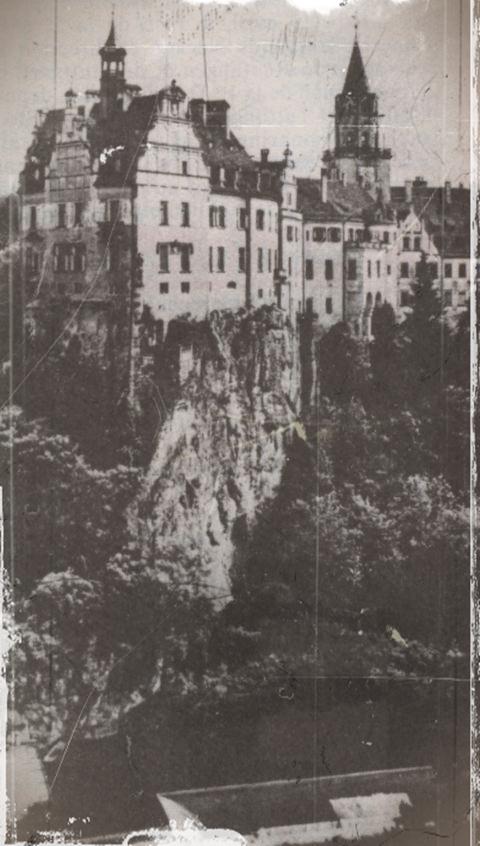 Au début de D'un château l'autre, Céline se trouve dans une situation où se reconnaîtront pas mal de ceux qui se piquent d'écrire.
Au début de D'un château l'autre, Céline se trouve dans une situation où se reconnaîtront pas mal de ceux qui se piquent d'écrire.

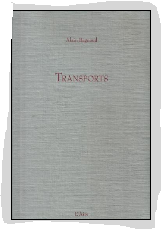 A quelle posture nous contraint la lecture de Transports, le dernier livre d’Alain Bagnoud? Au fil des textes qui se succèdent, et dont le rythme est donné par la juxtaposition d’instantanés, nous accompagnons des poses, des faits, des paroles, des gestes en apparence anodins.
A quelle posture nous contraint la lecture de Transports, le dernier livre d’Alain Bagnoud? Au fil des textes qui se succèdent, et dont le rythme est donné par la juxtaposition d’instantanés, nous accompagnons des poses, des faits, des paroles, des gestes en apparence anodins. Qui parle? Qui est ce «je» désabusé faisant une sorte de bilan de sa vie au travers du portrait de ses semblables, de la masse desquels il n’est pas parvenu à s’extraire comme ses rêves de jeunesse l’avaient imaginé? Un écrivain déçu, un professeur désillusionné, un bourgeois qui s’encanaille dans les zones floues des transports publics où s’agglutine les laissés-pour-compte, les marginaux, les hors normes, un propriétaire de vignes qui se donne bonne conscience en feignant l’empathie envers les déshérités ou les mendiants roms pour s’en dédouaner aussitôt: «Moi, je suis un nanti et je trouve, par confort, que la charité est égoïste». Qui? Bagnoud bien sûr, mais aussi vous, moi, tout le monde. Avoue-le! Tu ne la voyais pas comme ça, ta vie!
Qui parle? Qui est ce «je» désabusé faisant une sorte de bilan de sa vie au travers du portrait de ses semblables, de la masse desquels il n’est pas parvenu à s’extraire comme ses rêves de jeunesse l’avaient imaginé? Un écrivain déçu, un professeur désillusionné, un bourgeois qui s’encanaille dans les zones floues des transports publics où s’agglutine les laissés-pour-compte, les marginaux, les hors normes, un propriétaire de vignes qui se donne bonne conscience en feignant l’empathie envers les déshérités ou les mendiants roms pour s’en dédouaner aussitôt: «Moi, je suis un nanti et je trouve, par confort, que la charité est égoïste». Qui? Bagnoud bien sûr, mais aussi vous, moi, tout le monde. Avoue-le! Tu ne la voyais pas comme ça, ta vie!