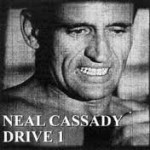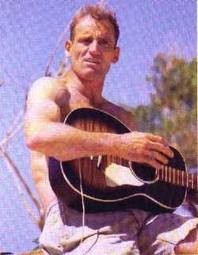Emmanuel Carrère, Limonov
Par Alain Bagnoud
 Carrère (1957- ) écrit sur Limonov (1943- ).
Carrère (1957- ) écrit sur Limonov (1943- ).
Ils se sont connus dans les années 80 à Paris après que Limonov a publié Les poètes russes préfèrent les grands nègres, quand il était un jeune écrivain branché qui collaborait à L’Idiot international de Jean-Edern Hallier, passait chez Ardisson, s’habillait avec des vareuses de l’armée rouge...
Il a eu une trajectoire agitée, Edouard Limonov. Fils de tchékiste du KGB, successivement petit voyou russe, poète, star de l’underground soviétique, clochard à New York, valet de chambre, écrivain branché parisien, guerrier pro-serbe, fondateur et directeur d’un parti d’extrême-droite russe, le Parti national-bolchévique.
Carrère l’a choisi comme sujet de cette biographie-roman parce qu’il pense que son destin révèle quelque chose sur l’Histoire. Il a raison.
Limonov, hanté par l’idée de devenir un héros, s’est collé à beaucoup d’événements importants du dernier demi-siècle. Dans le livre, il sert d'illustration à plusieurs moments historiques. Sa vie éclaire le communisme soviétique, le libéralisme US, la guerre des Balkans, la Russie elstinienne ou le système Poutine.
C’est cette fonction de révélateur, les anecdotes autour de cette trajectoire, l’écriture de Carrère aussi, vivante et maîtrisée, qui rendent le livre palpitant. Il est ambigu aussi.
En le lisant, on ne peut qu’admirer l’énergie d’Edouard Limonov, sa vitalité, son désir accompli d’être toujours du côté des plus faibles, pas par  compassion, plutôt par une sorte de haine contre ceux qui sont au-dessus de lui, qui lui bouchent le passage, lui qui voudrait être tout en haut. Carrère lui-même montre de la fascination et une sorte de jalousie pour ce destin, sentiments qui refluent parfois devant une horreur de bien-pensant pour les positions et les actes de son héros. Mais de manière générale, il suspend son jugement, dit-il, ne tranche pas la question de savoir si Edouard est un salaud ou un type admirable. Malgré tout, on est amené globalement à trouver que Limonov est un grand homme.
compassion, plutôt par une sorte de haine contre ceux qui sont au-dessus de lui, qui lui bouchent le passage, lui qui voudrait être tout en haut. Carrère lui-même montre de la fascination et une sorte de jalousie pour ce destin, sentiments qui refluent parfois devant une horreur de bien-pensant pour les positions et les actes de son héros. Mais de manière générale, il suspend son jugement, dit-il, ne tranche pas la question de savoir si Edouard est un salaud ou un type admirable. Malgré tout, on est amené globalement à trouver que Limonov est un grand homme.
Mais il y les vidéos sur youtube. Je vous mets ci-dessous celle où on voit notre Russe écouter respectueusement Karadzic devant Sarajevo. Le moment intéressant, qui a d’ailleurs fasciné Carrère, est celui où Limonov tourne autour d’une mitraillette et finalement s’installe pour lâcher des rafales sur Sarajevo. Qu’il ait visé des civils ou qu’il ait tiré en l’air, comme il se justifiera plus tard, a certes une importance cruciale.
Mais ce qui ressort surtout de ces images, c’est que ce type qui s’est voulu un héros toute sa vie, un surhomme, un dominant, donne l’image d’un petit gamin admiratif fasciné par la puissance et les outils de morts: un type finalement assez minable.
Emmanuel Carrère, Limonov, P.O.L.

 Le dieu Pan, le saviez-vous, n’est pas mort.
Le dieu Pan, le saviez-vous, n’est pas mort. A cette histoire s’en mêle une autre.
A cette histoire s’en mêle une autre.
 « Au bord de lui-même. Ne se penchant sur son moi que par incidences hasardeuses et dans la crainte d'y tomber. » Le récit nostalgique vire alors au voyage intérieur. Et l'on n'est pas surpris, dans cette odyssée amoureuse, de retrouver la figure familière d'Ulysse. Se consolant, ici, du départ de Nomia dans les bras de la belle Calypso. Ou, là, cherchant à échapper au charme des sirènes ou à l'appel de Circé.
« Au bord de lui-même. Ne se penchant sur son moi que par incidences hasardeuses et dans la crainte d'y tomber. » Le récit nostalgique vire alors au voyage intérieur. Et l'on n'est pas surpris, dans cette odyssée amoureuse, de retrouver la figure familière d'Ulysse. Se consolant, ici, du départ de Nomia dans les bras de la belle Calypso. Ou, là, cherchant à échapper au charme des sirènes ou à l'appel de Circé.
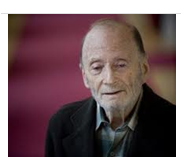 «Je pense que, aujourd’hui, on ne peut pas comprendre le monde, notre relation au monde, par le tragique.» Cette phrase de Michel Vinaver m’est revenue en mémoire durant les multiples commémorations du 10e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, notamment lors des nombreuses diffusions sur toutes les chaînes de télévision de reportages qui insistaient parfois un peu lourdement sur la pathos et le tragique des événements, là où l’on aurait souhaité peut-être davantage de recul.
«Je pense que, aujourd’hui, on ne peut pas comprendre le monde, notre relation au monde, par le tragique.» Cette phrase de Michel Vinaver m’est revenue en mémoire durant les multiples commémorations du 10e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, notamment lors des nombreuses diffusions sur toutes les chaînes de télévision de reportages qui insistaient parfois un peu lourdement sur la pathos et le tragique des événements, là où l’on aurait souhaité peut-être davantage de recul. C’est un roman victorien, a-t-on dit. A l’esthétique victorienne. Paru en 2001, il raconte en trois volets la formation d’une romancière, ses manipulations et les distorsions qu’elle apporte à la réalité.
C’est un roman victorien, a-t-on dit. A l’esthétique victorienne. Paru en 2001, il raconte en trois volets la formation d’une romancière, ses manipulations et les distorsions qu’elle apporte à la réalité. La troisième partie est une sorte de post-scriptum aux deux premières. En 1999, Briony explique qu’elle vient de terminer ce roman, lui donne une conclusion, évoque ce qui est arrivé postérieurement aux personnages et explique quels gauchissements de la réalité elle a assumés et pourquoi.
La troisième partie est une sorte de post-scriptum aux deux premières. En 1999, Briony explique qu’elle vient de terminer ce roman, lui donne une conclusion, évoque ce qui est arrivé postérieurement aux personnages et explique quels gauchissements de la réalité elle a assumés et pourquoi.