 On l'attendait, avec un peu d'angoisse et beaucoup d'impatience, ce volume consacré à la Suisse dans la prestigieuse collection Découvertes-Gallimard. Et il est arrivé. Pas tout de suite, d'ailleurs, puisqu'il est seulement le 573e de la collection ! Il est signé François Walter, un professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'Université de Genève depuis 1986.
On l'attendait, avec un peu d'angoisse et beaucoup d'impatience, ce volume consacré à la Suisse dans la prestigieuse collection Découvertes-Gallimard. Et il est arrivé. Pas tout de suite, d'ailleurs, puisqu'il est seulement le 573e de la collection ! Il est signé François Walter, un professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'Université de Genève depuis 1986.
Ne boudons pas notre plaisir : l'iconographie, comme d'habitude, y est très soignée ; la mise en page, magnifique ; le texte parfaitement mis en valeur. En bon disciple de la « nouvelle histoire suisse », François Walter déconstruit habilement tous les mythes fondateurs : le pacte de 1291, antidaté, ne serait qu'un document rédigé après coup pour édifier le mythe de la Confédération. Guillaume Tell, bien sûr, n'a jamais existé. Quant aux exploits guerriers des premiers Suisses, ils ne sont qu'« une construction idéologique » visant à donner une base identitaire à la future Confédération. Cela dit, même si l'auteur raffole des clichés de la « nouvelle histoire », il ne passe pas pour autant sous silence les innombrables conflits, traumatismes, voire antagonismes religieux (la guerre du Sonderbund) auxquels la Suisse a dû faire face, et qu'elle a réglés à sa manière, c'est-à-dire plutôt bien. Comme il n'oublie pas de mentionner, plus loin, certains épisodes peu glorieux de l'histoire contemporaine, tel le fameux tampon J apposé sur les passeports des ressortissants juifs, que l'auteur qualifie de « capitulation morale ». Comme il n'oublie pas de dénoncer « les compromissions avec l'économie de guerre nazie », « les fréquentations douteuses des régimes corrompus » ou encore la complaisance à accueillir des fonds soustraits au fisc, etc.
On le voit : l'auteur adhère à cette image peu reluisante de « pays crapule », si largement diffusée à l'étranger qu'elle en est devenue un stéréotype!
Plus intéressante est la partie du livre consacrée à l'importance du paysage, autre élément constitutif de l'« identité suisse » (qui, comme chacun sait, est un mirage !). Ici François Walter fait montre d'une connaissance certaine de l'imagerie helvétique : lacs, montagnes, forêts, glaciers.  Dont tout le monde vante l'inexprimable beauté. Signe, sans doute, d'une Nature encore intacte, proche de sa pureté originelle. Vantées par les premiers touristes anglais au XIXe siècle, ces « beautés naturelles » attireront, plus tard, le tourisme de masse vers les stations de sports d'hiver, transformant la Suisse en pays de cartes postales.
Dont tout le monde vante l'inexprimable beauté. Signe, sans doute, d'une Nature encore intacte, proche de sa pureté originelle. Vantées par les premiers touristes anglais au XIXe siècle, ces « beautés naturelles » attireront, plus tard, le tourisme de masse vers les stations de sports d'hiver, transformant la Suisse en pays de cartes postales.
 Tout n'est pas à jeter, sans doute, dans ce petit livre où l'on retrouve toutes les finesses, mais aussi toutes les naïvetés de la « nouvelle histoire suisse. » Un bémol, cependant : l'absence, quasi totale, mais effarante, de la culture (au sens large) qui s'est développée dans ce pays. Quelques noms d'écrivains, jetés ici ou là (Rousseau 1712-1778), à la sauvette, mais jamais développés, ni interrogés. Aucune mention de Georges Haldas, de Nicolas Bouvier, de Corinna Bille ! Idem pour Albert Cohen ou Denis de Rougemont, grand penseur de l'Europe. Les mêmes lacunes s'appliquent à la peinture, à la musique ou encore à l'architecture, complètement oubliées dans ce panorama de cartes postales. De telles lacunes étonnent, surtout chez un professeur d'Université.
Tout n'est pas à jeter, sans doute, dans ce petit livre où l'on retrouve toutes les finesses, mais aussi toutes les naïvetés de la « nouvelle histoire suisse. » Un bémol, cependant : l'absence, quasi totale, mais effarante, de la culture (au sens large) qui s'est développée dans ce pays. Quelques noms d'écrivains, jetés ici ou là (Rousseau 1712-1778), à la sauvette, mais jamais développés, ni interrogés. Aucune mention de Georges Haldas, de Nicolas Bouvier, de Corinna Bille ! Idem pour Albert Cohen ou Denis de Rougemont, grand penseur de l'Europe. Les mêmes lacunes s'appliquent à la peinture, à la musique ou encore à l'architecture, complètement oubliées dans ce panorama de cartes postales. De telles lacunes étonnent, surtout chez un professeur d'Université.
Quand on se rappelle les chroniques savoureuses de Louis Gaulis (La Suisse insolite, Mondo) ou de Nicolas Bouvier (L'Art populaire en Suisse, Zoé), on regrette que ce livre n'ait pas été confié à un écrivain. Par exemple à un Jean-Louis Kuffer, grand bourlingueur devant l'Eternel, qui excelle dans l'art du portrait, de l'analyse fine, du regard amoureux. Cela aurait donné un livre non seulement de savoir, mais aussi — et surtout — de saveur. Mais l'occasion est manquée…
* François Walter, La Suisse au-delà du paysage, Découvertes-Gallimard, 2011.



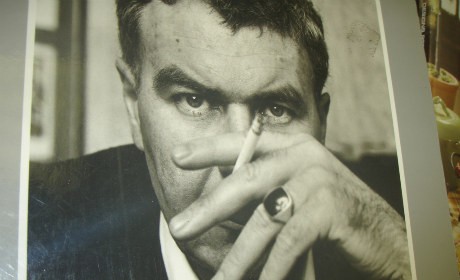
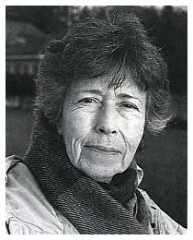 En lisant le dernier livre d'Yvette Z'Graggen (Juste avant la pluie, Ed. de l'Aire 2011), j'ai immédiatement pensé à cette phrase d'Albert Thibaudet: «Le romancier authentique crée ses personnages avec les directions infinies de sa vie possible, le romancier factice les crée avec la ligne unique de sa vie réelle. Le vrai roman est comme une autobiographie du possible». A en croire Thibaudet, Yvette Z'Graggen est une romancière authentique, et son dernier livre nous le confirme, s'il en était encore besoin. Juste avant la pluie joue constamment entre réalité et fiction dans un jeu de mémoire et d'imagination caractéristique d'une œuvre abondante dont ce roman se donne comme une conclusion définitive, une sorte de testament littéraire.
En lisant le dernier livre d'Yvette Z'Graggen (Juste avant la pluie, Ed. de l'Aire 2011), j'ai immédiatement pensé à cette phrase d'Albert Thibaudet: «Le romancier authentique crée ses personnages avec les directions infinies de sa vie possible, le romancier factice les crée avec la ligne unique de sa vie réelle. Le vrai roman est comme une autobiographie du possible». A en croire Thibaudet, Yvette Z'Graggen est une romancière authentique, et son dernier livre nous le confirme, s'il en était encore besoin. Juste avant la pluie joue constamment entre réalité et fiction dans un jeu de mémoire et d'imagination caractéristique d'une œuvre abondante dont ce roman se donne comme une conclusion définitive, une sorte de testament littéraire.

 On l'attendait, avec un peu d'angoisse et beaucoup d'impatience, ce volume consacré à la Suisse dans la prestigieuse collection Découvertes-Gallimard. Et il est arrivé. Pas tout de suite, d'ailleurs, puisqu'il est seulement le 573e de la collection ! Il est signé François Walter, un professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'Université de Genève depuis 1986.
On l'attendait, avec un peu d'angoisse et beaucoup d'impatience, ce volume consacré à la Suisse dans la prestigieuse collection Découvertes-Gallimard. Et il est arrivé. Pas tout de suite, d'ailleurs, puisqu'il est seulement le 573e de la collection ! Il est signé François Walter, un professeur d'histoire moderne et contemporaine à l'Université de Genève depuis 1986. Dont tout le monde vante l'inexprimable beauté. Signe, sans doute, d'une Nature encore intacte, proche de sa pureté originelle. Vantées par les premiers touristes anglais au XIXe siècle, ces « beautés naturelles » attireront, plus tard, le tourisme de masse vers les stations de sports d'hiver, transformant la Suisse en pays de cartes postales.
Dont tout le monde vante l'inexprimable beauté. Signe, sans doute, d'une Nature encore intacte, proche de sa pureté originelle. Vantées par les premiers touristes anglais au XIXe siècle, ces « beautés naturelles » attireront, plus tard, le tourisme de masse vers les stations de sports d'hiver, transformant la Suisse en pays de cartes postales. Tout n'est pas à jeter, sans doute, dans ce petit livre où l'on retrouve toutes les finesses, mais aussi toutes les naïvetés de la « nouvelle histoire suisse. » Un bémol, cependant : l'absence, quasi totale, mais effarante, de la culture (au sens large) qui s'est développée dans ce pays. Quelques noms d'écrivains, jetés ici ou là (Rousseau 1712-1778), à la sauvette, mais jamais développés, ni interrogés. Aucune mention de Georges Haldas, de Nicolas Bouvier, de Corinna Bille ! Idem pour Albert Cohen ou Denis de Rougemont, grand penseur de l'Europe. Les mêmes lacunes s'appliquent à la peinture, à la musique ou encore à l'architecture, complètement oubliées dans ce panorama de cartes postales. De telles lacunes étonnent, surtout chez un professeur d'Université.
Tout n'est pas à jeter, sans doute, dans ce petit livre où l'on retrouve toutes les finesses, mais aussi toutes les naïvetés de la « nouvelle histoire suisse. » Un bémol, cependant : l'absence, quasi totale, mais effarante, de la culture (au sens large) qui s'est développée dans ce pays. Quelques noms d'écrivains, jetés ici ou là (Rousseau 1712-1778), à la sauvette, mais jamais développés, ni interrogés. Aucune mention de Georges Haldas, de Nicolas Bouvier, de Corinna Bille ! Idem pour Albert Cohen ou Denis de Rougemont, grand penseur de l'Europe. Les mêmes lacunes s'appliquent à la peinture, à la musique ou encore à l'architecture, complètement oubliées dans ce panorama de cartes postales. De telles lacunes étonnent, surtout chez un professeur d'Université.