Alain Bagnoud Rebelle
|
|||||||||
|
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
|
|||||||||
|
Épisode 5 : où il est question de censure, de décrypter un poème et de l’île des supplices
Censure ?
 Dans le 4e épisode des Carnets, j’ai partagé un poème pour le sauver de l’oubli. Ai-je eu raison de le rendre public sur le mur de Blogres ? Un malin génie ne l’a
Dans le 4e épisode des Carnets, j’ai partagé un poème pour le sauver de l’oubli. Ai-je eu raison de le rendre public sur le mur de Blogres ? Un malin génie ne l’a
pas trouvé à son goût et l’a censuré quelques heures pour son contenu à « caractère pornographique ». C’est une plaisanterie, sans doute !
J’avais intitulé ce poème obscur, « Le viol du corbeau », car je confiais l’histoire d’un croque-mort qui m’avait ramassée sur la route de Millau dans le sud de la France et m’avait déflorée dans son corbillard verrouillé. Sa rapacité en même temps que la possibilité de mourir loin de chez moi, m’avaient paralysée. J’avais alors jugé utile de rendre cette confession publique dans la masse des témoignages de femmes revenues de loin. Ce poème ne me correspond plus aujourd’hui. J’ai survécu alors qu’il s’est figé dans un souvenir lointain. Loin de me consoler, il sert à présent de tombeau à la folie d’un homme, telle une crypte que l’on aménage dans son inconscient pour finalement l’accomplir ou la condamner.
Décrypter un poème
J’ai besoin aujourd’hui de faire sauter les verroux de ce tombeau glacé et de construire, par la magie des mots (comme mon amie Georgette), un lieu totalement libre où je trouverais une rémission de peine. Pourrais-je y parvenir par la portée des mots uniquement, jetant mon dévolu sur ceux qui donnent existence et sauvent de la déraison ? Ce lieu n’est ni utopique, ni uchronique, il rêve d’engendrer un tremblement imperceptible à la lecture, une rotation peut-être ou une transmission.
L’île des supplices
Mon imaginaire tend vers un endroit isolé, dévoile une île inaccessible. Un coin
oublié de tous, sans réseau ni wifi. L’île pourrait ressembler à Saint-Kilda* par son
climat humide et ses pluies incessantes. Un lieu déserté par les hommes, car la vie y serait impossible. Aucun arbre en vue, ni aucune plante, seule une centaine de moutons paissent en autarcie dans quelques pacages verdoyants.  C’est là, au cœur de l’égarement, que je mettrais mon agresseur. Ainsi que toutes les brutes, cogneurs et autres sadiques sexuels. Dans ce lieu qui prend forme peu à peu, malléable à volonté, je viendrai le visiter à loisir ou alors je n’y reviendrai plus. Mais je sais qu’il existera dans cet épisode de mes carnets et que dans ces pages au moins, mon agresseur sera préoccupé par la faim, le froid et l’humidité, qu’il ne portera que sa peau comme vêtement parfaitement étanche et qu’il devra piller les nids des oiseaux pour se nourrir. Il entendra en permanence au-dessus de sa tête le rire moqueur des macareux.
C’est là, au cœur de l’égarement, que je mettrais mon agresseur. Ainsi que toutes les brutes, cogneurs et autres sadiques sexuels. Dans ce lieu qui prend forme peu à peu, malléable à volonté, je viendrai le visiter à loisir ou alors je n’y reviendrai plus. Mais je sais qu’il existera dans cet épisode de mes carnets et que dans ces pages au moins, mon agresseur sera préoccupé par la faim, le froid et l’humidité, qu’il ne portera que sa peau comme vêtement parfaitement étanche et qu’il devra piller les nids des oiseaux pour se nourrir. Il entendra en permanence au-dessus de sa tête le rire moqueur des macareux.
Malgré la tentation, je ne souhaite pas envoyer tous les criminels sur une île. Pour les punir, il y a des tribunaux et des peines plus ou moins lourdes prononcées par  un système que l’on souhaite juste. Je ne connais pas le nom de mon agresseur, car je n’ai pas eu le courage de porter plainte ni de le traduire en justice. C’était peut-être un homme ordinaire, un bon père de famille. Peut-être est-il mort à présent ? Peut-être n’a-t-il jamais récidivé ? Pourrais-je me sauver sachant qu’il est transi de froid sur un rocher inhospitalier et que son foie est dévoré par une masse de folles de Bassan qui lui rappellent au quotidien ce qu’il leur a volé ?
un système que l’on souhaite juste. Je ne connais pas le nom de mon agresseur, car je n’ai pas eu le courage de porter plainte ni de le traduire en justice. C’était peut-être un homme ordinaire, un bon père de famille. Peut-être est-il mort à présent ? Peut-être n’a-t-il jamais récidivé ? Pourrais-je me sauver sachant qu’il est transi de froid sur un rocher inhospitalier et que son foie est dévoré par une masse de folles de Bassan qui lui rappellent au quotidien ce qu’il leur a volé ?
Par Pierre Béguin
Que les langues se délient, oui! Que l’on châtie les violeurs, oui! Mais que cette affaire se mette de plus en plus à dégager l’odeur nauséabonde des sorcières de Salem, non! A plus forte raison par des moyens aussi douteux que ceux du genre «dénonce ton porc!» Qui dira jusqu’où ce genre de procédés peut nous mener? Et surtout, qu’on ne vienne pas s’étonner maintenant de pratiques – pour odieuses qu’elles soient – aussi connues de tous et de toutes lorsqu’il s’agit du monde du cinéma et de la télévision (ajoutons, de la musique, de la mode, etc.). Tenez! Prenons un simple exemple: la seconde tournée américaine des Rolling Stones (juin-juillet 1972). Voici ce qu’en dit Stanley Booth, journaliste et ami du groupe:
«… Les autres attractions de la tournée comportaient un médecin ambulant, des hordes de dealers et de groupies, et de grandes scènes de sexe et de dope. Je pourrais vous décrire dans le moindre détail les saccages et les orgies dont j’ai été témoin – et auxquels j’ai participé – au cours de cette tournée, mais quand on a vu assez de nouilles sur la moquette, de flaques d’urine sur les tapis et d’organes sexuels giclant en vagues, tout finit par se confondre…».
Plus de détails? Voici ce qu’en dit Keith Richards lui-même (in: Keith Richards, Life):
«Appelons Dr Bill le médecin accompagnateur. Il était surtout là pour le cul. Et comme il était jeune et plutôt beau gosse, il en profitait un max. Il s’était fait fabriquer des cartes de visite sur lesquelles il avait écrit quelque chose comme «Dr Bill, médecin des Rolling Stones». Il se promenait dans le public avant le début du spectacle et distribuait vingt ou trente de ses cartes aux filles les plus belles, les plus sexy, même si elles étaient avec un mec. Au dos, il inscrivait le nom de notre hôtel, le numéro de la suite. Et il arrivait que des nanas maquées rentrent d’abord chez elles, puis reviennent nous voir. Le Dr Bill savait qu’il parviendrait à ses fins s’il leur promettait de nous les présenter…» Devinez la suite! Keith Richards ne dit pas tout? Citons donc François Bon dans son livre Rolling Stones, une biographie:
«La scène centrale, c’était la scène de l’avion. On a souvent ces filles qui s’accrochent à la tournée. On propose à l’une d’entre elles de les accompagner jusqu’à la ville suivante, en montant avec eux dans le DC-7. Un médecin fait partie de l’équipe, et bien sûr on le surnomme Dr Feelgood (ou Dr Bill selon Keith Richards): veut-il leur prouver qu’il n’est pas là qu’en tant que sauveteur des corps? A peine la fille dans l’avion, on la déshabille, elle se laisse faire. Aucun des membres du groupe ne participe à la suite. Mais ils sont présents et complices, puisque Jagger et Richards jouent du bongo et du tambourin tandis que le médecin s’amuse: la fille levée à bout de bras et sucée là en plein ciel, exhibée devant quinze types. On la renverra par un vol commercial retour. Elle portera plainte, on calmera l’affaire avec un chèque…» Honneur à Bill Wyman: il change de place pour aller tout à l’avant de l’avion, pose le front sur le hublot et s’y absorbe. Aurait-il pu faire mieux?
Sachant que cet exemple – depuis plus de cinquante ans que ce type de tournées rock and roll existe – peut aisément se compter en milliers, on se demande bien ce qui pourrait sortir de cette boîte de Pandore depuis que l’affaire Weinstein l’a ouverte. Il doit y en avoir en ce moment des musiciens et des chanteurs en train de trembler dans leur slip…
Pour ma part, cette affaire me renvoie huit ans plus tôt au moment où l’intelligentsia suisse accueille par un concert d’indignation l’arrestation du cinéaste Roman Polanski à la suite d’une demande d’extradition de la justice américaine (pour les faits que tout le monde connaît). Ainsi d’Ursula Meier: «Pourquoi un artiste?» Oui, tiens, c’est vrai au fond, pourquoi un artiste même s’il a sodomisé une mineure de treize ans? (tandis que pour un «vieux porc» de producteur, c’est différent). Ou de Lionel Baier: «Ce qu’il y a derrière, c’est une méconnaissance, voire un mépris des milieux culturels de ce pays. Roman Polanski laisse une trace réelle dans l’histoire de ce siècle…» (une trace qui justifie bien quelques viols, donc). Ou encore de Jacques Chessex: «Nous avons trahi Roman Polanski, nous qui sommes une terre d’asile…» (une terre d’asile qui doit donc s’ouvrir aux responsables d’actes pédophiles, pour autant qu’ils soient commis par des artistes de renom). Jacques Chessex s’excuse, il ne pourra pas me répondre, mais il en aurait eu l’occasion lorsque, en 2009, j’ai écrit sur Blogres un article sur le sujet – Polanski, ou selon que vous serez artiste ou financier), mais je serais curieux d’entendre l’opinion d’Ursula Meier ou de Lionel Baier (par exemple, tant d’autres «artistes» s’étant alors indignés de concert, probablement pour s’attirer les bonnes grâces du «Maître») sur l’affaire Weinstein. Quoi qu’il en soit, il est démontré qu’un producteur n’a pas droit au même traitement de faveur qu’un cinéaste reconnu. Et que ces pratiques odieuses n’ont pas soulevé l’indignation générale aussi longtemps que seuls des artistes célèbres en étaient accusés (Polanski, Woody Allen, etc.). Il aura fallu qu’un «gros porc» de producteur…
Eh oui, Mesdames, tout le monde savait, à commencer par vous!
par Cora O'Keeffe
Épisode 4 : où il est question de ≠changerlimaginairecollectif et d’un poème…
≠changerlimaginairecollectif
 Je lis cette semaine sur les réseaux sociaux où je viens d’ouvrir un compte Facebook, plusieurs témoignages de femmes levant le silence sur les abus de pouvoir subis au travail, à la scène ou au quotidien. Leurs paroles me saisissent dans la multitude des dépositions. Qu’elles ne restent pas lettre morte !
Je lis cette semaine sur les réseaux sociaux où je viens d’ouvrir un compte Facebook, plusieurs témoignages de femmes levant le silence sur les abus de pouvoir subis au travail, à la scène ou au quotidien. Leurs paroles me saisissent dans la multitude des dépositions. Qu’elles ne restent pas lettre morte !
J’ai écrit autrefois, dans la masse du monde, un poème qu’il me fallait préserver et qui s’accorde aujourd’hui à cette peine publique.
Nous étions dans les années 90, lorsque je participais à un atelier d’écriture organisé par la Société des écrivains de Toronto. Je lus mon poème devant le groupe évoquant un lointain voyage en autostop dans le sud de la France. Après la lecture, j’entendis les questions. L’image du corbeau n’est-elle qu’imagination ? Était-il de mauvais goût d’évoquer l’animal au lieu de nommer et de traduire en justice ? Le maccabée ne faisait-il pas basculer le poème dans le funèbre et l’exagération ? Pire le ridicule ? Que faire quand le chaos du monde vous touche ?
Un poème
Je glisse ici ce poème pour le sauver de l’oubli et l’inscris dans la mémoire collective. (Puissiez-vous le lire avec vigilance !)
LE VIOL DU CORBEAU
Le croque-mort de Millau traque la proie
Sans passion aux pieds des sept croix
Dans le noir corbillard, verrouillée
J'ai détalé hors champ
Le macchabée en bière fut un témoin sans mémoire
Il riva ce huis clos sans preuve
Ci-gisent mes vertes années, ma semaison dénaturée
fracturée entre ascension et chute
Une fois le danger écarté
Où aller vagabonder ?
Là où le désir des hommes n’existe pas ?
Chez les castrats d’Amérique ?
Dans les ghettos gays ou les études genre ?
Ou dans l’union sacrée ?
Par Pierre Béguin
Le fait est passé inaperçu et on a bien failli l’oublier: le 11 octobre 2007 paraissait le premier billet de Blogres. Il s’intitulait Teodoro ou Valdinho, vivre ou se préserver? et l’on peut toujours le consulter dans les listes de parution.
Dix ans, 5 jours, deux membres fondateurs en moins (Olivier Chiachiari et Pascal Rebetez) mais deux apports de choix (Jean-Michel Olivier et Antonin Moeri) et surtout 1222 billets plus tard, Blogres est toujours vivant. Un peu moins fringant certes, la faute à ses membres essentiellement virils, moins vigoureux, plus souvent au repos qu’apte à la besogne, et peut-être davantage occupés à labourer les sillons de l’écriture romanesque. Mais dix ans de plus justifient bien quelques signes de sénescence.
Or, donc, pour redonner à Blogres sa vigueur d’origine, nous avons admis en notre sein deux rédactrices à qui nous souhaitons une verve (désolé, pas de lapsus!) graphomaniaque intarissable: Corine Renevey et Cora O’Keeffe qui nous entretiendra de ses carnets hebdomadaires. Eh oui! Que les quelques féminocrates qui nous ont reproché (c’est tout à fait sérieux) d’être une congrégation misogyne d’affreux phallocrates aveuglés par leur libido dominandi se lèvent et rendent leurs Danettes! Pour ses dix ans, et même s’il l’avait déjà souvent fait, Blogres ouvre sa tribune – et plutôt deux fois qu’une – au sexe dit beau. Et si nous persistons (on ne se refait pas si rapidement) à douter qu’elles soient celui de l’homme, que ces dames soient au moins l’avenir de Blogres!
Cela dit, nous irons entre nous, autour d’une bonne table, fêter les dix ans de Blogres. Car ils appartiennent entièrement à Alain Bagnoud, Antonin Moeri, Jean-Michel Olivier et Pierre Béguin… Et bien entendu, à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis, nous ont lus, ont commenté nos billets (près de 3000 commentaires) que nous remercions chaleureusement et à la santé desquel(le)s nous trinquerons pour la circonstance.
Salud!
par Cora O'Keeffe
Épisode 3 : où il est question de gloires du matin, d’un hamac et d’un ermitage…
 Le manuscrit de Georgette’s Gardens * a été un hapax existentiel pour la lectrice que je suis. Je peux même dire que Cora est née de cette fascination des mots. Il suffit d’évoquer un massif de morning glories pour que ma rotation s’opère. La vigueur de leurs tiges pourtant si fines m’impressionne, tant elles sont volontaires quand elles s’enroulent autour d’un tuteur de fortune et si rapides à éclore. L’image qui en découle m’élève imperceptiblement et je me réjouis de ce bleu profond. Georgette les décrit avec une telle exactitude, une véritable sensualité que ces fleurs évoquent pour moi instantanément le jardin de mon ami Andy. Il avait loué à l’époque, dans le quartier de Little Italy à Toronto, un appartement de plain pied qui s’ouvrait sur un petit coin de verdure où il exerçait ses talents de jardinier. Je me souviens qu’il se plaignait souvent des chats du voisinage qui venaient déposer leurs crottes sur ses plates-bandes, pourquoi justement les siennes ? Mais qu’il était intarissable quand il racontait sa palissade recouverte de gloires du matin. Il m’appelait le dimanche matin avec son téléphone sans fil et se baladait pieds nus dans l’herbe, une mug de café dans l’autre main. J’imaginais sans peine le tableau qui s’offrait à nos yeux.
Le manuscrit de Georgette’s Gardens * a été un hapax existentiel pour la lectrice que je suis. Je peux même dire que Cora est née de cette fascination des mots. Il suffit d’évoquer un massif de morning glories pour que ma rotation s’opère. La vigueur de leurs tiges pourtant si fines m’impressionne, tant elles sont volontaires quand elles s’enroulent autour d’un tuteur de fortune et si rapides à éclore. L’image qui en découle m’élève imperceptiblement et je me réjouis de ce bleu profond. Georgette les décrit avec une telle exactitude, une véritable sensualité que ces fleurs évoquent pour moi instantanément le jardin de mon ami Andy. Il avait loué à l’époque, dans le quartier de Little Italy à Toronto, un appartement de plain pied qui s’ouvrait sur un petit coin de verdure où il exerçait ses talents de jardinier. Je me souviens qu’il se plaignait souvent des chats du voisinage qui venaient déposer leurs crottes sur ses plates-bandes, pourquoi justement les siennes ? Mais qu’il était intarissable quand il racontait sa palissade recouverte de gloires du matin. Il m’appelait le dimanche matin avec son téléphone sans fil et se baladait pieds nus dans l’herbe, une mug de café dans l’autre main. J’imaginais sans peine le tableau qui s’offrait à nos yeux.
Tous les week-ends, je file avec mon bien-aimé dans notre maison de vacances à Publier, en France. Sur le terrain qui mène au lac poussent deux immenses chênes, j’y ai fixé un hamac. C’est là que j’aime lire suspendue au pied de leur souveraine majesté. Aujourd’hui je m’y suis installée confortablement, emmitouflée dans une couverture bien chaude. Les feuilles commencent à tomber autour de moi, je sens leur présence dans l’air. Le ciel d’automne est d’un bleu intense. Au fur et à mesure de la lecture, j’annote les pages avec un crayon. J’y laisse des 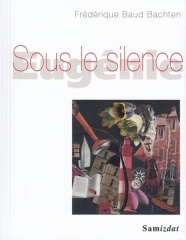 traces rudimentaires dans la marge : un trait vertical ou deux selon l’impact, une croix pour le retentissement et un cercle pour les mots qui me cognent. Parfois j’écris des commentaires dans les respirations du texte.
traces rudimentaires dans la marge : un trait vertical ou deux selon l’impact, une croix pour le retentissement et un cercle pour les mots qui me cognent. Parfois j’écris des commentaires dans les respirations du texte.
En ce moment, à l’abri des chênes, j’y ai emporté le livre d’une artiste établie à Genève qui écrit et réalise des collages *. C’est l’histoire (si j’ai bien compris, car dans toute lecture il y a des zones d’aveuglement) d’une vocation qui prend conscience de ses origines. Ici, l’auteur lie sa nécessité d’écrire au don libre et sauvage de sa grand-mère, une chanteuse d’opéra qui avait la voix d’une Lorelei.
Bien qu’elle enchantât un public aux quatre coins du monde, elle anéantissait son entourage (ses quatre enfants surtout) par ses absences et sa désertion. (Comment lui pardonner la solitude de Rose, sa fille morte à vingt ans espérant encore la revoir un jour ? J’en ai les larmes aux yeux et j’aimerais  tellement mettre Rose dans un jardin. Peut-être que Georgette m’y aidera. Je suis sûre qu’il doit y avoir un jardin à inventer pour les personnages de roman, qui sont morts trop tôt, injustement, dans une solitude orpheline.)
tellement mettre Rose dans un jardin. Peut-être que Georgette m’y aidera. Je suis sûre qu’il doit y avoir un jardin à inventer pour les personnages de roman, qui sont morts trop tôt, injustement, dans une solitude orpheline.)
L’auteur invente avec ses mots, la voix sublime qu’elle n’a pourtant jamais entendue et sonde le douloureux héritage d’Eugénie. Dénouer les fils de l’histoire familiale n’est pas sans risque, alors elle a besoin de protection, d’un espace pour écouter et accueillir la parole des ancêtres. Et ce lieu (je n’invente rien) est un jardin ! (Comme Georgette serait heureuse d’apprendre qu’il y a à Genève, un ermitage accueillant des migrants d’origine lointaine, ayant pour seul rempart, non pas des clôtures ou des haies de thuyas, mais des pivoines et des roses par-dessus lesquelles on peut se faire des signes, se saluer ! Peut-être même y a-t-il quelques gloires du matin).
par Corine Renevey
 Neuf ans après La Poupée de laine, chez le même éditeur, Frédérique Baud Bachten sort Sous le silence, Eugénie, un récit qui remonte le temps et sonde le destin de sa grand-mère paternelle, Eugénie, née à Genève en 1875.
Neuf ans après La Poupée de laine, chez le même éditeur, Frédérique Baud Bachten sort Sous le silence, Eugénie, un récit qui remonte le temps et sonde le destin de sa grand-mère paternelle, Eugénie, née à Genève en 1875.
Dans la Poupée de laine *, elle évoquait déjà la douloureuse question de la filiation à partir d’un fils « pris aux rets d’une folie sans identité » et mis sous tutelle contre son gré. D’où est venu le mal ? de quel sort jeté au travers des générations ? Dans ce récit sublime et poignant qu’il faut relire, la narratrice se débattait vertigineusement dans le piège d’une malédiction maternelle, encore pire que la folie. Le cri était lancé et le souffle venu des tripes, telle une voix lointaine, s’incarnait dans la magie des sons et la foi en un amour serein et inconditionnel.
La narration de Sous le silence, Eugénie s’est apaisée, résolument tournée vers la lumière et la réconciliation. La dernière partie du livre offre les plus belles pages de son écriture et nous révèle la naissance de sa vocation. « Cette flûte qui chante en moi, comment la mettre au monde ? Je n’ai que des rêves et des mots à ma disposition. Et si ta voix, grand-mère, me demandait simplement de répondre à ma propre vocation ? » Cette passion, elle la doit en partie à Eugénie, une grand-mère fantasque, qui a quitté le foyer conjugal et ses quatre enfants pour 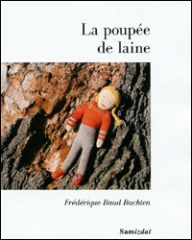 suivre sa propre destinée, le chant. Un métier qu’elle exercera dans les colonies françaises du Maghreb et d’Indochine d’où elle enverra des cartes postales et des photos d’elle en tenues de scène. Elle incarnera le rôle-titre de Carmen, cette femme libre et scandaleuse qui séduit et contrarie les principes moraux.
suivre sa propre destinée, le chant. Un métier qu’elle exercera dans les colonies françaises du Maghreb et d’Indochine d’où elle enverra des cartes postales et des photos d’elle en tenues de scène. Elle incarnera le rôle-titre de Carmen, cette femme libre et scandaleuse qui séduit et contrarie les principes moraux.
La force de ce récit est d’avoir résisté en partie aux charmes de cette aïeule artiste et avant-gardiste, car le parcours cabossé de ses descendants est marqué par l’absence d’une mère et son silence déchirant. Avait-elle le droit de les abandonner à leur sort pour vivre son art aux quatre coins du monde et de suivre sa passion égoïstement ? Si au moins elle était devenue une diva de renommée mondiale, on lui aurait un peu pardonné.
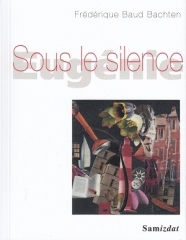 Afin de montrer l’héritage ambivalent d’Eugénie, l’auteur a trouvé l’astuce de se dédoubler. Ainsi, elle s’inscrit à la fois dans le personnage d’Émilie, la petite-fille d’Eugénie, qui se souvient de son enfance et de sa grand-mère comme d’un « silence, [d’]une suspension dans la phrase, [d’]une ellipse », et dans la voix off, qui assume le récit à la première personne, reconstituant l’histoire familiale à partir des archives laissées par sa tante. C’est elle qui interroge les fugues, les absences et l’exil qui ont imprégné son clan. C’est elle qui détient désormais la mémoire et le
Afin de montrer l’héritage ambivalent d’Eugénie, l’auteur a trouvé l’astuce de se dédoubler. Ainsi, elle s’inscrit à la fois dans le personnage d’Émilie, la petite-fille d’Eugénie, qui se souvient de son enfance et de sa grand-mère comme d’un « silence, [d’]une suspension dans la phrase, [d’]une ellipse », et dans la voix off, qui assume le récit à la première personne, reconstituant l’histoire familiale à partir des archives laissées par sa tante. C’est elle qui interroge les fugues, les absences et l’exil qui ont imprégné son clan. C’est elle qui détient désormais la mémoire et le
devoir de transmission. Là où le témoignage d’Émilie s’interrompt, la voix de l’auteur prend le relais grâce à un immense travail de reconstitution qui la mènera sur la voie de sa propre vocation, car il faut combler les manques, inviter les migrants du passé, leur inventer un lieu de paix et d’accueil, un ermitage. « Avec mon jardin de fleurs pour tout rempart que saurais-je vous offrir comme abri sur la page ? »
Sous le silence, la passion d’Eugénie est libre et sème à tous vents les graines de sa folie. Certaines fleuriront jusque sur sa tombe en signe d’approbation. Ou de pardon.
* Frédérique Baud Bachten, La Poupée de laine (Grand-Saconnex, Samizdat, 2008, 78 p.).
** Frédérique Baud Bachten, Sous le silence Eugénie (Grand-Saconnex, Samizdat, 2017, 107 p.).
par Jean-Michel Olivier
 En ce début d'automne, Corinne Desarzens n'y va pas de main morte : pas moins de trois livres, parus en même temps, portent sa signature. Il s'agit tout d'abord d'Honorée Mademoiselle*, un recueil de textes d'Emily Durham (1863-1944) réunis et traduits par Corinne Desarzens. Ensuite, il y a Couilles de velours**, au titre doucement provocateur, mosaïque littéraire qui rassemble des textes divers, dont l'unité, plus ou moins manifeste, tourne autour du sexe de l'homme. Il y a enfin Le Soutien-gorge noir***, une plongée dans le passé familial de l'auteur, de loin le livre le plus abouti des trois.
En ce début d'automne, Corinne Desarzens n'y va pas de main morte : pas moins de trois livres, parus en même temps, portent sa signature. Il s'agit tout d'abord d'Honorée Mademoiselle*, un recueil de textes d'Emily Durham (1863-1944) réunis et traduits par Corinne Desarzens. Ensuite, il y a Couilles de velours**, au titre doucement provocateur, mosaïque littéraire qui rassemble des textes divers, dont l'unité, plus ou moins manifeste, tourne autour du sexe de l'homme. Il y a enfin Le Soutien-gorge noir***, une plongée dans le passé familial de l'auteur, de loin le livre le plus abouti des trois.
On se souvient du Poisson-Tambour (Bernard Campiche éditeur, 2006), le récit haletant que Corinne Desarzens a consacré à son frère Frédéric, pêcheur sur le Léman, qui se jette un jour sous un train de la gare de Nyon.  Ce portrait en absence débouchait sur une sorte de procès au cours duquel l'auteur interrogeait ses parents et l'entourage familial (et médical). Depuis, le frère jumeau de Frédéric s'est lui aussi suicidé. Et leurs parents, Monique et Jean-Pierre, sont à leur tour décédés.
Ce portrait en absence débouchait sur une sorte de procès au cours duquel l'auteur interrogeait ses parents et l'entourage familial (et médical). Depuis, le frère jumeau de Frédéric s'est lui aussi suicidé. Et leurs parents, Monique et Jean-Pierre, sont à leur tour décédés.
 À Sète, où vivait sa famille et où il travaillait, Jean-Pierre avait un rival : Jozsef, l'allure d'un prince hongrois, venu étudier l'œnologie en France après la guerre. Jozsef va courtiser Monique, qui l'aime, mais décide un jour de lui dire non. Le prince éconduit retournera en Hongrie, où il développera avec succès de nouveaux cépages. Mais les deux amoureux continueront à s'écrire régulièrement. À la mort de Monique, la narratrice se rendra à Budapest pour rencontrer ce fameux Jozsef qui lui demandera s'il peut continuer à lui écrire, comme il écrivait à sa mère. Elle acceptera et ils échangeront des lettres ou des cartes postales jusqu'à la mort de Jozsef. Pendant huit ans.
À Sète, où vivait sa famille et où il travaillait, Jean-Pierre avait un rival : Jozsef, l'allure d'un prince hongrois, venu étudier l'œnologie en France après la guerre. Jozsef va courtiser Monique, qui l'aime, mais décide un jour de lui dire non. Le prince éconduit retournera en Hongrie, où il développera avec succès de nouveaux cépages. Mais les deux amoureux continueront à s'écrire régulièrement. À la mort de Monique, la narratrice se rendra à Budapest pour rencontrer ce fameux Jozsef qui lui demandera s'il peut continuer à lui écrire, comme il écrivait à sa mère. Elle acceptera et ils échangeront des lettres ou des cartes postales jusqu'à la mort de Jozsef. Pendant huit ans.
Le beau livre de Corinne Desarzens est à la fois une plongée dans les eaux troubles du passé et une interrogation sur le présent. Elle mène l'enquête en Hongrie, découvre les lettres de sa mère et l'allusion à ce fameux soutien-gorge noir qui donne son titre au récit. En même temps, elle fait un fait un travail de mémoire. Une mémoire fécondée par les mots, qui lui donnent corps et sens. Une mémoire — comme toujours chez Corinne Desarzens — chargée d'odeurs, de couleurs, de sensations à fleur de peau. « Je pense qu'il y a trois mémoires. De ce qui n'a jamais été : le fantasme. De ce qui a été vraiment : la vérité. De ce qu'on n'a pas pu recevoir : la réalité. On comprend si rarement les choses au moment où elles se déroulent. Juste un petit fil, imaginez. »
Pourquoi écrit-on ? Et surtout pour qui ? Il y a toujours un ou une destinataire aux lettres que l'on écrit. Les timbres hongrois illustrant la couverture du livre de Corinne Desarzens en témoignent. Parfois les lettres mettent des années pour parvenir à destination. Et la correspondance se poursuit au-delà de la mort. Elle porte en elle les cendres du passé. Et ces cendres éclairent le présent.
* Corinne Desarzens, Honorée Mademoiselle, éditions de l'Aire, 2017.
** Corinne Desarzens, Couilles de velours, éditions d'autre part, 2017.
*** Corinne Desarzens, Le soutien-gorge noir, éditions de l'Aire, 2017.
par Cora O'Keeffe
Épisode 2 : Quelles clés ouvrent l'imaginaire ?

Quel livre, suffisamment habile et riche en évocations, a la force de me transformer au point de me détourner de moi-même et de me plonger dans un exil encore plus profond que le mien ? J’aime aller à l’aventure par l’effet de paroles sortilèges, parfois nostalgiques, parfois fraîches, qui m’ébranlent et me dépouillent. J’aime la sensualité et le charme des mots sur la page, leur caractère policé, leur polyphonie baroque, leur exactitude qui s’abîme en moi dans une chute clairvoyante.
Il y a eu l’effet mystérieux du Grand Meaulnes où j’ai puisé un je ne sais quoi dans le sillon de cinq lectures consécutives, peut-être la clé d’un univers séparé, là aux confins de l’adolescence. Il y a pour moi, aujourd’hui, l’effet de Georgette’s Gardens, un manuscrit de 250 pages qui m’est parvenu le 8 septembre dernier dans ma boîte de réception électronique*. Je tiens désormais dans les mains un objet curieux dont j’explorerai ici la magie envoûtante. C’est le roman (ou un long poème) de Georgette, une bibliothécaire à la retraite, qui a trouvé dans les livres une forme de réconfort. Elle vit à Toronto (comme moi dans mon ancienne vie où je l’ai peut-être rencontrée). Dans ses carnets, elle prend des notes en anglais bien qu’elle soit française d’origine. Mot à mot, elle invente des jardins imaginaires, des lieux paisibles où elle vient se ressourcer.
Comment la magie d’un livre opère-t-elle ? Comment un manuscrit se transforme-t-il en alter ego, en âme sœur ? Comme s’il y avait un avant et un après du livre. Un hapax, disent les philosophes. Quelque chose d’unique qui nous transforme brusquement et modifie nécessairement notre histoire.
Les livres ont ce pouvoir, je le sais. Mon bien-aimé écrit des livres, c’est sa passion secrète. Il écrit sur des femmes réelles et rêvées. Il a même consacré, dans son dernier ouvrage, un chapitre à notre rencontre, dans le hall de l’hôtel Skydome de Toronto. Vittorio, mon collaborateur et ami, était là aussi, ainsi que Claude, son ami et éditeur. Le personnage qu’il décrit et qui porte mon nom dans le roman n’est pas totalement moi évidemment, même s’il est vrai que j’ai eu le cœur mitraillé quand il a quitté le groupe au bras d’Annie R. et qu’ils ont disparu tous les deux dans l’ascenseur de l’Hôtel. C’est ainsi qu’a commencé notre histoire par les livres, les mots et les lettres.
Je m’appelle Cora O’Keeffe. Je vis à Genève où j’enseigne le français et la philosophie. O’Keeffe est le nom de mon ex mari canadien.
On nous a reproché, parfois, à Blogres, d'être un club exclusivement masculin. Ce qui n'était pas faux — même si, quelquefois, nous avons ouvert nos colonnes à des contributions féminines. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureux d'accueillir parmi nous Cora O'Keeffe, enseignante d'Anglais à Genève et surtout grande lectrice. Elle nous fera partager, une fois par semaine, les plus belles pages de ses carnets.
Blogres.
Épisode 1 : Qui est Cora O'Keeffe ?
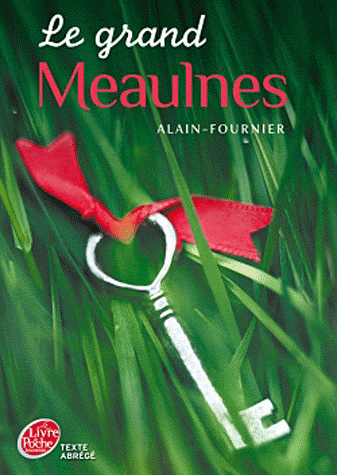 Il y a longtemps, on m’a dit que j’étais une bonne lectrice. Je peux dire aujourd’hui que j’en suis enfin fière et que je courtise dans mon cœur ce compliment venant d’un homme brillant, un Français, très érudit, décoré des palmes académiques. Un éditeur francophone pour qui je travaillais dans le Canada anglophone. Pourtant, je ne suis pas une lectrice érudite, j’aime lire et certains mots me font chavirer. Certains me font même perdre la tête. C’est pour des mots écrits sur du papier lettre de l’hôtel Skydome de Toronto que j’ai traversé l’Océan. C’est de ce ravissement que je parle quand j’aime. Parfois, d’une lecture il ne me reste presque rien, rien d’analytique en tout cas, rien que l’on pourrait saisir dans quelque schéma. Je me suis d’ailleurs souvent sentie à l’écart, en perte de mots et de perspective quand on me demande si j’ai lu tel ou tel livre. Je manque sûrement d’intelligence.
Il y a longtemps, on m’a dit que j’étais une bonne lectrice. Je peux dire aujourd’hui que j’en suis enfin fière et que je courtise dans mon cœur ce compliment venant d’un homme brillant, un Français, très érudit, décoré des palmes académiques. Un éditeur francophone pour qui je travaillais dans le Canada anglophone. Pourtant, je ne suis pas une lectrice érudite, j’aime lire et certains mots me font chavirer. Certains me font même perdre la tête. C’est pour des mots écrits sur du papier lettre de l’hôtel Skydome de Toronto que j’ai traversé l’Océan. C’est de ce ravissement que je parle quand j’aime. Parfois, d’une lecture il ne me reste presque rien, rien d’analytique en tout cas, rien que l’on pourrait saisir dans quelque schéma. Je me suis d’ailleurs souvent sentie à l’écart, en perte de mots et de perspective quand on me demande si j’ai lu tel ou tel livre. Je manque sûrement d’intelligence.
Chaque printemps je lisais Le Grand Meaulnes. Cinq années de suite à l’arrivée des beaux jours en mars quand la lumière change de teinte et devient d’une clarté éblouissante et reconnaissable entre toutes, je reprenais mon exemplaire tout écorné de l’année précédente et me mettais à le relire en pensant à Corinna Bille qui le chérissait tant. Peut-être était-ce une lecture clandestine qui ne m’était pas destinée et que j’observais avec fascination ? Peut-être était-ce un devoir de transmission qui me portait sans m’emporter ? Quelle magie a pourtant opéré alors que l’empreinte s’est fondue en moi ? Quelle trace me reste-t-il de mes lectures ? Une fête mytérieuse ? des adolescents en quête d’aventure ? un coup de foudre éclatant et explosif ? la disparition de la fiancée aux noces de Galais ?
Je m’appelle Cora O’Keefe, je suis enseignante à Genève. J’écris pour Blogres, le blog des écrivains de la Tribune de Genève qui invite la lectrice que je suis à m’exprimer en toute liberté.