Le livre de Jean-Jacques BONVIN
par antonin moeri
Incipit sans pareil. On vous raconte au présent la naissance d’un enfant dont la laideur va effrayer les parents: le colérique papa (Roland) qui fume pipe ou gitanes en lisant le journal et la mère (Jacqueline) née dans un château fribourgeois. Roland avait commencé des études de médecine vite abandonnées. Quand il rencontre Jacqueline, il est tasteur de vins. Ils sont beaux tous les deux. Mariage. Elle astique le nid.
La mère de Jacqueline a le beau rôle dans ce roman. Elle s’occupe du petit à qui elle apprendra à lire et, surtout, à aimer lire. Elle lui lira plus tard de longs passages du Cardinal de Retz, «souriant avec une certaine gourmandise aux pires mensonges et aux coups tordus les plus répréhensibles». Elle entrouvrira pour l’enfant la porte de la chambre noire où, dans l’air saturé de gaz délétères, ondule le serpent entre les jambes d’un diable «couvert de poils et d’escarres» et celles d’un Krouchtchev «en veston démantibulé et aux dents gâtées». Le père de Jacqueline, avocat célèbre, ex-préfet de la Glâne, a écrit des articles, des vers, des pièces et «des chants exaltant héroïsme agricole et constance potagère».
L’enfant inquiet, nerveux, curieux comme une fouine, ne tient pas en place. Il se vautre dans les «sermons, les prêches, les injonctions, les histoires à dormir debout» auxquels il ne croit pas mais qui le fascinent. Fascination qui n’est pas sans rappeler celle que connaît le narrateur devenu écrivain et aimant «se diluer dans le narratif venu d’ailleurs». La trottinette bleue aux pneus blancs, par exemple, a la même fonction dans ce livre que le vieux vélo Steyr-Waffenrad dans le récit «Un enfant» de Thomas Bernhard. Elle permet les échappées les plus folles, les virées les plus audacieuse dans les ruelles, aux environs et sur les remparts, jusqu’à la catastrophe que connaît le narrateur de TB sous une pluie battante, quand la chaîne du vélo se rompt, jusqu’à celle que connaît le narrateur de JJB, sous une pluie battante, quand sa trottinette va heurter un mur et que sa copine (également sur la trottinette) va se briser le crâne contre une borne de granit. Si j’attire l’attention sur la fonction de ces deux appareils de locomotion, c’est que les deux enfants, celui de JJB et celui de TB, sont perçus par leur entourage comme des affreux, des possédés, des monstres inéducables.
Dans une des plus belles pages du «Troisième animal», le lecteur entend la grand-mère lire à haute voix des histoires où il est question de Richard Coeur de Lion. «Elle lit avec la volonté têtue de bien dire, de bien prononcer, de me séduire moi, qui écoute et entends, à qui est destiné ce travail d’élocution». Cette grand-mère qui, levant les yeux du livre, se met à rire, donnant libre cours au «bonheur de se souvenir de ce qu’elle lit et a déjà lu». L’image de cette grand-mère offre un contraste poignant avec celle de la mère qui, après le déménagement de Romont (750 m) à Crans (1500 m), «où le fromage coule à flot comme le béton, où les montagnards ont appris les lois de l’offre, de la demande et de la fraude, où on élève des tours de vingt étages, des cliniques, des bowlings, où cheminent des chihuahuas perplexes entre les mains baguées de Milanaises et Parisiennes en lunettes noires et manteaux de fourrure», une mère qui, après ce funeste déménagement, disparaît de plus en plus souvent pendant que Roland descend ses canettes de bière en tapant des contrats sur une machine à écrire, une mère qui revient «plus maigre que jamais avec des yeux cernés d’opacité», sort d’un tiroir des dessins de barbus qui pourraient être des dessins de pieuvres, s’ouvre les veines avant d’être enfermée: coma insulinique, électrochocs, gavage psychotrope, profonde hébétude. Une mère qu’on retrouvera morte sur le canapé du salon.
J’ai souvent pensé à la mère du narrateur dans «Le Malheur indifférent» de Peter Handke, en suivant la trajectoire de Jacqueline. Mais d’où viennent ces barbus et ces pieuvres, ces créatures des profondeurs surgissant dans la tête de ces femmes qui, en se mariant parce que cela se fait, entrent «dans le tunnel dernier», vivent à l’ombre d’un mâle ombrageux et colérique ou seules dans un entourage hostile, puis s’effacent, maigrissent, se désintègrent, ne savent plus qui elles sont, disparaissent dans l’indifférence la plus totale? À cette question JJB ne répond pas... «Je ne sais pas comment le dire».
Jean-Jacques Bonvin: Le troisième animal, éditions d’autre part, 2014
 En 1857, après une incursion dans un bistrot populaire en compagnie d’Henry Murger (auteur des Scènes de la vie de bohème qui servira de livret à l’opéra de Puccini), les frères Goncourt ne purent déguiser le dégoût et le mépris que leur avait inspiré cette expérience: «Oui, cela est le peuple, cela est le peuple, et je le hais, dans sa misère, dans ses mains sales, dans les doigts de ses femmes piqués de coups d’aiguilles, dans son grabat à punaises, dans sa langue d’argot, dans son orgueil et sa bassesse, dans son travail et sa prostitution, je le hais dans ses vices tout crus, dans sa prostitution toute nue, dans son bouge plein d’amulettes! Tout mon moi se soulève contre des choses qui ne sont pas de mon ordre et contre des créatures qui ne sont pas de mon sang».
En 1857, après une incursion dans un bistrot populaire en compagnie d’Henry Murger (auteur des Scènes de la vie de bohème qui servira de livret à l’opéra de Puccini), les frères Goncourt ne purent déguiser le dégoût et le mépris que leur avait inspiré cette expérience: «Oui, cela est le peuple, cela est le peuple, et je le hais, dans sa misère, dans ses mains sales, dans les doigts de ses femmes piqués de coups d’aiguilles, dans son grabat à punaises, dans sa langue d’argot, dans son orgueil et sa bassesse, dans son travail et sa prostitution, je le hais dans ses vices tout crus, dans sa prostitution toute nue, dans son bouge plein d’amulettes! Tout mon moi se soulève contre des choses qui ne sont pas de mon ordre et contre des créatures qui ne sont pas de mon sang». L'ingrate venue d'ailleurs
L'ingrate venue d'ailleurs Suisses
Suisses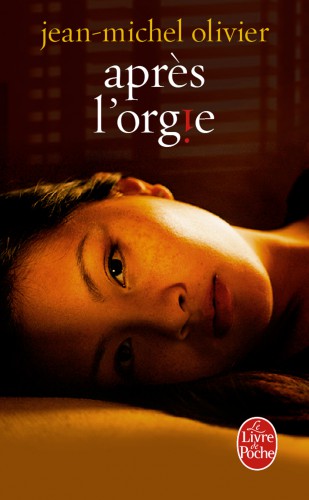
 Il y a trois manières de lire L'Echappée libre (Lectures du monde (2008-2013)
Il y a trois manières de lire L'Echappée libre (Lectures du monde (2008-2013) Le livre, sous-titré Lectures du monde, couvre les années 2008 à 2013. il s'inscrit dan un cycle qui comprend Les Passions partagées, Lectures du monde (1973-1992) (Bernard Campiche 2004), L'Ambassade du papillon, Carnets 1993-1999 (Bernard Campiche 2000), Chemins de traverse, lectures du monde 2000-2005 (Olivier Morattel 2012), Riches Heures, blog-notes 2005-2008 (L'Age d'homme).
Le livre, sous-titré Lectures du monde, couvre les années 2008 à 2013. il s'inscrit dan un cycle qui comprend Les Passions partagées, Lectures du monde (1973-1992) (Bernard Campiche 2004), L'Ambassade du papillon, Carnets 1993-1999 (Bernard Campiche 2000), Chemins de traverse, lectures du monde 2000-2005 (Olivier Morattel 2012), Riches Heures, blog-notes 2005-2008 (L'Age d'homme). 
 On n'a pas besoin d'avoir vécu dans une campagne catholique pour prendre de l'intérêt au dernier opus de Jérôme Meizoz. Mais ceux qui, comme moi, partagent avec l'auteur une mémoire transmise par les générations précédentes, sentiront en eux quelque chose s'éveiller quand ils liront Temps mort.
On n'a pas besoin d'avoir vécu dans une campagne catholique pour prendre de l'intérêt au dernier opus de Jérôme Meizoz. Mais ceux qui, comme moi, partagent avec l'auteur une mémoire transmise par les générations précédentes, sentiront en eux quelque chose s'éveiller quand ils liront Temps mort. L'objectif est que ces jeunes filles de la campagne deviennent des épouses et des mères chrétiennes, ou à défaut des vieilles filles, situation tragique, le mariage étant la seule vocation civile.
L'objectif est que ces jeunes filles de la campagne deviennent des épouses et des mères chrétiennes, ou à défaut des vieilles filles, situation tragique, le mariage étant la seule vocation civile. Réfugié à Motiers-Travers, Jean-Jacques Rousseau, le 12 mai 1763, écrit au premier syndic de Genève cette lettre qu’il vaut la peine de retranscrire dans son intégralité:
Réfugié à Motiers-Travers, Jean-Jacques Rousseau, le 12 mai 1763, écrit au premier syndic de Genève cette lettre qu’il vaut la peine de retranscrire dans son intégralité: