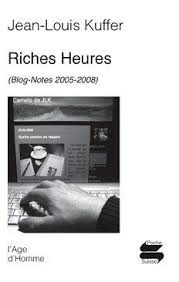1. Qui a tenu le premier journal intime ?
Comme toujours, les avis sur la question divergent.
 Certains, tel Pascal Quignard, dans ses Tablettes de buis d’Apronenia Avitia*, imaginent une patricienne romaine, à la fin du IVe siècle de notre ère, qui tient une sorte d'agenda dans lequel elle consigne les achats qu'elle projette, les rentrées d'argent, les plaisanteries, les scènes qui l'ont touchée. Pendant vingt ans elle se consacre à cette tâche méticuleuse, dédaignant de voir la mort de l'Empire, le pouvoir chrétien qui s'étend, les troupes gothiques qui investissent à trois reprises la Ville. Elle aime l'or. Elle aime la grandeur des parcs et les barques plates chargées d'amphores et d'avoine qui passent sur le Tibre. Elle aime l'odeur et la politesse du plaisir. Elle aime boire. Elle aime les hommes qui oublient de temps en temps le regard des autres hommes.
Certains, tel Pascal Quignard, dans ses Tablettes de buis d’Apronenia Avitia*, imaginent une patricienne romaine, à la fin du IVe siècle de notre ère, qui tient une sorte d'agenda dans lequel elle consigne les achats qu'elle projette, les rentrées d'argent, les plaisanteries, les scènes qui l'ont touchée. Pendant vingt ans elle se consacre à cette tâche méticuleuse, dédaignant de voir la mort de l'Empire, le pouvoir chrétien qui s'étend, les troupes gothiques qui investissent à trois reprises la Ville. Elle aime l'or. Elle aime la grandeur des parcs et les barques plates chargées d'amphores et d'avoine qui passent sur le Tibre. Elle aime l'odeur et la politesse du plaisir. Elle aime boire. Elle aime les hommes qui oublient de temps en temps le regard des autres hommes.
D’autres, moins poètes que Quignard, pensent que l’origine du journal intime est le journal de bord que doivent tenir tous les capitaines de bateaux, dans lequel ils notent scrupuleusement leur route, la force des vents, les maux ou les plaintes de l’équipage, etc. À la fois livre de bord et livre de comptes, ce document tenu jour après jour est le récit d’une traversée ou d’un voyage par-delà les mers.
Ensuite il y a, bien sûr, les fameux Essais de Montaigne, qui marquent, au XVIe siècle, l’entrée en force de l’individu dans la littérature (et la peinture, grâce aux autoportraits somptueux de Rembrandt, entre autres). Deux siècles plus tard, Rousseau fera de sa vie un roman en écrivant ses Confessions en se donnant la règle de tout dire, et dire toute la vérité.
Suivant l’exemple de Rousseau, les journaux littéraires vont se multiplier, surtout au XIXe siècle, avec le fameux Journal des frères Goncourt et le non moins fameux Journal d’Amiel (17'000 pages, quand même !), puis avec Jules Renard, André Gide, Paul Léautaud et beaucoup d’autres. Le journal littéraire connaît une telle vogue qu’il devient le modèle du journal intime.
2. Du journal au carnet
 L’entreprise monumentale de Jean-Louis Kuffer, écrivain, journaliste, chroniqueur littéraire à 24Heures, commence avec ses Passions partagées (lectures du monde 1973-1992)**, se poursuit avec la magnifique Ambassade du papillon (1993-1999), puis avec ses Chemins de traverse (2000-2005), puis avec ses
L’entreprise monumentale de Jean-Louis Kuffer, écrivain, journaliste, chroniqueur littéraire à 24Heures, commence avec ses Passions partagées (lectures du monde 1973-1992)**, se poursuit avec la magnifique Ambassade du papillon (1993-1999), puis avec ses Chemins de traverse (2000-2005), puis avec ses 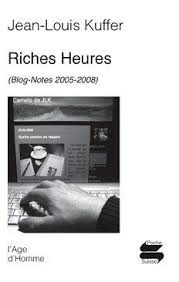 Riches Heures (2005-2008) pour arriver à cette Échappée libre (2008-2013) qui vient de paraître aux éditions l’Âge d’Homme.
Riches Heures (2005-2008) pour arriver à cette Échappée libre (2008-2013) qui vient de paraître aux éditions l’Âge d’Homme.
Ce monument de près de 2500 pages est unique en son genre, non seulement dans la littérature romande, mais aussi dans la littérature française. Il se rapproche du journal d’un Paul Léautaud ou d’un Jules Renard, mais il est, à mon sens, encore plus que cela. Il ne s’agit pas seulement de consigner, au jour le jour, des impressions de lecture, des états d’âme, des réflexions sur l’air du temps, mais bien de construire le socle sur lequel reposera sa vie.
À la base de tout, il y a les carnets, « ma basse continue, la souche et le tronc d’où relancer tous autres rameaux et ramilles. »
Ces carnets, toujours écrits à l’encre verte et souvent enluminés de dessins ou d’aquarelles, comme les manuscrits du Moyen Âge, qui frappent par leur aspect monumental, sont aussi le meilleur document sur la vie littéraire de ces quarante dernières années : une lecture du monde sans cesse en mouvement et en bouleversement, subjective, passionnée, empathique. Indispensable.
III. Une passion éperdue
Ces carnets se déploient sur plusieurs axes : lectures, rencontres, voyages, écriture, chant du monde, découvertes.
Les lectures, tout d’abord : une passion éperdue.
 Personne, à ma connaissance, ne peut rivaliser avec JLK (à part, peut-être, Claude Frochaux) dans la gloutonnerie, l’appétit de lecture, la soif de nouveauté, la quête d’une nouvelle voix ou d’une nouvelle plume ! Dans L’Échappée libre, tout commence en douceur, classiquement, si j’ose dire, par Proust et Dostoïevski, qu’encadre l’évocation touchante du père de JLK, puis de sa mère, donnant naissance aux germes d’un beau récit, très proustien, L’Enfant prodigue (paru en 2011 aux éditions d’Autre Part de Pascal Rebetez). On le voit tout de suite : l’écriture (ou la littérature) n’est pas séparée de la vie courante : au contraire, elle en est le pain quotidien. Elle nourrit la vie qui la nourrit.
Personne, à ma connaissance, ne peut rivaliser avec JLK (à part, peut-être, Claude Frochaux) dans la gloutonnerie, l’appétit de lecture, la soif de nouveauté, la quête d’une nouvelle voix ou d’une nouvelle plume ! Dans L’Échappée libre, tout commence en douceur, classiquement, si j’ose dire, par Proust et Dostoïevski, qu’encadre l’évocation touchante du père de JLK, puis de sa mère, donnant naissance aux germes d’un beau récit, très proustien, L’Enfant prodigue (paru en 2011 aux éditions d’Autre Part de Pascal Rebetez). On le voit tout de suite : l’écriture (ou la littérature) n’est pas séparée de la vie courante : au contraire, elle en est le pain quotidien. Elle nourrit la vie qui la nourrit.
Dans ses lectures, JLK ne cherche pas la connivence ou l’identité de vues avec l’auteur qu’il lit, plume en main, et commente scrupuleusement dans ses carnets, mais la correspondance. C’est ce qu’il trouve chez Dostoiëvski, comme chez Witkiewicz, chez Thierry Vernet comme chez Houellebecq ou Sollers (parfois).  Souvent, il trouve cette correspondance chez un peintre, comme Nicolas de Stäël, par exemple. Ou encore, au sens propre du terme, dans les lettres échangées avec Pascal Janovjak, jeune écrivain installé à Ramallah, en Palestine. La correspondance, ici, suppose la distance et l’absence de l’autre — à l’origine, peut-être, de toute écriture.
Souvent, il trouve cette correspondance chez un peintre, comme Nicolas de Stäël, par exemple. Ou encore, au sens propre du terme, dans les lettres échangées avec Pascal Janovjak, jeune écrivain installé à Ramallah, en Palestine. La correspondance, ici, suppose la distance et l’absence de l’autre — à l’origine, peut-être, de toute écriture.
De la Désirade, d’où il a une vue plongeante sur le lac et les montagnes de Savoie, JLK scrute le monde à travers ses lectures. Il lit et relit sans cesse ses livres de chevet, en quête d’un sens à construire, d’une couleur à trouver, d’une musique à jouer. Car il y a dans ses carnets des passages purement musicaux où les mots chantent la beauté du monde ou la chaleur de l’amitié.
Un exemple parmi cent : « Donc tout passe et pourtant je m’accroche, j’en rêve encore, je n’ai jamais décroché : je rajeunis d’ailleurs à vue d’œil quand me vient une phrase bien bandante et sanglée et cinglante — et c’est reparti pour un Rigodon.. On ergote sur le style, mais je demande à voir : je demande à le vivre et le revivre à tout moment ressuscité, vu que c’est par là que la mémoire revit et ressuscite — c’est affaire de souffle et de rythme et de ligne et de galbe, enfin de tout ce qu’on appelle musique et qui danse et qui pense. »
* Jean-Louis Kuffer, L'Échappée libre, lectures du monde (2008-2013), L'Âge d'Homme, 2014.
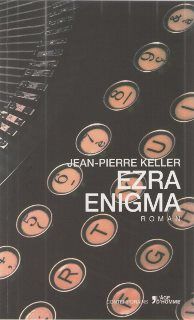









 e passe mal. Puis le contact se noue par lettres. Mais Bryan meurt d'une overdose avant la deuxième visite. Entre temps, il avait expédié au peintre quelques travaux artistiques faits dans un séminaire de création. Rien d'intéressant, sinon un auto-portrait que le peintre va reprendre, reproduire en une série qui revivifie son œuvre en la poussant vers l'humain et les mots.
e passe mal. Puis le contact se noue par lettres. Mais Bryan meurt d'une overdose avant la deuxième visite. Entre temps, il avait expédié au peintre quelques travaux artistiques faits dans un séminaire de création. Rien d'intéressant, sinon un auto-portrait que le peintre va reprendre, reproduire en une série qui revivifie son œuvre en la poussant vers l'humain et les mots.
 Retrouvailles à la fois émotionnelles et difficiles, car le temps n’efface pas les blessures. Pourtant, JLK ne ferme jamais la porte aux amis d’autrefois et le pardon trouve toujours grâce à ses yeux.
Retrouvailles à la fois émotionnelles et difficiles, car le temps n’efface pas les blessures. Pourtant, JLK ne ferme jamais la porte aux amis d’autrefois et le pardon trouve toujours grâce à ses yeux.