Toast à Pierre-Yves Lador, Prix des Écrivains vaudois 2013
par Jean-Michel Olivier
 Si, un jour, quelqu’un vient sonner à votre porte, un grand escogriffe barbu, un peu hirsute, en salopettes de jardinier, qui se prétend poète, par exemple, réfléchissez bien avant d’ouvrir ! Car il pourrait non seulement vous en cuire, mais surtout il se peut qu’il vous fasse découvrir des plaisirs dont vous ne soupçonniez pas même l’existence.
Si, un jour, quelqu’un vient sonner à votre porte, un grand escogriffe barbu, un peu hirsute, en salopettes de jardinier, qui se prétend poète, par exemple, réfléchissez bien avant d’ouvrir ! Car il pourrait non seulement vous en cuire, mais surtout il se peut qu’il vous fasse découvrir des plaisirs dont vous ne soupçonniez pas même l’existence.
Certains écrivains tissent leur toile comme les araignées. C’est une question de mailles et de coutures, de pièces rapportées, de plis et de faux plis, d’ourlets. Le lecteur aime à se prendre dans leurs fils avant, parfois, de se faire dévorer tout cru — ou tout cuit.
D’autres écrivains construisent leur maison avec des mots. Elle est vaste comme une église ou secrète comme une chapelle. Parfois, elle ne comporte pas de fenêtre. Mais le plus souvent elle est percée d’une multitude de portes. On peut y pénétrer de plusieurs manières.
« À peine la porte poussée, je me trouvai dans une espèce de bulle mouvante, souple et ferme, translucide. Je m’avançai vers une ouverture qui donnait sur une nouvelle bulle disposant de trois ouvertures.  Il s’agissait d’une espèce d’architecture de mousse, chuchotant ou chuintant, crissant, se balançant doucement. »*
Il s’agissait d’une espèce d’architecture de mousse, chuchotant ou chuintant, crissant, se balançant doucement. »*
La maison de Pierre-Yves Lador est donc faite de mots, qui sont autant de portes ouvertes ou entrouvertes sur des multiples labyrinthes. Les mots s’ouvrent comme des portes, donc. Comme des fleurs aussi. De là vient la lumière. Le parfum des mots et des roses. Et ils ouvrent, à leur tour, ces mots, sur d’autres mots, qui s’ouvrent et guident le lecteur.
On n’est plus dans le texte tissé par un maître tisserand, mais dans une architexture sonore où tout n’est que seuils et embrasures, serrures et mots-clés — et caisses de résonance.
« Les portes n’ouvrent pas seulement un destin, mais des millions d’autres. Colomb ouvre la porte de la mondialisation, Sade la porte de la prison édénique et en tuant dieu, tue l’homme, Freud ouvre la porte de la peste, Jung la porte de la connaissance, Dali la porte cannibale, True Blood la porte animale… »
Ouvrir sa porte, mesdames, à l’inconnu qui vient frapper, à l’alien, à l’étranger, au poète un peu hirsute, mais beau parleur venu vendre ses livres, cela vous expose donc à toutes sortes de périls !
 « Viens, la poésie je ne sais pas ce que c’est et tu ne fais pas tout ça pour vendre ta brochure à dix balles ! Est-ce que les autres t’en achètent ? Je dis que oui. Je remarquai alors que la porte comportait un verrou à cinq pênes et une barre de sécurité debout, inerte, dans l’encoignure et réalisai qu’elle ne les avait pas utilisés, se fiant à son petit verrou ordinaire. »
« Viens, la poésie je ne sais pas ce que c’est et tu ne fais pas tout ça pour vendre ta brochure à dix balles ! Est-ce que les autres t’en achètent ? Je dis que oui. Je remarquai alors que la porte comportait un verrou à cinq pênes et une barre de sécurité debout, inerte, dans l’encoignure et réalisai qu’elle ne les avait pas utilisés, se fiant à son petit verrou ordinaire. »
Les serrures, les verrous, les chambranles, les bobinettes comme les fermetures-éclair ne résistent pas longtemps au poète qui sait jongler avec les mots. Et bientôt les dernières digues sautent, si j’ose dire, les corps se mêlent dans un mélange sans confusion de salive et de sperme.
« Je humai, goûtai, regardai, auscultai. Nos doigts ne se démêlaient que pour s’enfiler, s’insinuer, s’enfoncer, glisser, limer, frotter, polir, pincer, griffer, s’accrocher, prendre, se faire aspirer avant d’être léchées comme des sucettes roses. Meilleurs ouvriers, nous passions sans cesse de l’animalité la plus faunesque à l’humanité la plus éclatée, entre fesses, orteils et oreilles, sauvages et empathiques. »
Au passage, relevons le glissement du langage cru animal aux mots cuits de l’humain. Toute la poétique de Pierre-Yves Lador se cache dans ce glissement progressif vers le plaisir promis et suggéré par les mots.
C’est encore une porte qui s’ouvre sur l’inconnu.
« L’érotisme est une voie entre les mondes, dit Éliane, la grande prêtresse de l’amour. Désirer, c’est ouvrir la porte. Après, il faut passer le seuil…
— et revenir…
— Si l’on veut, mais ne pense pas à revenir quand tu veux partir. Tu n’es pas de ces obsessionnels qui doivent défaire leurs pas pour revenir par le même chemin, comme on défait un tricot, pour refaire le peloton matriciel, le retour, s’il y en a un, se fait toujours en avançant, par un chemin neuf, neuf pour toi, toujours plus loin même si tu crois retourner ou rester immobile. La rivière est sans retour. »
 Ouvrir sa porte à l’inconnu, mesdames, c’est courir le risque d’être découvert (ou découverte).
Ouvrir sa porte à l’inconnu, mesdames, c’est courir le risque d’être découvert (ou découverte).
D’être entraîné dans un labyrinthe de mots au cœur duquel, bien entendu, veille le Minotaure, la bête humaine, l’homme au désir animal. Mais c’est aussi, pour Pierre-Yves Lador, une chance unique d’accéder à la connaissance, au cœur secret des choses, à l’essence de l’homme qui se révèle par la chair et les mots.
Une crue de mots — parfois très crus — qui vous emportent dans leur sillage vers des tropiques où l’homme cuit sous le soleil, barbu un peu hirsute, un petit livre de poèmes à la main.
* Pierre-Yves Lador, Chambranles et embrasures, édition de l'Aire, 2013.
et La Guerre des Légumes, éditions Olivier Morattel, 2012.
 Est-on forcément soi-même le meilleur dépositaire en mémoire de ce qu’on représente? A la lecture de l’énorme biographie de Keith Richards, Prix Norman Mailer 2011 (associé en la circonstance au journaliste américain James Fox), j’aurais tendance à répondre par la négative. Il est vrai que ma lecture a souffert de la comparaison avec le livre de François Bon Rolling Stones, une biographie dont j’avais fait un commentaire dans Blogres l’année dernière (
Est-on forcément soi-même le meilleur dépositaire en mémoire de ce qu’on représente? A la lecture de l’énorme biographie de Keith Richards, Prix Norman Mailer 2011 (associé en la circonstance au journaliste américain James Fox), j’aurais tendance à répondre par la négative. Il est vrai que ma lecture a souffert de la comparaison avec le livre de François Bon Rolling Stones, une biographie dont j’avais fait un commentaire dans Blogres l’année dernière (




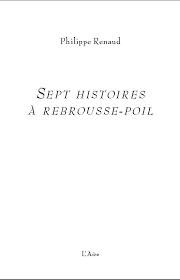 Le professeur Renaud, mon ami et mon maître, s'amuse et nous instruit. Ses histoires à rebrousse-poil, d'une fantaisie charmeuse et d'une plaisante érudition, interrogent quelques notions constitutives de l'identité (le nom, le lieu, le sexe, le rêve, le voyage...) sous une forme passionnante.
Le professeur Renaud, mon ami et mon maître, s'amuse et nous instruit. Ses histoires à rebrousse-poil, d'une fantaisie charmeuse et d'une plaisante érudition, interrogent quelques notions constitutives de l'identité (le nom, le lieu, le sexe, le rêve, le voyage...) sous une forme passionnante.






