virus tébé
par antonin moeri
Comme Hervé Guibert, Horacio Castellanos Moya et tant d’autres écrivains de par le monde, Gemma Salem fut infectée par le virus Thomas Bernhard. Infection dont il est difficile de se débarrasser, tant le pouvoir pathogène de cette particule organique est grand. Pour tenter, non pas de guérir, mais de circonscrire cette maladie, Gemma Salem a choisi d’écrire une lettre à l’hermite autrichien.
A la fin du siècle passé et après avoir lu «Oui» et «L’origine», Gemma Salem eut le sentiment de ne plus vivre qu’à travers Tébé. Ce que l’auteur de la lettre vise ici, ce n’est pas le dithyrambe (bouillie infecte que Tébé aurait exécrée) mais une tentative d’explication. Il y a d’abord le rire, l’humour comme signe d’intelligence, alors que la presse dite littéraire ne voyait en Tébé qu’un auteur «sombre, caustique, pessimiste, misogyne et difficile». Cet homme au rire dévastateur, elle veut le rencontrer et, pour réaliser ce projet, elle se rend en Autriche. Elle convoque les souvenirs d’enfance de Tébé pour les confronter à ses propres souvenirs d’enfance. Expériences communes: tentatives de suicide, désert affectif, déréliction, difficulté à aimer les autres, besoin d’accuser les siens, phobie d’être de trop. A Salzbourg, elle imagine que Tébé a bu dans le verre de bière qu’elle tient à la main. Elle écoute «les pas d’un fêtard scander le pavé». Elle voudrait visiter Scherzhauserfeld, «ce quartier maudit, cité des pauvres, des criminels, des ivrognes» où Tébé, après avoir tourné le dos à cette machine à abrutir qu’est le lycée, fit un apprentissage dans l’épicerie de Podlaha, elle voudrait visiter ce quartier mais personne ne sait où il se trouve.
Elle se souvient alors de ses errances à travers l’Europe, après avoir échappé aux griffes de sa mère restée en Iran. Mineure, inculte, munie d’un passeport qui lui attire les pires ennuis, elle cueille des fraises pour gagner sa vie, promène des chiens, garde des enfants, danse dans des boîtes de nuit en Allemagne et en Hollande. Ces tournées dans les cabarets, elle les compare au travail de Tébé dans l’épicerie, expériences qui nous en apprennent plus sur la vie et le caractère des êtres humains que les études universitaires. Elle découvre Tchekhov, Dosto, Lermontov, Tourgueniev puis, à Genève, entre à l’ONU comme dactylo. Elle suit des cours au Conservatoire d’art dramatique de Lausanne, ville qu’elle ne tarde pas à détester. «La méfiance primaire, l’autosatisfaction étaient des virus dans l’air de Lausanne». Elle évoque le Pont Bessières, d’où se jetaient les gens désespérés comme, à Salzbourg, ils se jetaient du Mönchsberg.
Dans le village où habite Tébé, on lui dit qu’il n’est pas là, qu’il est à Vienne ou à Majorque. A Vienne, elle arpente la Kärtnerstrasse, fréquente les tavernes sombres, toujours en quête de son auteur favori. Quelques digressions sur la musique, puisque Tébé connaissait la musique mieux que n’importe qui. Au Burgtheater, elle assiste à la représentation d’une pièce de Tébé. Immenses éclats de rire dans la salle pendant que d’autres spectateurs, offusqués, quittent cette salle.
De retour dans le Sud de la France, où Gemma possédait une maison, elle rit à gorge déployée avec Lawrence Durell, son voisin qui ne se prenait pas au sérieux, qui aimait dénigrer tout le monde et avec qui Gemma devait faire un voyage en Bourgogne. Elle tombe malade: tendinite traumatique. Après avoir relu plusieurs fois «Holzfällen» (Des arbres à abattre), elle décide de retourner en Autriche avec un sac rempli de livres de Tébé et une énorme boîte de Voltarène. Elle loue une chambre dans une auberge en face de la forteresse de Tébé qu’elle imagine assis dans un fauteuil en fer, les épaules entourées de la vieille couverture de cheval héritée de son grand-père.
Pour soulager ses douleurs, elle consulte le frère de l’écrivain, généraliste installé là. Dans un épais cahier, elle se met à écrire ce qui deviendra la «Lettre à l’hermite autrichien» et, à défaut de s’entretenir avec Tébé, c’est avec la soeur de l’écrivain et avec le docteur Fabjan (frère de l’écrivain) qu’elle le fait. Ce frère lui apprend qu’elle a un nerf ruiné par l’arthrose, «qu’une opération serait peut-être nécessaire». Elle ne cesse de se promener. «Tout ce que je veux bien voir doit obligatoirement alimenter cette frustration obscure qui se met à ressembler à du désespoir».
Tébé compte énormément pour le docteur Fabjan, c’est pourquoi il s’entend bien avec Gemma qu’il soigne gratuitement. La seule fois où elle voit Tébé de près, c’est dans un café où il lui dit qu’il va partir au Portugal. En voyant de près l’objet de son noir désir, elle se rend compte qu’il est «l’épicentre absolu de la tendinite». Elle termine son récit en comparant la maladie de Tébé à la sienne. Elle se demande si ces maladies n’ont pas été la conséquence de leur aversion pour la société.
Gemma Salem adopte un ton détaché pour évoquer dans cette longue lettre (que TB aurait lue avant de mourir) la perturbation que la lecture des livres de l’hermite a provoquée dans sa vie. Exercice d’admiration qui en dit autant sur la vie et l’oeuvre de TB que sur la vie et l’oeuvre de GS, et qui entraîne le lecteur dans l’histoire de deux solitudes qui ne pouvaient se rencontrer. On est toujours déçu quand on rencontre l’écrivain qui nous fascine, me confiait Peter Handke sur la terrasse de l’Apollinaire à Saint-Germain-des-Prés.
Gemma Salem: Lettre à l’hermite autrichien, La Tablée ronde, 1989
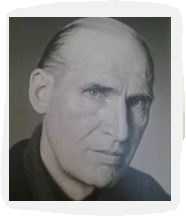 Le nom de C.– F. Landry se limitait dans ma mémoire à un vague rappel de ces livres d’école primaire où l’on apprenait vocabulaire et grammaire à l’aide d’un pot-pourri de phrases d’auteurs. Et c’est peut-être pour cette raison même que je n’ai jamais cherché à en savoir plus: C. – F. c’était forcément pour Charles-Ferdinand, un sous produit de l’autre – du nôtre donc –, du vrai, du seul, de l’unique... Jusqu’à ce que les Editions Campiche ne publient l’année dernière en collection de poche L’Affaire Henri Froment au moment où médias et lecteurs n’étaient préoccupés que par la vérité d’une autre Affaire (cet automne, c’est au tour La Devinaize, le roman le plus célèbre de C- F. Landry, de sortir en camPoche).
Le nom de C.– F. Landry se limitait dans ma mémoire à un vague rappel de ces livres d’école primaire où l’on apprenait vocabulaire et grammaire à l’aide d’un pot-pourri de phrases d’auteurs. Et c’est peut-être pour cette raison même que je n’ai jamais cherché à en savoir plus: C. – F. c’était forcément pour Charles-Ferdinand, un sous produit de l’autre – du nôtre donc –, du vrai, du seul, de l’unique... Jusqu’à ce que les Editions Campiche ne publient l’année dernière en collection de poche L’Affaire Henri Froment au moment où médias et lecteurs n’étaient préoccupés que par la vérité d’une autre Affaire (cet automne, c’est au tour La Devinaize, le roman le plus célèbre de C- F. Landry, de sortir en camPoche). Jean-Yves Dubath, dont j'apprécie l'écriture (voir
Jean-Yves Dubath, dont j'apprécie l'écriture (voir  C'est érudit, labyrinthique, étrange, charmeur, déconcertant, obscur, plein de nostalgie, d'amour et de désir, de noms à demi-oubliés et de scènes suggérées. Du coup, le lecteur est ravi, décontenancé ou complètement perdu, surtout si, comme moi, il n'a que quelques souvenirs vagues de certains des films de Rainer Werner Fassbinder.
C'est érudit, labyrinthique, étrange, charmeur, déconcertant, obscur, plein de nostalgie, d'amour et de désir, de noms à demi-oubliés et de scènes suggérées. Du coup, le lecteur est ravi, décontenancé ou complètement perdu, surtout si, comme moi, il n'a que quelques souvenirs vagues de certains des films de Rainer Werner Fassbinder.

