4 4 3 3 au Miel de l'Ours
Par Alain Bagnoud
 4 4 3 3. C'est le titre énigmatique de ce recueil publié au Miel de l'Ours. Des chiffres qui livrent leur secret quand on en arrive au sous-titre : anthologie du sonnet romand contemporain.
4 4 3 3. C'est le titre énigmatique de ce recueil publié au Miel de l'Ours. Des chiffres qui livrent leur secret quand on en arrive au sous-titre : anthologie du sonnet romand contemporain.
4 4 3 3 : deux quatrains et deux tercets. La forme poétique française classique par excellence.
Pour fêter ses 25 premiers ouvrages parus et dresser un petit état des lieux récent et local du sujet, l'éditeur Patrice Duret a donc demandé à 54 auteurs contemporains de se pencher sur les quatorze vers traditionnels, chacun gardant toute liberté d'interpréter la contrainte à sa guise, mais en respectant la disposition typographique classique. Le résultat donne un panorama intéressant et varié de la poésie actuelle en Suisse romande.
On y trouve des auteurs parnassiens, comme notre ami Jean-Michel Olivier, qui a choisi rigoureusement l'alexandrin, a respecté un système de rimes suffisantes ou riches, se fixant une dépendance supplémentaire en n'en gardant que deux (« Sur la scène apprêtant le corps nu du ballet, / Elle passe, éventail, d'un mouvement allègre, / Parmi les arlequins et les danseuses nègres/ Voguant de bras en bras... »).
 Il y a les avant-gardistes facétieux, comme Ramiro Chiriotti, dans un poème librement inspiré de Barbara, de Jacques Prévert, et qu'on peut chercher à décrypter (« 25/8 ' 25/9 32/4 2/ 2/8, / 31/1 31/2, 31/1 33/3, 1/3 » etc.)
Il y a les avant-gardistes facétieux, comme Ramiro Chiriotti, dans un poème librement inspiré de Barbara, de Jacques Prévert, et qu'on peut chercher à décrypter (« 25/8 ' 25/9 32/4 2/ 2/8, / 31/1 31/2, 31/1 33/3, 1/3 » etc.)
Et entre deux, il y a tout l'éventail de la créativité, dans les sujets et dans la forme. On trouve des observations ironiques (Rue du Jura d'Alain Boyer), de l'exotisme (Sonnet aux chardons de Nicolas Couchepin), un moment quotidien aux saveurs de haïku (Crépuscule de Catherine Fuchs), une évocation de mère défunte (Pierre Voélin), un acrostiche autobiographique (Jacques Zürcher)... Bien d'autres choses encore.
Variété de tons, mais aussi de position, de proximité ou de distance par rapport au sonnet, entre la révérence à la forme fixe, le jeu sur la tradition ou la mise à distance amusée.
C'est le mélange qui fait le prix, crée la surprise, provoque la découverte. Un mélange qui rend ce petit recueil passionnant.
4 4 3 3, Anthologie du sonnet romand contemporain, Le Miel de l'Ours.
 Il y a longtemps, dans l’autre siècle, mais c’était hier, je musardais dans une librairie de Genève. J’étais jeune étudiant. J’avais des maîtres prestigieux : Jean Starobinski, Michel Butor, Georges Steiner. À l’Université, il n’y avait de bonne littérature que française. Ramuz mis à part, l’on ne connaissait pas un seul nom d’écrivain romand. « La honte ! » dirait ma fille.
Il y a longtemps, dans l’autre siècle, mais c’était hier, je musardais dans une librairie de Genève. J’étais jeune étudiant. J’avais des maîtres prestigieux : Jean Starobinski, Michel Butor, Georges Steiner. À l’Université, il n’y avait de bonne littérature que française. Ramuz mis à part, l’on ne connaissait pas un seul nom d’écrivain romand. « La honte ! » dirait ma fille. Il est allé chercher dans les rayons un roman d’Étienne Barillier, un autre de Gaston Cherpillod et de Nicolas Bouvier et, finalement, un livre intitulé Un Hiver en Arvèche*
Il est allé chercher dans les rayons un roman d’Étienne Barillier, un autre de Gaston Cherpillod et de Nicolas Bouvier et, finalement, un livre intitulé Un Hiver en Arvèche*

 Son Conseiller d'état à lui a plusieurs casseroles. Une comptabilité douteuse. Un achat de terrain contestable. Une sexualité débordante. Marié avec deux filles, il entretient des relations avec Sonia, maîtresse régulière. On le voit régulièrement au cabaret. Il assiste à des spectacles ou passe des moments en privé avec les hôtesses. Enfin, il fréquente le discret établissement de Madame F. qui lui organise des séances sado-masochistes.
Son Conseiller d'état à lui a plusieurs casseroles. Une comptabilité douteuse. Un achat de terrain contestable. Une sexualité débordante. Marié avec deux filles, il entretient des relations avec Sonia, maîtresse régulière. On le voit régulièrement au cabaret. Il assiste à des spectacles ou passe des moments en privé avec les hôtesses. Enfin, il fréquente le discret établissement de Madame F. qui lui organise des séances sado-masochistes. La vie de Boris Cyrulnik est un roman, tragique et édifiant. Longtemps, ce roman est resté prisonnier d'une crypte, enfermé dans les oubliettes de sa mémoire. Il en savait des bribes. Il essayait de mettre bout à bout les images de ce film demeuré trop longtemps muet. Car pour attester un souvenir, surtout lointain et flou, il faut la présence d'un témoin. Sinon, la folie guette à chaque instant…
La vie de Boris Cyrulnik est un roman, tragique et édifiant. Longtemps, ce roman est resté prisonnier d'une crypte, enfermé dans les oubliettes de sa mémoire. Il en savait des bribes. Il essayait de mettre bout à bout les images de ce film demeuré trop longtemps muet. Car pour attester un souvenir, surtout lointain et flou, il faut la présence d'un témoin. Sinon, la folie guette à chaque instant… Sa mère (à droite, avec Boris âgé d'un an) suivra hélas le même chemin sans retour. Il s'en faut de très peu pour que le petit Boris, parqué avec d'autres Juifs dans une synagogue, parte à son tour pour les camps de la mort. Mais il parvient à s'échapper. Une infirmière le cache sous un matelas, sur lequel agonise une jeune femme qu'on transporte à l'hôpital. C'est sa chance. À partir de ce moment-là, la vie de Boris Cyrulnik est une suite de miracles. Ou, si l'on veut, de circonstances heureuses et cependant tragiques. « Mon existence a été charpentée par la guerre. Ai-je vraiment mérité la mort ? Qui suis-je pour avoir pu survivre ? Ai-je trahi pour avoir le droit de vivre ? »
Sa mère (à droite, avec Boris âgé d'un an) suivra hélas le même chemin sans retour. Il s'en faut de très peu pour que le petit Boris, parqué avec d'autres Juifs dans une synagogue, parte à son tour pour les camps de la mort. Mais il parvient à s'échapper. Une infirmière le cache sous un matelas, sur lequel agonise une jeune femme qu'on transporte à l'hôpital. C'est sa chance. À partir de ce moment-là, la vie de Boris Cyrulnik est une suite de miracles. Ou, si l'on veut, de circonstances heureuses et cependant tragiques. « Mon existence a été charpentée par la guerre. Ai-je vraiment mérité la mort ? Qui suis-je pour avoir pu survivre ? Ai-je trahi pour avoir le droit de vivre ? » Rousseau ne fait pas autre chose dans ses Confessions. Il cherche moins à se faire pardonner des fautes vénielles qu'à réenchanter son passé, afin de chercher à comprendre qui il est à présent. « Le mot « représentation » est vraiment celui qui convient. Les souvenirs ne font pas revenir le réel, ils agencent des morceaux de vérité pour en faire une représentation dans notre théâtre intime. Quand nous sommes heureux, nous allons chercher dans notre mémoire quelques fragments de vérité que nous assemblons pour donner cohérence au bien-être que nous ressentons. En cas de malheur, nous irons chercher d'autres mocreaux de vérité qui donneront, eux aussi, une autre cohérence à notre souffrance. »
Rousseau ne fait pas autre chose dans ses Confessions. Il cherche moins à se faire pardonner des fautes vénielles qu'à réenchanter son passé, afin de chercher à comprendre qui il est à présent. « Le mot « représentation » est vraiment celui qui convient. Les souvenirs ne font pas revenir le réel, ils agencent des morceaux de vérité pour en faire une représentation dans notre théâtre intime. Quand nous sommes heureux, nous allons chercher dans notre mémoire quelques fragments de vérité que nous assemblons pour donner cohérence au bien-être que nous ressentons. En cas de malheur, nous irons chercher d'autres mocreaux de vérité qui donneront, eux aussi, une autre cohérence à notre souffrance. » On comprend mieux, en lisant l'autobiographie de Boris Cyrulnik, comment et pourquoi il en est venu à forger le concept essentiel de résilience. Sa vie est l'exemple et la preuve de cette capacité extraordinaire de résistance au malheur. Et cette résistance passe par la parole qui nous aide à représenter le malheur, pour mieux le tenir à distance et le neutraliser. Voilà pourquoi, même dans les circonstances les plus tragiques, la vie appelle toujours à se sauver.
On comprend mieux, en lisant l'autobiographie de Boris Cyrulnik, comment et pourquoi il en est venu à forger le concept essentiel de résilience. Sa vie est l'exemple et la preuve de cette capacité extraordinaire de résistance au malheur. Et cette résistance passe par la parole qui nous aide à représenter le malheur, pour mieux le tenir à distance et le neutraliser. Voilà pourquoi, même dans les circonstances les plus tragiques, la vie appelle toujours à se sauver.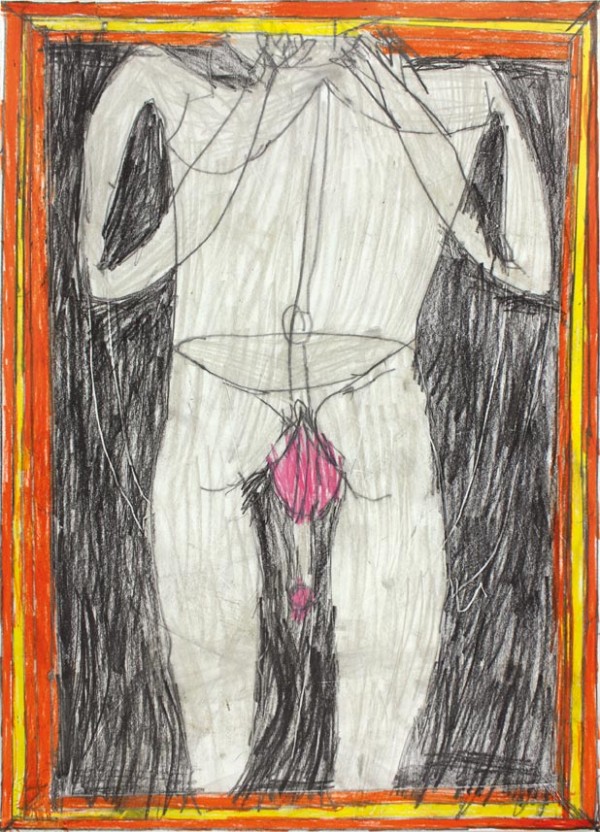
 Dans La Généalogie de la morale, le philosophe Friedrich Nietzsche, à partir d’une analogie phonétique en allemand, établit un lien entre le concept fondamental de la morale Schuld (la faute) et le concept très matériel de Schulden (les dettes). Contracter une dette, c’est inscrire l’action dans une double dimension morale: celle de la promesse (honorer sa dette à échéance) et celle de la faute (avoir contracté une dette).
Dans La Généalogie de la morale, le philosophe Friedrich Nietzsche, à partir d’une analogie phonétique en allemand, établit un lien entre le concept fondamental de la morale Schuld (la faute) et le concept très matériel de Schulden (les dettes). Contracter une dette, c’est inscrire l’action dans une double dimension morale: celle de la promesse (honorer sa dette à échéance) et celle de la faute (avoir contracté une dette). Pholoé est brûlante et glacée. Cette jeune fille en recherche de quelque chose qui la transcende, l'amour, la passion, l'absolu, expérimente des rencontres, découvre son corps et tente d'allumer ses sens à force d'amours plus ou moins désespérées et de sexe outrancier.
Pholoé est brûlante et glacée. Cette jeune fille en recherche de quelque chose qui la transcende, l'amour, la passion, l'absolu, expérimente des rencontres, découvre son corps et tente d'allumer ses sens à force d'amours plus ou moins désespérées et de sexe outrancier. « Ombres et volumes bougent sur les draps. Une forme remue. La peau s'anime. Les nerfs augmentent leur tension. Chaque muscle se met en branle. Cœur et poumons accélèrent. Le sang afflue en plus grande quantité vers la tête et les membres. Les paupières s'ouvrent, s’abaissent, se lèvent, tombent. Les lèvres s'écartent. Les coudes se plient. Le crâne monte sur le cou, pivote et s'effondre. Sur la nuque, des poils courts relaient les racines des cheveux. Le corps se rendort, tout ralentit, tout se tait jusqu'à ce que les bips réguliers du réveil s'immiscent au fond des oreilles et frappent les tympans... »
« Ombres et volumes bougent sur les draps. Une forme remue. La peau s'anime. Les nerfs augmentent leur tension. Chaque muscle se met en branle. Cœur et poumons accélèrent. Le sang afflue en plus grande quantité vers la tête et les membres. Les paupières s'ouvrent, s’abaissent, se lèvent, tombent. Les lèvres s'écartent. Les coudes se plient. Le crâne monte sur le cou, pivote et s'effondre. Sur la nuque, des poils courts relaient les racines des cheveux. Le corps se rendort, tout ralentit, tout se tait jusqu'à ce que les bips réguliers du réveil s'immiscent au fond des oreilles et frappent les tympans... »
 Un bol d’air dans un monde asphyxié. Il permet quelquefois, aussi, de faire éclore un talent. Car les médias se passionnent pour les joutes littéraires de l’automne. Comme on vibre aux exploits de Nadal ou de Federer.
Un bol d’air dans un monde asphyxié. Il permet quelquefois, aussi, de faire éclore un talent. Car les médias se passionnent pour les joutes littéraires de l’automne. Comme on vibre aux exploits de Nadal ou de Federer.