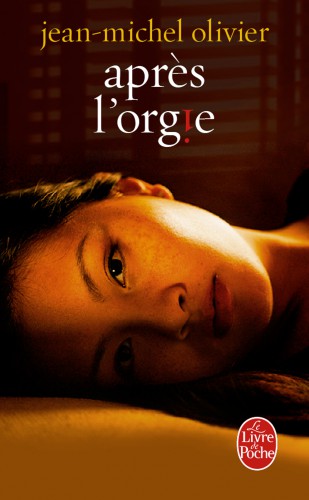Opération Tandem à Casablanca
par Bouthaïna Azami
 Dans le cadre des tandems organisés par le Salon du livre de Genève et le Salon de Casablanca, j'ai eu le bonheur de dialoguer, ce dimanche 15 février, avec Jean-Michel Olivier, Prix Interallié 2010. Une plume et un univers dont on a le sentiment de ressortir grandi.
Dans le cadre des tandems organisés par le Salon du livre de Genève et le Salon de Casablanca, j'ai eu le bonheur de dialoguer, ce dimanche 15 février, avec Jean-Michel Olivier, Prix Interallié 2010. Une plume et un univers dont on a le sentiment de ressortir grandi.
Jean-Michel Olivier est reconnu pour être l’un des plus grands écrivains suisses de sa génération. Né à Nyon, il vit depuis trente ans à Genève où il se partage entre son activité d’enseignant et l’écriture. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages, essais, livres autour de la photographie et de l’art contemporain, romans, Jean-Michel Olivier a reçu, en 2010, le Prix Interallié pour son romanL’amour nègre. Un roman qui, me confiera-t-il lors d’une rencontre dans le cadre du Salon du livre de Casablanca, marque un tournant dans sa carrière pour être très différent de ses précédents écrits.
De La Dame du Fort-barreau à L’amour nègre
Avec L’Amour nègre, Jean-Michel Olivier quitte en effet la Suisse et, notamment, sa ville de Genève, son quartier des Grottes qui vous prend par la main et vous mène, dans Notre dame du Fort-barreau, à la rencontre de Jeanne. Jeanne, cette «sublime mendiante», «les cheveux en bataille, les bas mités, le châle qui part en filoche» mais qui a «cette flamme dans (les) yeux». Cette flamme, bouleversante, qui irradie de cette lumière émanant de ces être rares qui ont renoncé au monde sans pour autant cesser d’aimer les hommes. Qui ont renoncé au monde pour mieux aimer les hommes.  Et Jeanne, je l’ai croisée aussi. Nous avons de temps à autre échangé un sourire, quelques mots, dans ce quartier où j’ai vécu durant trente ans, comme Jean-michel Olivier, que j’ai dû certainement croiser aussi, sur cette fameuse rue du Fort-Barreau ou dans les ruelles de ce village des Grottes où tout le monde se retrouve finalement, dans les mêmes lieux, les mêmes cafés... Mais il aura fallu ce Salon du livre de Casablanca pour que la rencontre se fasse vraiment. Et l’univers de l’écrivain m’a d’autant plus touchée que la plume est juste; incisive, certes, mais sans jamais sombrer dans le pathos, car elle trempe dans cette encre dont seuls les Suisses ont le secret: une plume d’un amour et d’une générosité uniques qui se déprend de soi pour se prendre à l’autre, s’éprendre de l’autre. Se prendre à Jeanne qui va les bas troués, livrée à la cinglante bise genevoise; Jeanne sur laquelle d’aucuns se retournent comme sur une miséreuse «folle» et qui,en réalité, est la propriétaire de deux immeubles dans lesquels elle accueille ceux qui n’ont pas de lieu et parfois pas même lieu. Jeanne, qui fera visiter au narrateur, qui n’est autre que Jean-Michel Olivier lui-même, un appartement dans lequel il s’installera comme dans un sanctuaire, tant la rencontre avec cette «fée» le prendra dans l’âme et la chair. Un sanctuaire, «Un oratoire» gorgé de mémoires à présent absentées qu’il traque, armé de son Nikon, tant elles hantent l’espace, imprègnent les murs. «Un oratoire» car, ces mémoires des lieux, Jeanne vient désormais lui en livrer les secrets, elle qui lui rend à présent visite chaque jour, s’annonçant d’un discret coup asséné à la porte de «la pointe du pied». Ainsi, elle lui racontera qu’un certain Vladimir Illitch –«Lénine, vous voulez dire?»- avait passé là «une soirée mémorable».
Et Jeanne, je l’ai croisée aussi. Nous avons de temps à autre échangé un sourire, quelques mots, dans ce quartier où j’ai vécu durant trente ans, comme Jean-michel Olivier, que j’ai dû certainement croiser aussi, sur cette fameuse rue du Fort-Barreau ou dans les ruelles de ce village des Grottes où tout le monde se retrouve finalement, dans les mêmes lieux, les mêmes cafés... Mais il aura fallu ce Salon du livre de Casablanca pour que la rencontre se fasse vraiment. Et l’univers de l’écrivain m’a d’autant plus touchée que la plume est juste; incisive, certes, mais sans jamais sombrer dans le pathos, car elle trempe dans cette encre dont seuls les Suisses ont le secret: une plume d’un amour et d’une générosité uniques qui se déprend de soi pour se prendre à l’autre, s’éprendre de l’autre. Se prendre à Jeanne qui va les bas troués, livrée à la cinglante bise genevoise; Jeanne sur laquelle d’aucuns se retournent comme sur une miséreuse «folle» et qui,en réalité, est la propriétaire de deux immeubles dans lesquels elle accueille ceux qui n’ont pas de lieu et parfois pas même lieu. Jeanne, qui fera visiter au narrateur, qui n’est autre que Jean-Michel Olivier lui-même, un appartement dans lequel il s’installera comme dans un sanctuaire, tant la rencontre avec cette «fée» le prendra dans l’âme et la chair. Un sanctuaire, «Un oratoire» gorgé de mémoires à présent absentées qu’il traque, armé de son Nikon, tant elles hantent l’espace, imprègnent les murs. «Un oratoire» car, ces mémoires des lieux, Jeanne vient désormais lui en livrer les secrets, elle qui lui rend à présent visite chaque jour, s’annonçant d’un discret coup asséné à la porte de «la pointe du pied». Ainsi, elle lui racontera qu’un certain Vladimir Illitch –«Lénine, vous voulez dire?»- avait passé là «une soirée mémorable».
Jeanne? «Une fée», «une amie». Pour d'autres, enfin pour ceux que ça arrange: «une folle». Comme pour ces épiciers qui la rabrouent, l’humilient en public tandis qu’elle cherche dans son porte-monnaie les pièces pour payer ses courses. Scène, prenante, à laquelle assiste, pétrifié, l’auteur-narrateur: «Pas un mot, pas un geste pour vous, Jeanne, qui m’avez tout donné. J’écoute et je reste impuissant, prisonnier de mon lamentable silence. Je disparais dans ce désert d’hommes et de femmes confondus dans une même lâcheté. La lâcheté des groupes et des troupeaux, des meutes de chiens.»
Et le narrateur d’entrer alors dans une culpabilité insurmontable, qui l’exilera de lui-même. Serait-il désormais de ces hommes, ces femmes, qui lui soulèvent le cœur? Non, car il a une conscience. Une conscience qui le ronge, à présent, au point de l’acculer au suicide. Tentative avortée par une femme qui le tirera des eaux du fleuve dans lequel il s’était jeté et se fera, après une aveugle nuit d’amour avec le narrateur, une sorte de vertigineuse métaphore de l’acte d’écrire. Un corps-à-corps où l’écrivain se perd, guidé comme malgré lui par une «vérité » qui le consume, dans laquelle il s’annihile comme pour mieux renaître à lui-même. Et ce livre qui vous invite, dès la page de couverture, à vous saisir de la main en heurtoir plantée dans la page bleutée pour frapper, de la pointe des doigts fondus à d’autres doigts, à la porte fermée sur d’édifiants émois.
L’Amour nègre
Quittons la Suisse. Pour mieux, finalement, y revenir. Jean-Michel Olivier s’en va, dans ce roman prenant, suivre les périples de Moussa, né «dans un village coincé entre la mer et un volcan éteint», en Afrique; né d’un père qui «avait dix épouses et une kyrielle d’enfants. C’était le seul et meilleur moyen qu’il avait trouvé pour ne pas travailler. Il passait ses journées sous l’aloès. Avec une calebasse remplie de vin de palme. (…) Le soir, il titubait d’une case à l’autre et distribuait des volées de Bambou». Dès les premières lignes, c’est un couperet qui s‘abat sur le lecteur. Le décor est planté, saisissant de violence.
 Bientôt, Moussa, vendu par son père contre un téléviseur à écran plat, sera rebaptisé Adam par sa famille d’adoption. Nouvel homme promis au Paradis? Pas vraiment. Objet pour son père, Adam poursuit son destin de «nègre». Et nous ne sommes pas là dans la «négritude», digne et rebelle, d’un Aimé Césaire. Mais dans les acceptions les plus viles de ce mot «nègre». «Une insulte», dira Jean-Michel Olivier. Bien plus que cela, une violence, une absence dans le déni, un déni originel condamnés à des murs, ou barreaux, assassins, contre lesquels il s'en va se fracasser irrémédiablement se fracasser, aussi "blin-bling" soient-ils.
Bientôt, Moussa, vendu par son père contre un téléviseur à écran plat, sera rebaptisé Adam par sa famille d’adoption. Nouvel homme promis au Paradis? Pas vraiment. Objet pour son père, Adam poursuit son destin de «nègre». Et nous ne sommes pas là dans la «négritude», digne et rebelle, d’un Aimé Césaire. Mais dans les acceptions les plus viles de ce mot «nègre». «Une insulte», dira Jean-Michel Olivier. Bien plus que cela, une violence, une absence dans le déni, un déni originel condamnés à des murs, ou barreaux, assassins, contre lesquels il s'en va se fracasser irrémédiablement se fracasser, aussi "blin-bling" soient-ils.
L’Amour nègre? L’amour de consommation, de substitution, l’amour-objet avilissant. Le nouvel Adam chutera dans les paradis artificiels d’Hollywood, ceux de Brad Pitt et Angelina Jolie auxquels l'auteur fait allusion. Et Moussa n’y trouvera pas sa place et passera de main en main, de pays en pays, dans un livre subdivisé en chapitres comme autant d’expériences cumulées du démembrement, de la dissolution de soi qui n’aura finalement d’autre alternative que de se faire siens les préjugés qui l’accablent et qu’il trimballe dans sa peau.
Une vertigineuse dénonciation de cette nouvelle ère de la mondialisation négatrice et de la consommation à outrance qui ne fait qu'exacerber, de façon d'autant plus outrancière qu'elle revêt, sournoise, l'habit de l'hôte philanthrope.
Photo © Copyright : Brahim Taougar-Le360












 « Qui de Dieu ou du diable est le plus puissant ? » D’entrée de jeu, Antoine Jaquier ouvre le roman sur la question que pose Manu, l’autiste de la bande d’adolescents et qui trouve la réponse entre deux flots de fumée : « Dieu créa l’homme, Satan le flingue ». On pourrait peut-être ajouter à la lecture de ce roman : l’homme créa les paradis artificiels, la femme le salut, Satan la dépendance qui balise la descente en enfer. Dès lors s’amorce un combat inégal entre les forces du bien et du mal, entre la liberté et les dépendances trop chères payées, entre l’amour salutaire et l’esclavage, voire le tourisme sexuel, une lutte disproportionnée qui sera le fil rouge du roman. L’originalité de ce récit est justement de montrer avec drôlerie et lucidité, cette lente dérive de jeunes paumés qui rêvent d’expériences inédites et d’horizons lointains. L’auteur sait nous garder à distance de ce milieu glauque et désespéré.
« Qui de Dieu ou du diable est le plus puissant ? » D’entrée de jeu, Antoine Jaquier ouvre le roman sur la question que pose Manu, l’autiste de la bande d’adolescents et qui trouve la réponse entre deux flots de fumée : « Dieu créa l’homme, Satan le flingue ». On pourrait peut-être ajouter à la lecture de ce roman : l’homme créa les paradis artificiels, la femme le salut, Satan la dépendance qui balise la descente en enfer. Dès lors s’amorce un combat inégal entre les forces du bien et du mal, entre la liberté et les dépendances trop chères payées, entre l’amour salutaire et l’esclavage, voire le tourisme sexuel, une lutte disproportionnée qui sera le fil rouge du roman. L’originalité de ce récit est justement de montrer avec drôlerie et lucidité, cette lente dérive de jeunes paumés qui rêvent d’expériences inédites et d’horizons lointains. L’auteur sait nous garder à distance de ce milieu glauque et désespéré.