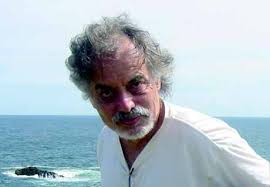L'enfant qui aimait grimper aux arbres (Bernadette Richard)
par Jean-Michel Olivier
 C'est à Joachim du Bellay que Bernadette Richard emprunte le titre de son dernier livre, Heureux qui comme*, un livre en forme de bilan, baigné tout à la fois de nostalgie et de jubilation, de regret du foyer natal (c'est le thème du poème de Du Bellay, 1558) et de retour à la nature.
C'est à Joachim du Bellay que Bernadette Richard emprunte le titre de son dernier livre, Heureux qui comme*, un livre en forme de bilan, baigné tout à la fois de nostalgie et de jubilation, de regret du foyer natal (c'est le thème du poème de Du Bellay, 1558) et de retour à la nature.
C'est un homme, étrangement, qui tient la plume ici et nous entraîne dans ses souvenirs d'enfance : sa passion de la solitude, son plaisir à grimper dans les arbres à la fois pour se cacher et pour observer le monde. Il nous raconte aussi ses rêves de vol, son amour des oiseaux qu'il étudie quotidiennement (le Dr Freud interprète ce fantasme de vol comme un désir d'érection!). Cette enfance enchantée par la nature va peu à peu laisser la place à une vie de photographe pris dans une ronde frénétique de voyages, une vie grisante de découvertes et de rencontres (qui ressemble beaucoup à celle de Bernadette Richard, grande « écrivaine aux semelles de vent »).
 Ce voyage passe par des étapes obligées : Katmandou, Woodstock où le narrateur rencontre une fille du Bas (lui qui est du Haut!). Mariage, enfant, séparation. Nouveaux voyages pour oublier ses racines et découvrir le monde. À la passion des arbres et des oiseaux s'ajoute bien vite celle des lacs, que Bernadette Richard décrit avec infiniment de poésie. Le lac Atitlan, le lac Titicaca, puis le lac Baïkal, ses états d'âme, ses impatiences, « ses toquades et ses arpèges météorologues ».
Ce voyage passe par des étapes obligées : Katmandou, Woodstock où le narrateur rencontre une fille du Bas (lui qui est du Haut!). Mariage, enfant, séparation. Nouveaux voyages pour oublier ses racines et découvrir le monde. À la passion des arbres et des oiseaux s'ajoute bien vite celle des lacs, que Bernadette Richard décrit avec infiniment de poésie. Le lac Atitlan, le lac Titicaca, puis le lac Baïkal, ses états d'âme, ses impatiences, « ses toquades et ses arpèges météorologues ».
Mais Ulysse, on le sait, a la nostalgie de sa terre natale. Après tant de pérégrinations, de beautés entrevues aux quatre coins du monde, tant de fleuves et de cascades, de lacs et de déserts, il est bon de rentrer chez soi. Car le hostos — le foyer — est au cœur du voyage. C'est une petite fille, Orsanne, qui va ramener le narrateur à ses premières amours : les arbres, les lacs, les grottes, les oiseaux. Comme Du Bellay quitte sans douleur « le mont Palatin pour son petit Liré », le narrateur, ayant conquis la toison d'or du voyage, aime à revenir sur ses terres, « pour vivre entre ses parents le reste de son âge. »
Il y a, dans ce retour au bercail, un peu de nostalgie, mais aussi beaucoup de bonheur (« Le bonheur est une idée neuve en Europe », écrivait Saint-Just). Bonheur de redécouvrir les lieux enchantés de l'enfance, bonheur aussi de marcher au bord de l'abîme, au Creux-du-Van, par exemple, dans ces contreforts du Jura qu'il aime tant. Le voyageur qui a roulé sa bosse n'est plus blasé : il redécouvre la joie des paysages, le plaisir des flâneries, la complicité d'Orsanne. Lui qui croyait posséder le savoir occulte de ses odyssées, il n'a que « des images intérieures qui se délitent au fil des mois » et « ses photos jaunissent dans des cartons ». Lui qui croyait que la beauté était ailleurs, exotique et insaisissable, il doit admettre que sa patrie lilliputienne la lui offre chaque jour, et qu'il n'a jamais su la voir.
« C'est peut-être ça, la sagesse : réaliser que l'ailleurs n'est nulle part et partout, même chez soi. »
C'est un chemin vers la sagesse, un chemin solitaire et vagabond, qu'emprunte Ulysse, toujours en quête de soi, et qui le mène, après avoir beaucoup erré, dans ce petit village dont il a vu, de loin, fumer les cheminées, près de cette pauvre maison « qui lui est une province, et beaucoup davantage. »
Un très beau livre, donc, riche, profond, original, peut-être le meilleur livre de Bernadette Richard qui a beaucoup donné à la littérature romande et est encore trop injustement méconnue.
* Bernadette Richard, Heureux qui comme, éditions d'autre part, 2017.










 Parti pour un « voyage d’une vie » en 2014 dans l’archipel des Hébrides au large de l’Écosse, un lieu désormais inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO comme le site naturel et historique le plus inaccessible au monde, l’auteur entremêle à ses notes de voyage, les épisodes marquants de l’histoire de ses habitants, de leur installation comme vassaux de l’intendant MacLeod de Harris dès le moyen-âge à leur demande d’évacuation en août 1930, tous épuisés tant la vie y était devenue impossible. L’évacuation de l’île est d’ailleurs un des seuls cas où une population abandonne sa terre ancestrale, la jugeant trop hostile, pour s’expatrier vers une terre plus accueillante.
Parti pour un « voyage d’une vie » en 2014 dans l’archipel des Hébrides au large de l’Écosse, un lieu désormais inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO comme le site naturel et historique le plus inaccessible au monde, l’auteur entremêle à ses notes de voyage, les épisodes marquants de l’histoire de ses habitants, de leur installation comme vassaux de l’intendant MacLeod de Harris dès le moyen-âge à leur demande d’évacuation en août 1930, tous épuisés tant la vie y était devenue impossible. L’évacuation de l’île est d’ailleurs un des seuls cas où une population abandonne sa terre ancestrale, la jugeant trop hostile, pour s’expatrier vers une terre plus accueillante. 



 On sent au fil de la lecture, la colère de l’auteur sourdre. D’abord ténue puis implacablement puissante lorsqu’il s’agit d’évoquer l’injustice au cœur de cette histoire : la déportation au fil des siècles de plusieurs centaines de gens dans le but de peupler une terre humide où seule la peau est imperméable, pour servir un seigneur lointain et protecteur. On est envoûté en lâchant le livre, convaincu que la nature est plus forte que l’homme, qu’elle vomit toutes les tentatives de la dompter, que le rire moqueur des fulmars rend cette injustice encore plus insupportable et qu’il était essentiel de rétablir une forme de justice en rapatriant la communauté de Saint-Kilda sous des cieux plus hospitaliers, plus … civilisés. Ce livre rend donc hommage à ces habitants qui, au moment du grand départ, laissèrent allumé le feu dans leur cheminée et ouvert la bible à la page de l’exode.
On sent au fil de la lecture, la colère de l’auteur sourdre. D’abord ténue puis implacablement puissante lorsqu’il s’agit d’évoquer l’injustice au cœur de cette histoire : la déportation au fil des siècles de plusieurs centaines de gens dans le but de peupler une terre humide où seule la peau est imperméable, pour servir un seigneur lointain et protecteur. On est envoûté en lâchant le livre, convaincu que la nature est plus forte que l’homme, qu’elle vomit toutes les tentatives de la dompter, que le rire moqueur des fulmars rend cette injustice encore plus insupportable et qu’il était essentiel de rétablir une forme de justice en rapatriant la communauté de Saint-Kilda sous des cieux plus hospitaliers, plus … civilisés. Ce livre rend donc hommage à ces habitants qui, au moment du grand départ, laissèrent allumé le feu dans leur cheminée et ouvert la bible à la page de l’exode.