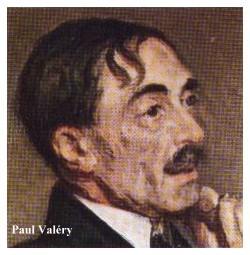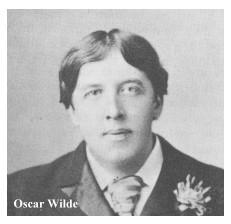Par Pierre Béguin
Du danger de la lecture: 1e partie
D’aucuns se croient obligés de pénétrer dans une bibliothèque comme dans une cathédrale. La littérature est Esprit Saint, le livre relique. D’autres montrent leur propre bibliothèque avec la ferveur du pèlerin. Rien n’est plus irritant que cette sotte dévotion.
Beaucoup d’écrivains ne s’y trompent pas qui traitent – paradoxalement certes, parfois même ironiquement – ce soi-disant sanctuaire de la culture de la manière la plus dépréciative. Ainsi la bibliothèque de Jules Verne (Paris au XXe siècle) – j’en ai parlé dans un précédent article –, comparée à un cimetière où les livres deviennent des cadavres poussiéreux interdits d’exhumation. Ainsi celle de Borges (Fictions), la bien nommée «bibliothèque de Babel» – agencement de galeries à l’infini, labyrinthe de livres ayant perdu toute signification et dont la pléthore aboutit à l’incohérence, voire à l’absurde – qui semble sortie tout droit d’un cauchemar aux relents kafkaïens. Ainsi celle de Musil (L’Homme sans qualités), «colossal magasin» de trois millions et demi de livres, tout aussi absurde parce que située au croisement entre culture et infini – il faudrait dix mille ans pour en lire tous les livres! Ainsi celle d’Umberto Eco (Le Nom de la rose) au centre d’un réseau d’interdits – les livres ne sont accessibles qu’après délivrance d’une autorisation – où toute transgression est frappée de sanction définitive. Autant d’exemples qui font de la bibliothèque, non pas une cathédrale, mais un lieu de non sens, d’enlisement, de danger, voire de mort.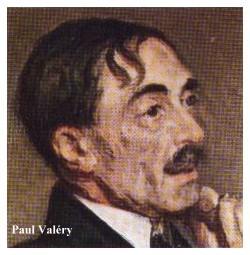
Une impression que peut ressentir l’homme cultivé en parcourant cette autre gigantesque bibliothèque qu’est le Salon du Livre: un vertige, un vague dégoût comme un écœurement, ce que Paul Valéry appelait «le malaise du grand nombre», issu de cette rencontre entre la finitude de l’homme et l’infini de la culture, et qu’il décrit ainsi – non sans provocation – dans son discours d’entrée à l’Académie française : «En vérité, Messieurs, je ne sais comment une âme peut garder son courage à la seule pensée des énormes réserves d’écriture qui s’accumulent dans le monde. Quoi de plus vertigineux, quoi de plus confondant pour l’esprit que la contemplation des murs cuirassés et dorés d’une vaste bibliothèque; et qu’y a-t-il aussi de plus pénible à considérer que ces bancs de volumes, ces parapets d’ouvrages de l’esprit qui se forment sur les quais de la rivière, ces millions de tomes, de brochures échouées sur les bords de la Seine, comme des épaves intellectuelles rejetées par le cours du temps qui s’en décharge et se purifie de nos pensées.»
Si Valéry occupe une place importante dans la galerie des écrivains dont l’œuvre thématise une dénonciation des dangers de la lecture – Monsieur Teste, son personnage le plus représentatif, ne possède aucun livre et n’en veut aucun chez lui – il est loin d’être le seul. De Montaigne («Je feuillette les livres, je ne les estudie pas»), en passant par Rousseau («Je hais les livres ; ils n’apprennent qu’à parler de ce qu’on ne sait pas») jusqu’à André Gide («Il faut brûler en toi tous les livres»), nombreux sont les écrivains qui ont secoué la doxa selon laquelle la lecture constitue un des piliers essentiels de la culture, la base de toute formation di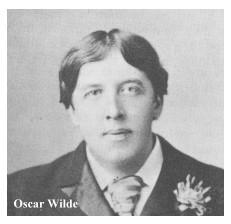 gne de ce nom et l’un des vecteurs de la connaissance de soi. Même Anatole France, qui passait pour un lecteur boulimique – un lecteur «éponge» disaient ironiquement certains – y alla de son couplet : «Proust est trop long et la vie est trop courte». Mais le plus féroce à dénoncer les risques de la lecture fut probablement Oscar Wilde. Et l’on aurait tort, connaissant l’homme, de n’y voir que provocation. Lui-même lecteur impénitent, esprit fin et cultivé, il fut mieux que personne averti des dangers d’une telle activité, non pas seulement parce que beaucoup d’œuvres n’ont en réalité guère d’intérêt, mais surtout parce que, loin de participer du processus de connaissance de soi, elle peut au contraire éloigner le lecteur de lui-même, voire l’égarer complètement, si la lecture devient trop attentive. Comme Montaigne, qui «feuillette», il recommande de ne pas passer plus de six minutes par livre : «Six minutes suffisent à quelqu’un qui a l’instinct de la forme. Pourquoi patauger dans un lourd volume? On y goûte, et c’est assez, plus qu’assez, me semble-t-il.» (La critique est un art). Dans ce sens, il considère comme une mission de sauvegarde publique de recenser les livres à ne lire sous aucun prétexte, tâche qui, selon lui, devrait incomber à l’Université : «Cette mission est une nécessité éminente d’une époque comme la nôtre, une époque qui lit tellement qu’elle n’a pas de temps pour admirer et écrit tellement qu’elle n’a pas de temps pour réfléchir. Celui qui sélectionnera, du chaos de nos listes modernes, les cent plus mauvais livres donnera à la jeune génération un avantage véritable et durable» (Selected journalism).
gne de ce nom et l’un des vecteurs de la connaissance de soi. Même Anatole France, qui passait pour un lecteur boulimique – un lecteur «éponge» disaient ironiquement certains – y alla de son couplet : «Proust est trop long et la vie est trop courte». Mais le plus féroce à dénoncer les risques de la lecture fut probablement Oscar Wilde. Et l’on aurait tort, connaissant l’homme, de n’y voir que provocation. Lui-même lecteur impénitent, esprit fin et cultivé, il fut mieux que personne averti des dangers d’une telle activité, non pas seulement parce que beaucoup d’œuvres n’ont en réalité guère d’intérêt, mais surtout parce que, loin de participer du processus de connaissance de soi, elle peut au contraire éloigner le lecteur de lui-même, voire l’égarer complètement, si la lecture devient trop attentive. Comme Montaigne, qui «feuillette», il recommande de ne pas passer plus de six minutes par livre : «Six minutes suffisent à quelqu’un qui a l’instinct de la forme. Pourquoi patauger dans un lourd volume? On y goûte, et c’est assez, plus qu’assez, me semble-t-il.» (La critique est un art). Dans ce sens, il considère comme une mission de sauvegarde publique de recenser les livres à ne lire sous aucun prétexte, tâche qui, selon lui, devrait incomber à l’Université : «Cette mission est une nécessité éminente d’une époque comme la nôtre, une époque qui lit tellement qu’elle n’a pas de temps pour admirer et écrit tellement qu’elle n’a pas de temps pour réfléchir. Celui qui sélectionnera, du chaos de nos listes modernes, les cent plus mauvais livres donnera à la jeune génération un avantage véritable et durable» (Selected journalism).
A suivre…
 Pokhara est un court texte elliptique qui semble la partie émergée d’un iceberg : on perçoit, sous la ligne de flottaison, une immense masse juste suggérée.
Pokhara est un court texte elliptique qui semble la partie émergée d’un iceberg : on perçoit, sous la ligne de flottaison, une immense masse juste suggérée.
 choisissent, en guise de préliminaires, une illustration à la gloire des grands maîtres de la Turgescence, des Rembrandt de la Turlute, des Caravage de la bagatelle! Alors cesseront enfin ces râles pr
choisissent, en guise de préliminaires, une illustration à la gloire des grands maîtres de la Turgescence, des Rembrandt de la Turlute, des Caravage de la bagatelle! Alors cesseront enfin ces râles pr
%25202.jpg)