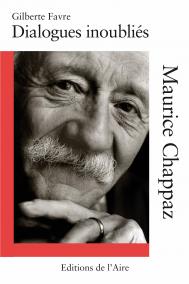par Jean-Michel Olivier
 Mon premier est un corps de légende. Le corps rêvé, à deux, par mes parents. Un corps double, déjà, et tissé de désirs contradictoires. Pas de visage, encore, ni de nom propre. Mais la rencontre de deux rivières qui, un beau jour, ont mélangé leurs eaux. Rien de visible, encore, dans ce petit embryon virtuel qui porte en soi tous les espoirs du monde, les angoisses et les rêves, la vie et la mort. Mais, bien sûr, le programme à venir est inscrit dans les gênes, comme un passeport : un sauf-conduit pour des destinations futures.
Mon premier est un corps de légende. Le corps rêvé, à deux, par mes parents. Un corps double, déjà, et tissé de désirs contradictoires. Pas de visage, encore, ni de nom propre. Mais la rencontre de deux rivières qui, un beau jour, ont mélangé leurs eaux. Rien de visible, encore, dans ce petit embryon virtuel qui porte en soi tous les espoirs du monde, les angoisses et les rêves, la vie et la mort. Mais, bien sûr, le programme à venir est inscrit dans les gênes, comme un passeport : un sauf-conduit pour des destinations futures.
« En ces temps-là, écrit Platon dans Le Banquet, les êtres humains avaient quatre bras, des jambes en nombre égal, deux visages, les parties honteuses en double, tout le reste à l’avenant. […] Zeus, pour mettre un terme à leur indiscipline, les coupa en deux comme on tranche les fruits pour en faire des conserves, ou encore comme on divise un œuf dur avec un crin. »
Mon premier est un corps idéal : des jambes déliées, des bras solides, un visage d’ange, les yeux bleus de son père, le nez droit de sa mère (et la culotte de son grand frère, dirait Gotlib). Il a des proportions parfaites. Un chef-d’œuvre esthétique, en quelque sorte. Mais pas encore de sexe.
Pendant des millénaires, on n’a rien su de la magie de la gravidité. L’ignorance, aujourd’hui, n’est plus de mise : grâce à l’échographie, on peut suivre en temps réel et en cinémascope l’histoire du petit bougillon, le mesurer, l’ausculter, déceler d’éventuelles maladies ou des malformations congénitales. On peut même l’opérer in utero sans qu’il s’en aperçoive.
Bien à l’abri dans la grotte maternelle, il ou elle n’est jamais seul(e). Son corps est inclus dans un corps plus vaste qui le nourrit et le contient. Il pousse à l’abri des regards indiscrets, bien au chaud, en toute sécurité, mais il grandit déjà sous surveillance. Big Mother is Watching You. Il a déjà son dossier médical, sa fiche magnétique d’assurance, sa chambre réservée à la Maternité.
Pour les Grecs, comme pour les Romains, le corps idéal est celui du soldat: incarnation de la virilité accomplie et de la fonction sociale la plus noble. Au Moyen Âge, c’est le chevalier au corps dissimulé par une armure, toujours au service des plus faibles, et lié à son Roi par une fidélité indéfectible. Et aujourd’hui ? L’idéal masculin serait un composé d’acteur (Johnny Depp) et de chanteur de charme (Robbie Williams). Quant à l’idéal féminin, c’est un mélange de top model (Gisèle Bundchen) et de chanteuse sexy (Shakira, Britney Spears).
Après neuf mois de réclusion dans la grotte maternelle, voilà le petit d’homme enfin admis à voir le jour ! En même temps qu’il ouvre pour la première fois les yeux, les autres voient son corps. Il cesse d’être une image, un fantasme, un désir inconscient. Il est là, couché sur le sein de sa mère, et il n’est pas quelqu’un d’autre. Il n’est plus inclus dans le corps d’un autre, mais exclu du Jardin d’Eden.
À peine né, on le toise, on le pèse, on l’ausculte, on l’étalonne, on examine la souplesse de ses membres, on mesure le diamètre de son crâne. Le premier test qu’il doit passer, c’est l’épreuve du grabbing: il doit être capable de refermer sa main sur le doigt du pédiatre. Il doit d’emblée montrer son désir de s’accrocher à la vie.
Son premier mot d’ordre philosophique : Je pince, donc je suis.
On ne le dira jamais trop : le nom (et le prénom) que je porte aura toujours été celui d’un autre. Il existe avant moi et sans moi. C’est le prénom d’un enfant mort (Ramuz avaient deux frères aînés, Charles et Ferdinand, qui moururent en bas âge), d’une tante d’Amérique ou d’un grand-père fou, d’un ami de maman ou d’une vedette de cinéma (combien de Brad, de Jennifer, de Monica dans les années 2000 ?). Dans tous les cas, c’est le nom étranger qu’on colle sur mon corps. L’étiquette. Le signe distinctif. Qui m’aura précédé et qui attestera que j’ai vécu. Un nom étrange qu’il faudra accepter d’abord, puis ensuite reconnaître (comme on reconnaît une dette). Ce nom étrange qu’il faudra honorer, sa vie durant, sous peine d’être exclu du clan familial, et de perdre son identité.
Un nom. Un corps. Sa vie durant, il faudra négocier avec ces énigmes insondables, qui sont données une fois pour toutes, à la naissance. Je suis ce nom. Je suis ce corps. Pourquoi ne m’appelé-je pas Jordi, ou Aragon, ou Franz Schubert, ou Félix Unglück ? Et pourquoi ne suis-je pas petit, large d’épaules, roux aux yeux bleus, poilu et ventriloque ?
Vous me direz qu’on peut changer de nom. C’est compliqué, mais c’est possible. Vous me direz aussi qu’il y a des pseudonymes (Stendhal, Cendrars, Molière, etc.), et que Julien Gracq, dans tous les cas, sonne mieux que Julien Poirier, par exemple. C’est vrai. Vous me direz également qu’il est possible aujourd’hui de modifier son corps selon ses moindres caprices. Rien de plus facile, en effet, qu’une petite liposuccion, une rhinoplastie, un limage des dents, une greffe de cheveux, un lifting du visage, etc. Nous sommes les premiers, sans doute, dans l’histoire de l’humanité, à pouvoir remodeler notre corps à loisir, au point d’en faire, à jamais, un corps méconnaissable même pour ceux qui nous connaissent le mieux.
« Le charme, le seul vrai charme, est épidermique : qui songe à louer le squelette de sa Dulcinée ? » Julien Gracq.
Si, au départ de la vie, le monde apparaît à l’enfant comme le prolongement indifférencié de son corps, la conscience de soi naît à partir de la frontière qu’il trace entre lui et le monde extérieur. Vers l’âge de trois ans, quand il dessine, la première image qu’il donne de lui-même est une boucle fermée qui partage un dedans d’un dehors. Inscrivant dans cet enclos corporel les yeux et la bouche, greffant des membres filamentaires, il fixe, dans la fascination du vis-à-vis, l’image d’un moi qui se découvre — comme un autre.
Hippocrate, le plus célèbre médecin de la Grèce antique, n’a jamais ouvert de cadavre, ni laissé aucun traité sur ce sujet. Et jusqu’au XIIIe, le corps humain n’est qu’une surface. Il faut que Frédéric II de Germanie rende une ordonnance en vertu de laquelle il est défendu d’exercer la médecine sans avoir étudié au préalable pendant un an l’anatomie sur des corps humains. Deux excommunications papales, lancées contre l’auteur de cet édit, ne suffisent pas à refermer les cadavres. Dès lors, le corps est étudié non seulement comme une surface, mais aussi comme une profondeur.
« J’ai disséqué plus de dix corps humains, écrit Léonard de Vinci dans ses Carnets. Fouillant chacun des membres, écartant les plus infimes parties de chair […] Si tu es passionné par ce sujet, tu peux être retenu par une répugnance naturelle ou, si elle ne te retient pas, tu peux redouter de passer la nuit en compagnie de cadavres découpés, écorchés, horribles à voir. Si cela ne te rebute toujours pas, peut-être ne possèdes-tu pas le talent de dessinateur indispensable à cette science. »
En coupant le corps en morceaux, la dissection met un terme au principe d’unité que sous-tend la notion d’individu (qui signifie « corps indivisible »).Aussi, jusqu’au XVIIe, les dépouilles offertes aux anatomistes sont celles des condamnés à mort. La dissection, pratiquée à huis clos, est entourée d’opprobre. À la fin du siècle, la tendance s’inverse :la dissection devient un spectacle à la mode. Dans Le Malade imaginaire, Molière ironise : « Il y en a qui donnent la comédie à leurs maîtresses, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. »
Où est mon corps d’enfant ? Mon dernier cheveu blond ? Le corps choyé par mes parents n’existe plus. Un autre a pris sa place, que personne n’a reconnu, mais qu’il faut accepter, parce qu’on n’a pas le choix, et puis un autre encore. Tout ce qu’il reste de ce corps primitif, ce sont des cicatrices fermées sur un secret. Les genoux si souvent éraflés qu’ils ressemblent à des champs de bataille. Le dos brûlé par le lait écumant que mon grand-père, dans sa nuit primordiale, a renversé sur moi, un dimanche de printemps. Le coude creusé par la chute d’un vélo lancé à toute allure sur un chemin de pierres, etc.
Nous sommes des poupées russes. À chaque étape de notre vie, un nouveau corps vient remplacer le précédent, l’enveloppant d’une nouvelle peau, qui ne tombe pas, et reste intacte avant d’être recouverte à son tour. Au centre du dispositif, il y a un corps d’enfant, minuscule, effaré, immobile, qui regarde avec un sourire ces corps effacés par le temps, et qui ne parle pas.
Un jour, dans un accès de fureur éthylique, un collègue lança sur moi une assiette qui faillit me tuer. Mon front dégoulinait. Ma belle chemise de lin était tachée de rouge. Après le vin partagé en commun, dans la douceur de la nuit (une vraie Comédie d’été à la Shakespeare), je goûtais au vrai sang du sacrifice. Sans poser de questions, les médecins de l’hôpital recousirent la blessure avec du fil invisible et une aiguille. La boutonnière existe encore. Je ne la sens jamais. Certains soirs, quand le froid est trop vif, elle se teinte de rouge, pour que je ne l’oublie pas.
Je n’ai plus, aujourd’hui, le visage que ma mère m’a connu. Quelques photos anciennes, toujours les mêmes, toujours en noir et blanc, attestent pourtant que ce visage a existé. Qu’il a été le mien. Un visage d’ange (ou de démon) qui sourit tout le temps. Puis c’est la page blanche : une année de silence. Après, l’enfant n’est plus le même. Son visage a changé. Le beau sourire est devenu grimace. L’enfant avait dix ans. Les chemins de montagne étaient gelés. Zigzagant entre les congères, la voiture a quitté la route, dévalé un talus, s’est écrasée contre un sapin. L’enfant assis à côté de son père a traversé le pare-brise. Il est resté enseveli des heures sous la neige. On l’a tiré de là, on a ôté le verre de ses yeux, soigné les plaies de son visage. À l’hôpital, emmailloté comme une momie, il est resté dix jours sans bouger, sans parler. Quand on lui a retiré ses pansements, sa mère ne l’a pas reconnu. Dans l’album de famille, après la bourrasque de neige, les photos sont maintenant en couleur.
Le corps est le premier jouet, la première source de douleur et de plaisir. Tout s’y inscrit en palimpseste. À cet égard, c’est le modèle des relations que l’on entretiendra avec autrui. Si j’aime mon corps, si je le soigne et le vénère (comme la publicité m’y enjoint constamment), je serai plus sensible au corps de l’autre, à ses défauts, à ses métamorphoses, à son vieillissement.
Comme il est le premier instrument de plaisir, le corps est aussi la première œuvre d’art. Tout porte à croire que l’homme (et donc la femme !) a pris sa propre peau comme support originel de son image. Regardez les Dogons, les Papous, les Incas, les Massaï. Regardez Pamela Anderson. Regardez Marilyn Manson. Le maquillage — comme le tatouage — constitue la forme la plus ancienne de métamorphose corporelle. Grâce à elle, on sépare, d’emblée, le corps biologique et le corps culturel.
Combien de temps sépare un grain de peau d’un grain de sable ?
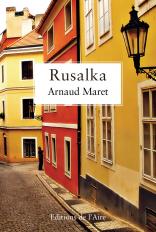 Arnaud Maret sait mener un récit. Ses livres (deux jusqu'à présent) s'inscrivent dans la catégorie des page turner. Ils forment le début d'une série : on retrouve dans Rusalka, qui vient de paraître, un personnage des Ecumes noires,
Arnaud Maret sait mener un récit. Ses livres (deux jusqu'à présent) s'inscrivent dans la catégorie des page turner. Ils forment le début d'une série : on retrouve dans Rusalka, qui vient de paraître, un personnage des Ecumes noires,  Maret, avant
Maret, avant  On ne présente plus Luc Weibel : historien, écrivain, auteur de plusieurs « récits de vie » (dont les fameuses Pipes de terre, pipes de porcelaine*), Luc Weibel (né en 1943) est aussi le chroniqueur le plus subtil et le plus savoureux de la vie genevoise. Toujours à la lisière de l'histoire générale et de l'histoire personnelle, ses livres s'inscrivent dans la lignée directe de cet autre chroniqueur genevois d'exception que fut Henri-Frédéric Amiel (auquel Weibel a consacré un très beau livre, Les petits frères d'Amiel**, préfacé par Philippe Lejeune).
On ne présente plus Luc Weibel : historien, écrivain, auteur de plusieurs « récits de vie » (dont les fameuses Pipes de terre, pipes de porcelaine*), Luc Weibel (né en 1943) est aussi le chroniqueur le plus subtil et le plus savoureux de la vie genevoise. Toujours à la lisière de l'histoire générale et de l'histoire personnelle, ses livres s'inscrivent dans la lignée directe de cet autre chroniqueur genevois d'exception que fut Henri-Frédéric Amiel (auquel Weibel a consacré un très beau livre, Les petits frères d'Amiel**, préfacé par Philippe Lejeune). C'est le prétexte (officiel) de ce livre protéiforme et savoureux. On pourrait croire aux aventures d'un rat de bibliothèque, enfermé dans la belle maison d'Alcine, en pleine canicule, pour mettre un semblant d'ordre dans un monceau de paperasses qui le submergent. Il y a de ça, bien sûr, dans ce beau livre, qui parle aussi d'héritage et de transmission. Mais bien vite l'auteur va retrouver l'air libre. Depuis toujours, c'est un flâneur, un promeneur des lettres et un observateur sans concession de la vie quotidienne. Alors, l'été qu'il passe dans la bibliothèque familiale (où il découvre, mine de rien, des trésors étonnants, comme ces lettres échangées entre une femme de sa famille et H.F. Amiel) se prolonge, mais ailleurs, avec d'autres rencontres, des lectures, des voyages, des concerts, des conférences, etc. Weibel est un esprit curieux (dans tous les sens du terme). Un esprit singulier, qui s'interroge sans cesse sur lui (fidèle, en cela, aux préceptes d'Amiel), mais s'intéresse d'abord et surtout aux autres.
C'est le prétexte (officiel) de ce livre protéiforme et savoureux. On pourrait croire aux aventures d'un rat de bibliothèque, enfermé dans la belle maison d'Alcine, en pleine canicule, pour mettre un semblant d'ordre dans un monceau de paperasses qui le submergent. Il y a de ça, bien sûr, dans ce beau livre, qui parle aussi d'héritage et de transmission. Mais bien vite l'auteur va retrouver l'air libre. Depuis toujours, c'est un flâneur, un promeneur des lettres et un observateur sans concession de la vie quotidienne. Alors, l'été qu'il passe dans la bibliothèque familiale (où il découvre, mine de rien, des trésors étonnants, comme ces lettres échangées entre une femme de sa famille et H.F. Amiel) se prolonge, mais ailleurs, avec d'autres rencontres, des lectures, des voyages, des concerts, des conférences, etc. Weibel est un esprit curieux (dans tous les sens du terme). Un esprit singulier, qui s'interroge sans cesse sur lui (fidèle, en cela, aux préceptes d'Amiel), mais s'intéresse d'abord et surtout aux autres.  Comme Amiel, comme Rousseau, Weibel n'est pas tendre avec lui-même. Quand on se moque des travers des autres, il faut aussi savoir rire des siens. C'est un autre aspect de ce livre à la fois riche et vivant : l'auteur, qui est le roi de la litote (on ne compte plus les « un peu », les « sans doute », etc.), manie l'humour avec dextérité (le plus souvent par des incises ou des parenthèses). C'est un régal de lire ses comtes-rendus de conférences ou de rencontres, qui sont des modèles du genre.
Comme Amiel, comme Rousseau, Weibel n'est pas tendre avec lui-même. Quand on se moque des travers des autres, il faut aussi savoir rire des siens. C'est un autre aspect de ce livre à la fois riche et vivant : l'auteur, qui est le roi de la litote (on ne compte plus les « un peu », les « sans doute », etc.), manie l'humour avec dextérité (le plus souvent par des incises ou des parenthèses). C'est un régal de lire ses comtes-rendus de conférences ou de rencontres, qui sont des modèles du genre. Il m'est arrivé ces derniers jours quelque chose qui se passait souvent quand j'avais dix-sept, vingt-trois, vingt-cinq ans. Vous savez, quand vous êtes plongé dans un livre, que chaque obligation de le quitter est un arrachement, quand on bâcle tout pour retourner le plus vite possible se livrer au vice coupable.
Il m'est arrivé ces derniers jours quelque chose qui se passait souvent quand j'avais dix-sept, vingt-trois, vingt-cinq ans. Vous savez, quand vous êtes plongé dans un livre, que chaque obligation de le quitter est un arrachement, quand on bâcle tout pour retourner le plus vite possible se livrer au vice coupable. Pas moins de quatre livres de ou sur Maurice Chappaz viennent de paraître ! Une floraison qui rappelle à quel point ce poète est important.
Pas moins de quatre livres de ou sur Maurice Chappaz viennent de paraître ! Une floraison qui rappelle à quel point ce poète est important.