par Jean-Michel Olivier
 Le polar est à la mode — même en Suisse romande ! Après les grands polars américains (Ellroy, Coben, Connelly), la vague des polars scandinaves (Stieg Larsson, l'extraordinaire Henning Mankel), voici venir les polars romands. On range dans cette catégorie toute sorte de romans (romans noirs, romans policiers) qui n'ont souvent rien à voir avec les polars américains ou scandinaves et qui — osons le dire — ne leur arrivent pas à la cheville.
Le polar est à la mode — même en Suisse romande ! Après les grands polars américains (Ellroy, Coben, Connelly), la vague des polars scandinaves (Stieg Larsson, l'extraordinaire Henning Mankel), voici venir les polars romands. On range dans cette catégorie toute sorte de romans (romans noirs, romans policiers) qui n'ont souvent rien à voir avec les polars américains ou scandinaves et qui — osons le dire — ne leur arrivent pas à la cheville.
 Ce n'est pas le cas du deuxième livre de Julien Sansonnens, un auteur qui, comme il aime à le dire, « a un nom fribourgeois, est né à Neuchâtel, va être député vaudois et travaille en Valais ». Avec Les Ordres de grandeur*, Sansonnens nous donne un roman à la fois ambitieux et parfaitement construit, qui nous balade aux quatre coins de la Suisse romande.
Ce n'est pas le cas du deuxième livre de Julien Sansonnens, un auteur qui, comme il aime à le dire, « a un nom fribourgeois, est né à Neuchâtel, va être député vaudois et travaille en Valais ». Avec Les Ordres de grandeur*, Sansonnens nous donne un roman à la fois ambitieux et parfaitement construit, qui nous balade aux quatre coins de la Suisse romande.
Roman choral, Les Ordres de grandeur fait se croiser plusieurs personnages dont les destins se nouent, au fil des pages, dans une toile savamment tissée. Au centre du livre, Alexis Roch, un journaliste charismatique qui présente le Journal de 20 Heures sur une chaîne privée genevoise. On assiste d'abord à son irrésistible ascension, grâce à sa verve, son talent de communicateur, son entregent aussi, puis à sa chute, programmée dès le début, mais surprenante et bienvenue.  Autour de lui, gravitent des amis d'enfance, comme Michel Fouroux, un spin doctor (Marco Camino, clin d'œil à Marc Comina !), une beurette au destin malheureux, quelques politiciens véreux (dont un certain Schumacher, célèbre pour son catogan!) et bien sûr quelques inspecteurs de police.
Autour de lui, gravitent des amis d'enfance, comme Michel Fouroux, un spin doctor (Marco Camino, clin d'œil à Marc Comina !), une beurette au destin malheureux, quelques politiciens véreux (dont un certain Schumacher, célèbre pour son catogan!) et bien sûr quelques inspecteurs de police.
Car le roman de Sansonnens a l'allure d'un polar : il commence par une (atroce) scène de viol, puis se déroule comme une enquête policière. Mais l'enquête, ici, n'est qu'un prétexte pour brosser le tableau d'une société obnubilée par le paraître, la réussite sociale, l'appât du fric et les petits arrangements entre copains. Même s'il force parfois le trait (c'est le côté jubilatoire du livre, quand l'auteur n'hésite pas à se lâcher!), Sansonnens démonte les rouages d'un univers politico-médiatique qui repose essentiellement sur de sales petits (et grands) secrets. Sans tomber dans la caricature, il sonde aussi le cœur de ses personnages avec intelligence et empathie — je dirais même une générosité et un humour assez rares dans la littérature romande (qui est souvent minimaliste et manifeste un humour involontaire).
Bref, un roman riche et vivant qui tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière ligne.
* Julien Sansonnens, Les Ordres de grandeur, éditions de l'Aire, 2016.




 Un des intérêts du Grand Projet de Nicolas Kissling, c'est que le roman évoque l'immigration des années 50, c'est-à-dire la rudesse de la condition de saisonnier, un milieu de solidarité mais aussi de trahison et de pressions….
Un des intérêts du Grand Projet de Nicolas Kissling, c'est que le roman évoque l'immigration des années 50, c'est-à-dire la rudesse de la condition de saisonnier, un milieu de solidarité mais aussi de trahison et de pressions….



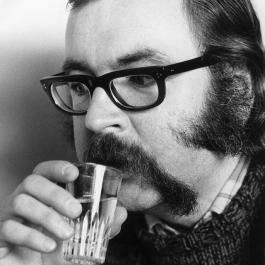 Par Alain Bagnoud
Par Alain Bagnoud