soif de pouvoir
par antonin moeri
Une conduite inspirée par le désir de réussir à tout prix a souvent été épinglée par des écrivains aimant la satire. Il est vrai que l’arrivisme a toujours déclenché les aventures les plus grandioses ou provoqué les désastres les plus pitoyables. Dans un récit d’une cruauté raffinée, Kafka présente ainsi un jeune négociant qui va prendre en charge la narration: «Ceux qui, comme moi, ne peuvent souffrir la vue d’une taupe ordinaire seraient sans doute morts de dégoût devant la taupe géante qui a été observée il y a quelques années».
Or l’apparition de cette taupe n’a jamais été prouvée ni expliquée. Un vieil instituteur de village s’est alors proposé pour rédiger un mémoire dans lequel il amènerait les preuves de l’existence de cette taupe. Un mémoire qui ne sera pas pris en considération par les experts qui auraient pu légitimer ce travail. Un savant se serait même moqué du vieil instituteur. Cette attitude méprisante va déclencher, chez le narrateur qui apprend la chose dans un journal, un mouvement de colère.
Ce narrateur décide alors de mener sa propre enquête pour venir en aide à l’instituteur, qui voit d’un mauvais oeil quelqu’un d’autre s’occuper de cette affaire et qui ne croit pas aux bonnes intentions de ce négociant vivant en ville. Voulant gagner de l’argent avec cette affaire, l’instit débarque chez le narrateur avec l’envie d’en découdre. Certes, il l’avait laissé entreprendre ses recherches, car un homme de la ville pouvait certainement faire mousser la chose, pensait-il. Il a imaginé qu’après les rumeurs et les prises de position, des protecteurs s’empareraient de l’affaire et trouveraient des fonds pour financer l’entreprise. Le narrateur de son côté avait pensé, en publiant son mémoire, attirer l’attention d’un savant sur l’affaire, un savant qui aurait pu obtenir pour le vieil instit une bourse, lequel instit aurait pu déménager en ville pour y suivre une formation et avoir des entretiens de haut niveau...
L’instit a cependant oublié un élément important: son grand âge ne lui aurait jamais permis de réaliser ce rêve de grandeur, on l’aurait tout au plus gratifié d’une petite médaille à accrocher au revers de sa veste. Troublé par les propos du narrateur, il allume sa pipe et reste cloué dans le salon du jeune négociant. Attendrait-il de l’argent? «À voir le petit vieillard coriace assis à la table, on pouvait croire qu’il serait impossible de l’éjecter».
S’il y a un écrivain qui fut expert en matière de pouvoir, c’est Kafka. Dans son magnifique essai «L’autre procès», Elias Canetti montre que le véritable but de Kafka (dans sa vie) fut de se soustraire à toute forme de pouvoir, un pouvoir qu’il «pressent, découvre, nomme et se représente partout où d’autres l’accepteraient comme allant de soi».
Dans «La taupe géante», Kafka met en scène avec une ironie à la fois cinglante et bienveillante cette soif de pouvoir, de puissance, de reconnaissance, cette soumission à un supérieur qui caractérisent les agissements de bien des bipèdes sur la croûte terrestre. Ni rancune, ni haine, ni esprit de vengeance ne poussaient cet auteur à faire un vil usage de ce constat. C’est plutôt un rire irrésistible, une joie très communicative qui le poussaient à observer puis à raconter, un rire irrésistible qui gagnait les auditeurs lorsque Franz leur lisait un de ses textes, un rire irrésistible qui gagnait le docteur Kafka quand une huile se levait pour prononcer gravement un discours officiel.
Franz Kafka: Récits posthumes, Babel, 2008
Elias Canetti: L’autre procès, Gallimard, 1972

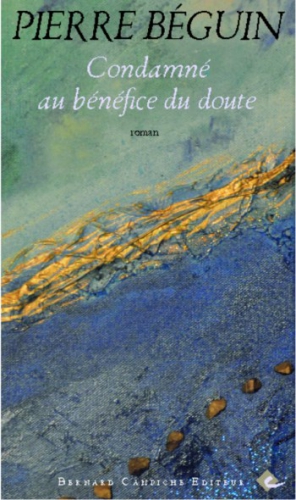 Il y a, en Pierre Béguin, la curiosité de démonter une montre pour voir comment elle fonctionne. Plus le mécanisme est complexe, plus il y prend de l'intérêt. Et mécanisme complexe il y a, dans l'affaire et le personnage dont traite son dernier livre, Condamné au bénéfice du doute
Il y a, en Pierre Béguin, la curiosité de démonter une montre pour voir comment elle fonctionne. Plus le mécanisme est complexe, plus il y prend de l'intérêt. Et mécanisme complexe il y a, dans l'affaire et le personnage dont traite son dernier livre, Condamné au bénéfice du doute parsème ses discours de références littéraires. Il y a du Balzac dans la description de la maîtresse en fille-fleur, quand Joncour la voit pour la première fois. Il y a du Hugo dans certains accents des discours concernant la justice, au début du livre... L'amplitude de ce style classique dix-neuviémiste, de ces phrases balancées, qui cherchent la nuance juste, servent le récit et lui donnent une cohérence forte : on se trouve dans la tête de Joncour, et son fonctionnement en est éclairé.
parsème ses discours de références littéraires. Il y a du Balzac dans la description de la maîtresse en fille-fleur, quand Joncour la voit pour la première fois. Il y a du Hugo dans certains accents des discours concernant la justice, au début du livre... L'amplitude de ce style classique dix-neuviémiste, de ces phrases balancées, qui cherchent la nuance juste, servent le récit et lui donnent une cohérence forte : on se trouve dans la tête de Joncour, et son fonctionnement en est éclairé.




 Voici le premier roman d'un nouvel écrivain valaisan. Valaisan, car même si Olivier Pitteloud vit et travaille dans le canton de Fribourg, son livre évoque les montagnes et les villages des Alpes ; les ambiances qu'il suscite et l'écriture qu'il façonne sont liés au Valais.
Voici le premier roman d'un nouvel écrivain valaisan. Valaisan, car même si Olivier Pitteloud vit et travaille dans le canton de Fribourg, son livre évoque les montagnes et les villages des Alpes ; les ambiances qu'il suscite et l'écriture qu'il façonne sont liés au Valais.