La Dame de la montagne (Olivier Beetschen)
par Jean-Michel Olivier
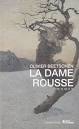 Il y a, au cœur du dernier livre d'Olivier Beetschen, La Dame rousse*, une légende fascinante : celle des « Fils de l'aigle », une famille au destin tragique (et glorieux) habitant une vallée perdue de l'Oberland bernois, dont les enfants, au XVe et XVIe siècle, s'illustrèrent comme farouches mercenaires lors des sanglantes batailles de l'époque. L'histoire de ces trois « fils de l'aigle » occupe la partie centrale du roman, ainsi que la légende de la dame rousse, une femme mystérieuse débarquant un jour chez les « Farouches », après avoir vaincu col et glacier en plein hiver, puis disparue dans la nature, et qui devint leur mère. Cette dame rousse — son fantôme — hante encore la région, comme l'imagination des voyageurs (et des romanciers).
Il y a, au cœur du dernier livre d'Olivier Beetschen, La Dame rousse*, une légende fascinante : celle des « Fils de l'aigle », une famille au destin tragique (et glorieux) habitant une vallée perdue de l'Oberland bernois, dont les enfants, au XVe et XVIe siècle, s'illustrèrent comme farouches mercenaires lors des sanglantes batailles de l'époque. L'histoire de ces trois « fils de l'aigle » occupe la partie centrale du roman, ainsi que la légende de la dame rousse, une femme mystérieuse débarquant un jour chez les « Farouches », après avoir vaincu col et glacier en plein hiver, puis disparue dans la nature, et qui devint leur mère. Cette dame rousse — son fantôme — hante encore la région, comme l'imagination des voyageurs (et des romanciers).
Cette légende, magnifiquement racontée par Beetschen (qui trouve ici une occasion de déclarer son amour à la montagne), obsède deux amis d'enfance, Luc Riesen et Alain Baud, qui entreprennent une ascension périlleuse en revenant sur les lieux de la légende de Pirmina. Car La Dame rousse est aussi l'histoire d'une amitié entre deux hommes, malheureux en amour, qui se connaissent depuis trente ans. Alain Baud est guide de montagne, féru de de mythes et de légendes et possède un caractère bien trempé, tandis que Luc Riesen, sortant à peine d'un divorce douloureux, cherche un sens à sa vie, interroge la nature et reste fasciné par la légende que son ami lui raconte.
Ces deux récits (la légende de Pirmina et l'amitié entre deux hommes) s'entrelacent de manière très subtile, égarant quelquefois le lecteur, qui perd le fil. On aimerait en savoir plus sur ces deux hommes, compagnons d'infortune, si différents et si proches l'un de l'autre, sur leur quête de sens, leur besoin d'affronter leurs limites et leur passion de la montagne. Si la légende des « Fils de l'Aigle » est menée à son terme (avec maestria !), dépliée dans ses moindres détails  (Beetschen a le sens, très rare en Suisse romande, de l'épopée et du symbole), et le récit de l'ascension évoqué dans une langue extraordinaire (précise, sensuelle et poétique), qui fait penser immanquablement à Ludwig Hohl, l'histoire de cette amitié virile laisse un peu le lecteur sur sa faim.
(Beetschen a le sens, très rare en Suisse romande, de l'épopée et du symbole), et le récit de l'ascension évoqué dans une langue extraordinaire (précise, sensuelle et poétique), qui fait penser immanquablement à Ludwig Hohl, l'histoire de cette amitié virile laisse un peu le lecteur sur sa faim.
Plusieurs figures féminines hantent ce beau roman de la désolation et du dépassement de soi : Christine, la femme séparée du narrateur, Julie, l'épouse d'Alain partie à l'aventure en Amérique, et la Dame rousse, bien sûr, la belle Pirmina, qui représente à la fois le mystère féminin et l'esprit de la montagne. La fée et le démon. La tentatrice, mais également la salvatrice.
Le roman se termine avec une autre femme, Edwige, rencontrée à la montagne et retrouvée, comme par enchantement, dans une bibliothèque de Fribourg. Quand Alain Baud était possédé par la folie de la montagne (et l'ivresse des sommets), Edwige aime s'enfoncer au cœur de la terre, dans les grottes, les crevasses, les glaciers souterrains. C'est là, d'ailleurs, dans les entrailles obscures de la terre, sous la peau des apparences, qu'elle entraînera Luc dans une dernière quête qui ressemble fort à une nouvelle naissance.
* Olivier Beetschen, La Dame rousse, roman, l'Âge d'Homme, 2016.
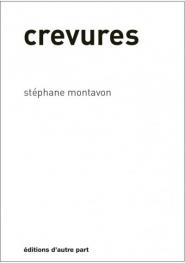 Il semble que les textes de Crevures aient été rédigés il y a une vingtaine d'années, puis retravaillés, revivifiés. Le résultat en tout cas inhabituel.
Il semble que les textes de Crevures aient été rédigés il y a une vingtaine d'années, puis retravaillés, revivifiés. Le résultat en tout cas inhabituel. Parfois c'est beaucoup, c'est trop, il y a comme un surplus de distillation. Le lyrisme tourne en préciosité, le lecteur perd sa respiration et choppe le tournis, les phrases deviennent un jeu formel qui paraît gratuit.
Parfois c'est beaucoup, c'est trop, il y a comme un surplus de distillation. Le lyrisme tourne en préciosité, le lecteur perd sa respiration et choppe le tournis, les phrases deviennent un jeu formel qui paraît gratuit. Avec La Dame rousse, Olivier Beetschen nous propose un roman à plusieurs niveaux qui s'emboîtent habilement et qui tournent autour d'un thème, annoncé par le titre.
Avec La Dame rousse, Olivier Beetschen nous propose un roman à plusieurs niveaux qui s'emboîtent habilement et qui tournent autour d'un thème, annoncé par le titre.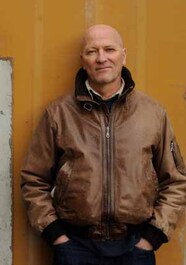 Le roman, outre les portraits bien menés de ces deux personnages, propose également une histoire de leur amitié. Très bien écrit, il balade le lecteur à travers différents lieux de Suisse romande.
Le roman, outre les portraits bien menés de ces deux personnages, propose également une histoire de leur amitié. Très bien écrit, il balade le lecteur à travers différents lieux de Suisse romande.
 C’est vous dire le plaisir – que dis-je, la jubilation! – que j’ai éprouvé à la lecture du dernier «roman» de Delphine de Vigan, D’après une histoire vraie. Diaboliquement habile! Et jouissif! L’histoire commence le plus simplement par la rencontre d’une auteure – qui est aussi la narratrice – en panne d’inspiration, cherchant à renouer avec la fiction pour ne plus à avoir de compte à rendre avec le réel, et d’une lectrice rapidement intrusive et manipulatrice qui, elle, exige d’un livre du vrai, de l’authentique. Une rencontre qui semble placer l’histoire dans le registre d’un thriller psychologique, impression renforcée par l’exergue: une citation d’un célèbre roman de Stephan King dans lequel un écrivain, recueilli par une lectrice fan après un accident, est torturé par celle qui l’a sauvé et qui exige de son auteur idolâtré une autre fin à son dernier manuscrit. Sauf que, dans D’après une histoire vraie, comme le signifie le titre, l’auteure personnage et narratrice s’appelle Delphine de Vigan, que les lieux, les événements, les personnages, à commencer par son compagnon François (Busnel), se donnent pour véridiques, ce que le lecteur peut facilement vérifier et authentifier. La romancière multiplie à ce point les effets de réel que le lecteur – à commencer par moi –, tout naturellement influencé encore par le titre, s’installe dans un récit dont il déchiffre a priori les événements comme s’ils relevaient de la biographie. Et il souffre pour cette pauvre Delphine tout en s’offusquant de son inconscient de François devant la manipulation qui menace de tourner au drame, d’autant plus qu’il croit que ce qui est raconté a véritablement eu lieu. Avant de réaliser (pour moi, ce fut au tiers du livre, pour d’autres ce pourrait être avant ou après) qu’il est dupe d’un récit qui se donne pour la vérité par la seule accumulation des effets de réel, alors que tout – ou presque, probablement – n’est qu’invention, travestissement, imagination. Et de comprendre que l’unique personne réellement manipulée dans cette histoire, ce n’est pas cette pauvre Delphine mais le lecteur lui-même, et qui plus est manipulé par cette pauvre Delphine elle-même… Diabolique! Il y a du Barbey d’Aurevilly dans ce roman, dans la nature de la relation narrateur lecteur, dans la stratégie perverse du narrateur – de la narratrice en l’occurrence – qui attire le lecteur par une promesse non tenue, qui jouit de l’exigence de ce dernier en manipulant son désir, qui affirme son pouvoir pour mieux tenir sa victime dans l’évidence de sa dépendance.
C’est vous dire le plaisir – que dis-je, la jubilation! – que j’ai éprouvé à la lecture du dernier «roman» de Delphine de Vigan, D’après une histoire vraie. Diaboliquement habile! Et jouissif! L’histoire commence le plus simplement par la rencontre d’une auteure – qui est aussi la narratrice – en panne d’inspiration, cherchant à renouer avec la fiction pour ne plus à avoir de compte à rendre avec le réel, et d’une lectrice rapidement intrusive et manipulatrice qui, elle, exige d’un livre du vrai, de l’authentique. Une rencontre qui semble placer l’histoire dans le registre d’un thriller psychologique, impression renforcée par l’exergue: une citation d’un célèbre roman de Stephan King dans lequel un écrivain, recueilli par une lectrice fan après un accident, est torturé par celle qui l’a sauvé et qui exige de son auteur idolâtré une autre fin à son dernier manuscrit. Sauf que, dans D’après une histoire vraie, comme le signifie le titre, l’auteure personnage et narratrice s’appelle Delphine de Vigan, que les lieux, les événements, les personnages, à commencer par son compagnon François (Busnel), se donnent pour véridiques, ce que le lecteur peut facilement vérifier et authentifier. La romancière multiplie à ce point les effets de réel que le lecteur – à commencer par moi –, tout naturellement influencé encore par le titre, s’installe dans un récit dont il déchiffre a priori les événements comme s’ils relevaient de la biographie. Et il souffre pour cette pauvre Delphine tout en s’offusquant de son inconscient de François devant la manipulation qui menace de tourner au drame, d’autant plus qu’il croit que ce qui est raconté a véritablement eu lieu. Avant de réaliser (pour moi, ce fut au tiers du livre, pour d’autres ce pourrait être avant ou après) qu’il est dupe d’un récit qui se donne pour la vérité par la seule accumulation des effets de réel, alors que tout – ou presque, probablement – n’est qu’invention, travestissement, imagination. Et de comprendre que l’unique personne réellement manipulée dans cette histoire, ce n’est pas cette pauvre Delphine mais le lecteur lui-même, et qui plus est manipulé par cette pauvre Delphine elle-même… Diabolique! Il y a du Barbey d’Aurevilly dans ce roman, dans la nature de la relation narrateur lecteur, dans la stratégie perverse du narrateur – de la narratrice en l’occurrence – qui attire le lecteur par une promesse non tenue, qui jouit de l’exigence de ce dernier en manipulant son désir, qui affirme son pouvoir pour mieux tenir sa victime dans l’évidence de sa dépendance. Quand je pense au recueil En plein vol, les images qui me reviennent sont d'abord suscitées par la dernière nouvelle. Elle se passe en Inde. Une jeune voyageuse arrive dans un milieu de routards et de junkies occidentaux où elle croise quelques personnages marginaux. Ou, plutôt, ils seraient marginaux en Europe, mais ils sont tolérés et même respectés en Inde, où le rapport à la drogue n'est pas le même, où il est parfois sacré.
Quand je pense au recueil En plein vol, les images qui me reviennent sont d'abord suscitées par la dernière nouvelle. Elle se passe en Inde. Une jeune voyageuse arrive dans un milieu de routards et de junkies occidentaux où elle croise quelques personnages marginaux. Ou, plutôt, ils seraient marginaux en Europe, mais ils sont tolérés et même respectés en Inde, où le rapport à la drogue n'est pas le même, où il est parfois sacré. Ceux-ci, surtout des femmes, sont analysés avec finesse. Certaines d'entre elles assument le rôle traditionnel que la société leur destine : par exemple cette vacancière qui rêve d'enfant, d'amis et de chez soi alors que son compagnon, bien loin de cette utopie familiale, ne songe qu'à fumer des pétards. D'autres échappent à leurs rôles : on voit dans les récits d'Anne Pitteloud que les femmes ne sont pas forcément maternelles avec les enfants, ou se montrent parfois dégourdies lorsqu'il s'agit de fantaisies érotiques très poussées... Pour les détails, lire le recueil !
Ceux-ci, surtout des femmes, sont analysés avec finesse. Certaines d'entre elles assument le rôle traditionnel que la société leur destine : par exemple cette vacancière qui rêve d'enfant, d'amis et de chez soi alors que son compagnon, bien loin de cette utopie familiale, ne songe qu'à fumer des pétards. D'autres échappent à leurs rôles : on voit dans les récits d'Anne Pitteloud que les femmes ne sont pas forcément maternelles avec les enfants, ou se montrent parfois dégourdies lorsqu'il s'agit de fantaisies érotiques très poussées... Pour les détails, lire le recueil !