L'odyssée amoureuse de Serge Bimpage

par Jean-Michel Olivier
On voyage beaucoup avec les livres de Serge Bimpage. Dans l'espace comme dans le temps. Après Pokhara*, qui racontait les retrouvailles de deux amis partis faire un trekking au Népal, voici Le Voyage inachevé**, un roman ample et profond qui emmène le lecteur faire le tour du monde, sur les pas du héros, Anteo, et de sa dulcinée, joliment prénommée Nomia. On voit que, chez Bimpage, tout se joue déjà dans le nom des personnages qu'il met en scène, prédestinés à ne jamais se comprendre. À se poursuivre sans se trouver.
Anteo mène une vie trop tranquille à Genève où il dirige une galerie de peinture. Il est marié à Solange, une femme énergique et solide, qui a su « le mettre au pas ». Il a beaucoup rêvé d'horizons lointains, « incapable de se construire une vie héroïque dans ce foutu pays qui non seulement n'a pas d'histoire, mais la subit ». Il a beaucoup roulé sa bosse avant de revenir s'installer dans sa ville, d'ouvrir sa galerie et de vivre auprès de Solange. Dans ce bonheur un peu trop calme, Anteo reçoit un jour un message de Nomia, une femme qu'il a aimée et avec qui, vingt ans plus tôt, il est parti, sac au dos, faire le tour du monde. Nomia est de retour. Elle propose de lui rendre le journal de bord qu'Anteo a tenu lors de ce fameux voyage, qu'on pourrait dire initiatique. Anteo est troublé. Il ne sait s'il doit (ou non) revoir Nomia. En attendant ces improbables retrouvailles, il revisite son passé, avec un luxe de détails (car sa mémoire est féconde). Il cherche à déchiffrer le mystère de Nomia. Pourquoi sont-ils partis ensemble ? Et pourquoi, au milieu du voyage, la jeune femme l'a-t-elle quitté ?
Retournant, par la mémoire, sur les lieux du voyage (certains paysages sont âpres et obsédants ; d'autres sont toujours enchantés), Anteo ne tarde pas à s'interroger sur le sens de sa propre vie. Tout se passe, remarque-t-il, comme s'il était toujours dehors.  « Au bord de lui-même. Ne se penchant sur son moi que par incidences hasardeuses et dans la crainte d'y tomber. » Le récit nostalgique vire alors au voyage intérieur. Et l'on n'est pas surpris, dans cette odyssée amoureuse, de retrouver la figure familière d'Ulysse. Se consolant, ici, du départ de Nomia dans les bras de la belle Calypso. Ou, là, cherchant à échapper au charme des sirènes ou à l'appel de Circé.
« Au bord de lui-même. Ne se penchant sur son moi que par incidences hasardeuses et dans la crainte d'y tomber. » Le récit nostalgique vire alors au voyage intérieur. Et l'on n'est pas surpris, dans cette odyssée amoureuse, de retrouver la figure familière d'Ulysse. Se consolant, ici, du départ de Nomia dans les bras de la belle Calypso. Ou, là, cherchant à échapper au charme des sirènes ou à l'appel de Circé.
Ce voyage mémoriel se double, dans le livre de Bimpage, d'un voyage « réel », puisque le héros, accompagné de Solange, son « ange gardien », décide de partir pour le Cambodge. Un voyage recouvre l'autre comme un palimpseste. Les images surgissent, au gré de la mémoire, parfois réelles, parfois réinventées (car nous inventons bien souvent notre passé). Paysages, virées en mer, visages de femmes : le narrateur est pris dans un tourbillon de souvenirs qui l'empêchent de vivre le présent. Bimpage évoque admirablement cette foule disparate et muette, surgie du passé, qui hurle et veut sortir de l'ombre. Il est quelquefois dangereux d'exhumer des souvenirs…
Nomia ou l'empreinte de l'amour : tel pourrait être le titre du livre de Serge Bimpage — s'il n'était déjà le titre d'un autre livre du même auteur ! Qui poursuit, ici, son interrogation sur les pouvoirs de la mémoire, le désir d'ailleurs, l'empreinte torturante du premier amour. Dans le Voyage inachevé, Bimpage creuse ces thèmes, au risque de s'y perdre. Mais c'est la force des bons écrivains d'oser poser de telles questions. Et de tenter, par le roman, d'y répondre.
* Serge Bimpage, Pokhara, roman, L'Aire, 2006.
** Le Voyage inachevé, roman, L'Aire, 2011.

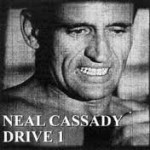

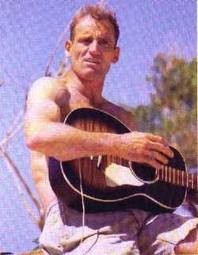

 Retenez bien ce nom, aux allures de pseudonyme ethno : Douna Loup. Douna comme Douna, une petite ville du Burkina Faso. Et Loup comme le grand méchant loup, et comme le Théâtre du même nom. Car Douna Loup vit à Genève où elle est née en 1982, de parents marionnettistes. Si l'on en croit Culturactif, « elle passe son enfance et son adolescence dans la Drôme. À dix-huit ans, son Baccalauréat Littéraire en poche, elle part pour six mois à Madagascar en tant que bénévole dans un orphelinat. À son retour elle s'essaye à l'ethnologie, elle nettoie une banque suisse pendant trois mois, garde des enfants durant une année, écrit sa première nouvelle, puis devient mère, et étudie les plantes médicinales. Après avoir vendu des tisanes sur les marchés et obtenu un certificat en Ethno-médecine, elle se consacre pleinement à l'écriture et à ses deux filles. »
Retenez bien ce nom, aux allures de pseudonyme ethno : Douna Loup. Douna comme Douna, une petite ville du Burkina Faso. Et Loup comme le grand méchant loup, et comme le Théâtre du même nom. Car Douna Loup vit à Genève où elle est née en 1982, de parents marionnettistes. Si l'on en croit Culturactif, « elle passe son enfance et son adolescence dans la Drôme. À dix-huit ans, son Baccalauréat Littéraire en poche, elle part pour six mois à Madagascar en tant que bénévole dans un orphelinat. À son retour elle s'essaye à l'ethnologie, elle nettoie une banque suisse pendant trois mois, garde des enfants durant une année, écrit sa première nouvelle, puis devient mère, et étudie les plantes médicinales. Après avoir vendu des tisanes sur les marchés et obtenu un certificat en Ethno-médecine, elle se consacre pleinement à l'écriture et à ses deux filles. »

 par Jean-Michel Olivier
par Jean-Michel Olivier Cette vie en poésie, Clavien nous le rappelle à chaque instant, c’est notre
Cette vie en poésie, Clavien nous le rappelle à chaque instant, c’est notre par Jean-Michel Olivier
par Jean-Michel Olivier