Arnaud Desplechin adapte Philip Roth
par Corine Renevey
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
par Corine Renevey
Par Frédéric Wandelère
(Poète, essayiste, traducteur, Frédéric Wandelère est né et vit à Fribourg. Il a publié à ce jour huit recueils de poésie et traduit des textes de lieder de Schumann, Wolf, Mahler et Schubert. Son goût pour le lied et la voix l'a conduit à réhabiliter en conférence, au Grand Théâtre de Genève, la plus célèbre cantatrice du XXe siècle, Bianca Castafiore. Je suis heureux de l'accueillir dans Blogres.)
Je me suis demandé si la vogue des mots-valises – démocrature : démocratie-dictature – qui a très longtemps sévi, notamment dans les journaux et les hebdomadaires, ne préparait pas le terrain à l’écriture inclusive qui associe en un seul mot, moyennant l’insertion d’un point médian, le masculin au féminin : écrivain.e, étudiant.e.s, vert.e.s avec quelques situations problématiques sur la place du point, les marques du pluriel, et sur la prononciation du mot en contexte. Faut-il prononcer le député vert.e.s Laurent Dupont, ou le député vert, mais dans ce cas, les vert.e.s au féminin ne vont-elles pas se sentir exclues ? Comment lire les rect.eur.rice.s de Suisse ? Faut-il, quand on écrit, mettre le point après rect, ou après recteur et ajouter rice puis le point, puis le s ? Même problème pour l’adjectif cher, au féminin chère ? C’est l’accent qui pose un problème ! Faut-il noter ch suivi du point, puis er pour le masculin, suivi du point, puis ère, ainsi : ch.er.ère.s ? il le faudrait car l’accent grave, dans ce cas, fait légitimement partie du féminin. Donc infirmi.er.ère.s. Des étudiant.e.s étrang.er.ère.s, fi.er.ère.s de leurs origines. Les tableaux et sculptures impéri.aux.ales. Les aili.er.ère.s latér.aux.ales, atout.e.s des Servettes masculin.féminin. Faut-il mettre le s du pluriel après masculin.féminin puisqu’il y a deux Servettes, ou faut-il garder le singulier puisqu’il n’y a qu’un Servette masculin et qu’une Servette féminine ? En outre on peut féminiser masculin.e, et masculiniser féminin.e, mais on ne peut pas vraiment conserver masculin.e pour nommer une joueuse, même si le club est composé de joueu.r.se.s des deux sexes.
L’orthographe inclusive est loin d’être régularisée et il faut s’attendre à une pluie de règles assorties d’exceptions variées.
En outre, les débats sur l’écriture inclusive sont en plein essor, et sur ce point il me faut donner tort à Alain Rey, peu prophète, qui disait dans une interviou du Figaro du 23 novembre 2017 que « l'affaire de l'écriture inclusive [était] une tempête dans un verre d'eau ; que dans six mois, plus personne n'en [parlerait]... » Les six mois ont passé, rallongés même de plus de quatre ans, et on en parle toujours !
On n’a pas encore envisagé, en poésie, toutes les virtualités de l’écriture inclusive. L’insertion du fameux point médian permet non seulement d’agglutiner le masculin et le féminin – avec cette petite pointe d’obscénité qu’on a peu remarquée, alors qu’ils fricotent ouvertement sous nos yeux et ceux des calvinistes – mais aussi d’associer, par la vertu des genres masculin et féminin, des mots orthographiquement proches bien que sémantiquement éloignés : petits points, petites pointes : petit.e.s point.e.s. Le boulot et la boulotte ouvrent des perspectives intéressantes : boulot.te ; le bout et la boue aussi, mais le placement du point est problématique; on résoudra le problème en plaçant d’abord le féminin, ainsi: bou.e.t ; bluet et bluette c’est de la poésie d’autrefois, modernisée par l’inclusivité : bluet.te ; basilic et basilique sont fait.e.s pour s’entendre: basili.c.que ; gogo et goguette aussi, beau syntagme métaphorique de l’inclusivisme : go.go.guette ; îlot et ilote posent un problème d’accent circonflexe, mais on fera, pour la circonstance, une exception : îlot.e ; le joug et la joue posent également un problème particulier, les débutants liront « *jouge » au féminin: jou.g.e . On poursuivra nos explorations langagières avec le non et la nonne : non.ne ; lani.er.ère ; lias.se ; lieu.e ou lieu.se; li.n.gne... Que de perspectives, de possibilités! Un vrai sabbat sémantique s’annonce. Ce serait le huitième jour!
Evidemment cela devient un peu cérébral, mais on a vu pire en poésie; quant aux souffrances de l’écriture inclusive, elles auront peut-être le mérite de nous faire aimer le baume de la toute simple orthographe française!
par Pierre Béguin
A une époque où toute une génération «woke» est prompte à manifester son indignation face à des figures historiques accusées d’être de très méchants colonialistes, je m’étonne que l’expression «colonialisme écologique», que j’ai déjà utilisée dans un précédent billet, n’ait pas encore fait son chemin. Personnellement, je ne l’ai à ce jour ni lue ni entendue nulle part. Et pourtant…
Récemment encore, une émission – Dossier tabou – sur M6 décrivait précisément, sans la nommer, cette nouvelle forme de colonialisme. Le Ghana, pour ne prendre qu’un exemple, est devenu la première déchetterie mondiale d’articles électroniques en fin de vie. De gigantesques terrains servent de décharges à ciel ouvert où s’entassent des milliers de tonnes de déchets électroniques, vendus «officiellement» comme des produits de seconde main, dont une partie croissante est issue des énergies renouvelables, ou dites «vertes». Une partie qui, une fois brûlée, noircie, sur d’immenses terrains vagues répandant dans l’atmosphère une fumée aussi noire que toxique – ou dans la mer une eau qui ressemble à un affreux bouillon brunâtre –, n’a plus grand-chose de «verte», et dont on imagine aisément qu’elle ne fera qu’augmenter exponentiellement dans les années à venir. Dans tous les cas, l’Afrique semble destinée à devenir le dépotoir de la transition écologique, lorsque nos batteries électriques et nos panneaux solaires, devenus caducs, devront être remplacés. Voilà pour la situation en aval.
En amont, elle ne semble guère plus réjouissante. Pour produire cette énergie «vertueusement verte», tout le monde sait qu’il faut beaucoup de minerais, en particulier des Terres rares et du Silicium. A titre d’exemple, pour extraire un kilo de Silicium, une usine a besoin de 280 kilos de produits chimiques, chlore, acide nitrique, ammoniaque, etc. Malgré son abondance, le Silicium est donc impossible à extraire "écologiquement", de même les Terres rares qu'il faut préalablement séparer et isoler du reste. Le 80 % du marché des métaux précieux est détenu par la Chine qui les produit à bas prix, dans d’effroyables conditions qui ne respectent rien, ni principes écologiques ni droits de l’homme élémentaires. Quant à la «déesse nature», elle est éventrée à coups de bulldozers pour extraire le silicium, matière première indispensable au fonctionnement des panneaux solaires, dans des carrières bondées d’ouvrières payées une dizaine d’euros pour trier les pierres selon leur «pureté» apparente; des ouvrières – et leurs familles – qui ignorent que les eaux polluées de la mine s’écoulent dans les rivières de la région, et qui doivent encore endurer les fumées toxiques rejetées dans l’atmosphère. Dans certaines villes – et pas seulement en Chine, en Afrique ou au nord du Chili par exemple – la pollution est telle qu’on n’y voit plus le soleil et que des populations traînent toutes sortes de maladies fatales à court ou moyen terme. Bien entendu, aucune analyse de l’air et de l’eau n’y est plus effectuée. Pas de chiffres officiels non plus sur les maladies respiratoires, cancers, ou symptômes liés à cette pollution. Tout cela au nom de la transition écologique et des énergies vertes prônées par l’Occident et son pitoyable – pour ne pas dire criminel – désir de pureté.
Un Occident qui, toujours au nom du vertueusement vert, n’est lui-même guère plus respectueux avec Dame Nature. Une prolifération d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques entraîne une industrialisation des campagnes, des montagnes, des mers. 8000 éoliennes sont actuellement implantées sur territoire français. Nos voisins en attendent 20000 pour 2028. Paris subventionne fortement la production d’électricité éolienne, ce qui permet aux promoteurs, agissant au nom de grands trusts souvent mafieux sur les bords (et même au centre), de payer des sommes mirobolantes (jusqu’à 1000 euros par mois et par éolienne) à des paysans, que Bruxelles a préalablement asphyxiés financièrement, pour implanter des éoliennes sur leurs terrains. 121 milliards seront versés d’ici 2046 aux filières des énergies intermittentes, un surcoût énorme puisé dans la facture mensuelle des citoyens dont la taxe a déjà augmenté de 650 % depuis sa création, – mais le libellé de cette ponction est aussi discret et alambiqué que le rendement des hélices.
L’implantation d’une éolienne nécessite 1500 tonnes de béton1, pour une production qui n’atteint que 25 % de son temps et une durée de vie qui ne dépasse pas 25 ans. Sa pollution n’est pas seulement visuelle, mais aussi sonore. Qu’importe! En France, on a modifié sans autre, tout spécialement pour les éoliennes, la loi sur les limites sonores. Une éolienne peut maintenant en toute légalité émettre jusqu’à 35 dBA, même si certaines sont mesurées à 40 dBA. Pour leur implantation en mer, dans la baie de Saint-Brieuc par exemple, pourtant estampillée parc naturel, la très pure et vertueuse Ségolène Royale, alors ministre de l’environnement, n’a pas hésité à sacrifier contractuellement des dizaines d’espèces protégées, à tel point que même une ONG écologiquement aussi militante que Sea Sheperd se bat aux côtés des pêcheurs pour entraver la réalisation d’un tel projet.
Si le 80 % des éoliennes en fin de vie sont recyclables, ses pales ne le sont pas. On ne peut ni les brûler, ni les découper, ni les broyer, et leur évacuation coûte une fortune. En France, on peut voir des pales abandonnées au pied de leurs anciens mâts. Aux États-Unis, on les enterre «vivantes» par milliers dans de gigantesques cimetières. Mais quand on ne dispose pas des vastes territoires du Wyoming, on est en droit de se demander ce qui nous attend dans 20 ans, quand sonnera l’heure de remplacer des dizaines de milliers de pales hors d’usage...
Quant aux immenses champs de panneaux photovoltaïques, la situation n’est guère plus «verte». Pour lutter contre le CO2, on abat des centaines d’hectares de forêts susceptibles de capter du CO2, afin d’y implanter des dizaines de milliers de panneaux solaires qui émettent d’énormes quantités de CO2 pour leur construction. Peu importe! On déforeste les campagnes, mais on reverdit les villes. Si le gain écologique paraît douteux, on voit en revanche très bien ce que certains pans de l’économie y gagnent.
Cette fameuse révolution verte, faite à marche forcée, soutenue régulièrement par les bilans alarmistes du GIEC, implantée dans la conscience collective par la peur du réchauffement climatique – devenu indifféremment, pour les besoins de la cause, «urgence», «crise» et enfin «dérèglement» – , et financée par les fonds publics (89 trillions de dollars annoncés par la Banque mondiale entre 2015 et 2030), cette fameuse révolution verte, disais-je, pourrait bien se révéler le plus monstrueux racket de toute l’histoire de l’humanité. Et le «plan climat» lancé à Genève par Hodgers & Cie, fixé à 650 millions par année, s’inscrit en droite ligne dans cette logique. Allez les verts!
Dans tous les cas, la transition écologique, vue sous l’angle de sa production et de son «recyclage», n’est plus qu’une gigantesque hypocrisie, un tour de passe-passe par lequel les grands trusts des pays riches, après avoir épuisé les fonds publics avec la bénédiction des États, se débarrassent sur l’hémisphère sud des déchets issus des vertueuses énergies «vertes».
Et si notre jeunesse, souvent toute dégoulinante de «verdeurs vertueuses», se sent climato-anxieuse, elle ne devrait pas oublier pour autant que son désir de pureté verte, érigé en religion, cache en réalité un genre de colonialisme qui n’a rien à envier en laideur à celui qu’elle reproche «vertement» à ses aînés et à leurs affreux aïeux. En ce sens, les statues qu’elle déboulonne ne sont peut-être pas les cibles idéales.
Oui, je crois que l’expression «colonialisme écologique» ne tardera pas à envahir le champ des consciences, avant que la bien-pensance ne la récupère comme un slogan. Je m’étonne d’ailleurs que la gauche ne l’ait pas encore fait. Il est vrai que la gauche a épousé la bien-pensance en communauté de biens et pour le pire, et que ladite bien-pensance est aujourd’hui résolument estampillée énergies (soit disant) vertes, éoliennes et photovoltaïques en bannières.
Du temps que ses yeux se dessillent, notre monde pourrait bien ressembler à celui de Mad Ma(r)x...
1Le béton est responsable de 52% des émissions de gaz à effet de serre du secteur de la construction, lui-même responsable de 19% des émission : https://www.build-green.fr/beton-et-co2-un-desastre-ecologique/
par Jean-Michel Olivier
« J'ai depuis longtemps pris le chemin qui ne mène à rien. » 29 septembre 1860.
 Sans doute Henri-Frédéric Amiel, le diariste le plus célèbre du monde, a-t-il réalisé, trois ans après la publication de Madame Bovary, le vœu secret de Gustave Flaubert : « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l'air, un livre qui n'aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible... » Ce parfait contemporain de Flaubert, mais aussi de Baudelaire, de Dostoïevski et de Melville (tous nés en 1821) nous a donné le journal intime le plus riche et le plus fascinant de la littérature (près de 17'000 pages, publiés en 12 volumes par les éditions de L'Âge d'Homme).
Sans doute Henri-Frédéric Amiel, le diariste le plus célèbre du monde, a-t-il réalisé, trois ans après la publication de Madame Bovary, le vœu secret de Gustave Flaubert : « Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c'est un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient en l'air, un livre qui n'aurait presque pas de sujet ou du moins où le sujet serait presque invisible... » Ce parfait contemporain de Flaubert, mais aussi de Baudelaire, de Dostoïevski et de Melville (tous nés en 1821) nous a donné le journal intime le plus riche et le plus fascinant de la littérature (près de 17'000 pages, publiés en 12 volumes par les éditions de L'Âge d'Homme).
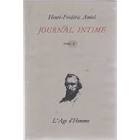 Quand Amiel commence à écrire son journal, c'est pour noter quelques faits saillants de sa vie, parfois infimes : une sorte de journal de bord qui tient lieu d'aide-mémoire et de vademecum à un jeune homme qui cherche son chemin. Mais très vite ce journal grossit, s'approfondit, devient un fleuve aux remous effrayants qui emporte le diariste dans une forêt de réflexions personnelles et de questionnements incessants. Au point que ce journal, qui devait servir d'aide-mémoire à sa vie, devient une œuvre à part entière. Amiel n'écrit plus pour rendre compte de sa vie (assez pauvre et banale, disons-le), mais il vit pour écrire son journal : c'est désormais un rendez-vous essentiel de ses journées. À peine rentré chez lui, au retour d'une visite à l'une de ses nombreuses amies, il lui faut coucher par écrit non seulement le déroulement de cette visite, mais encore les questions qu'il se pose, morales, amoureuses, philosophiques, etc. Autrement dit, Amiel se fait l'arpenteur de l’intime autant qu’un infatigable promeneur de nos campagnes genevoises ou vaudoises (comme Rousseau, la pensée lui vient en marchant), avec quelques détours par Berlin et l’Allemagne ou la France des philosophes et des poètes, mais guère plus.
Quand Amiel commence à écrire son journal, c'est pour noter quelques faits saillants de sa vie, parfois infimes : une sorte de journal de bord qui tient lieu d'aide-mémoire et de vademecum à un jeune homme qui cherche son chemin. Mais très vite ce journal grossit, s'approfondit, devient un fleuve aux remous effrayants qui emporte le diariste dans une forêt de réflexions personnelles et de questionnements incessants. Au point que ce journal, qui devait servir d'aide-mémoire à sa vie, devient une œuvre à part entière. Amiel n'écrit plus pour rendre compte de sa vie (assez pauvre et banale, disons-le), mais il vit pour écrire son journal : c'est désormais un rendez-vous essentiel de ses journées. À peine rentré chez lui, au retour d'une visite à l'une de ses nombreuses amies, il lui faut coucher par écrit non seulement le déroulement de cette visite, mais encore les questions qu'il se pose, morales, amoureuses, philosophiques, etc. Autrement dit, Amiel se fait l'arpenteur de l’intime autant qu’un infatigable promeneur de nos campagnes genevoises ou vaudoises (comme Rousseau, la pensée lui vient en marchant), avec quelques détours par Berlin et l’Allemagne ou la France des philosophes et des poètes, mais guère plus.
Les grands écrivains ne s'y sont pas trompés : c'est Tolstoi, le premier, qui a exhumé ce gigantesque journal intime, puis Gide, Edmond Jaloux, Julien Green, et encore Roland Jaccard. Grâce à eux, la postérité d'Amiel — simple professeur d'Université à Genève, célibataire endurci, pour ne pas dire vieux garçon, poète médiocre, mais ami fidèle — est assurée. Bien qu'il ait écrit de nombreux ouvrages, Amiel n'a laissé aucune œuvre marquante en littérature — sinon son Journal, qui est devenu l'œuvre de sa vie. Une sorte de pierre tombale.
Un des aspects les plus intéressants de ce monumental journal intime concerne les relations d'Amiel avec les femmes. Cela méritait sinon un roman, du moins une étude approfondie et percutante.  C'est chose faite désormais avec le pétillant livre de Corinne Chaponnière, Seule une valse (les souffrances du jeune Amiel*), paru chez Slatkine. Relisant, avec le scalpel de l'analyse, les innombrables passages dans lesquels le diariste genevois parle de ses conquêtes, elle met à nu la stratégie amoureuse de l'auteur : interminables tergiversations, impuissance à « conclure », peur de s'engager, procrastination constante, etc. Pourtant, dans la première partie de sa vie (de 1845 à 1860) Amiel est en quête perpétuelle d'une femme à épouser, non seulement pour obéir aux conventions de l'époque (un homme doit se marier et fonder une famille), mais aussi parce qu'il recherche sans cesse la femme idéale, la rose bleue qui fera son bonheur. Cela nous vaut quelques portraits inoubliables de « prétendantes », toutes plus ou moins amoureuses, fraîches, jolies, intelligentes et libres, que notre éternel vieux garçon s'ingéniera à repousser (on pense ici aux rapports que Flaubert entretenait avec Louise Collet, la poétesse éprise du romancier), à refroidir aussi (comme si l'amour remettait en question sa propre indépendance et sa personnalité), en disséquant longuement leurs qualités et leurs défauts dans son Journal. Cela nous vaut également des palmarès, des listes et des classements où chaque femme est notée précisément à l'aune des principes de cet impitoyable juge.
C'est chose faite désormais avec le pétillant livre de Corinne Chaponnière, Seule une valse (les souffrances du jeune Amiel*), paru chez Slatkine. Relisant, avec le scalpel de l'analyse, les innombrables passages dans lesquels le diariste genevois parle de ses conquêtes, elle met à nu la stratégie amoureuse de l'auteur : interminables tergiversations, impuissance à « conclure », peur de s'engager, procrastination constante, etc. Pourtant, dans la première partie de sa vie (de 1845 à 1860) Amiel est en quête perpétuelle d'une femme à épouser, non seulement pour obéir aux conventions de l'époque (un homme doit se marier et fonder une famille), mais aussi parce qu'il recherche sans cesse la femme idéale, la rose bleue qui fera son bonheur. Cela nous vaut quelques portraits inoubliables de « prétendantes », toutes plus ou moins amoureuses, fraîches, jolies, intelligentes et libres, que notre éternel vieux garçon s'ingéniera à repousser (on pense ici aux rapports que Flaubert entretenait avec Louise Collet, la poétesse éprise du romancier), à refroidir aussi (comme si l'amour remettait en question sa propre indépendance et sa personnalité), en disséquant longuement leurs qualités et leurs défauts dans son Journal. Cela nous vaut également des palmarès, des listes et des classements où chaque femme est notée précisément à l'aune des principes de cet impitoyable juge.
Corinne Chaponnière déconstruit parfaitement cette stratégie de séduction qui est aussi une manœuvre d'évitement. Si toutes ces femmes sont inaccessibles, et si donc son Journal ne mène à rien, c'est qu'au bout de la conquête, il y aura toujours la sœur interdite. « Amiel a bien raison de regretter la sœur qu'il a eue. Sans elle, il serait un homme marié ; avec une autre sœur qu'elle, il serait un célibataire comblé. N'étant aucun des deux, le voici condamné à poursuivre sans fin des relations fraternelles, des affections sans engagement et des attachements chastes en passant d'une sœur de substitution à une autre, sous la bonne garde d'une duègne intraitable : l'interdit de l'inceste. »
Mais comment connaître parfaitement une femme, condition sine qua non du mariage selon Amiel ? « Une seule valse me tirerait d'incertitude. La main est maintenant pour moi un meilleur instrument de connaissance que l'œil. » A l'instar de Rousseau, son compatriote intime, Amiel vit à travers le regard : celui des autres, bien sûr, toujours important (que va-t-on penser de moi ?), mais aussi le sien propre qui se nourrit de fantasmes et d'illusions idéalistes, surtout lorsqu'il part en quête de l'âme-sœur.
Amiel était protestant dans une ville protestante. Et la religion joue son rôle dans son rapport au monde. Son Journal n'est-il pas l'expression de cet « examen de conscience » auquel tout bon croyant doit se livrer, le plus souvent possible, et qui remplace la confession chère aux catholiques ? De tous les diaristes, Amiel est celui qui pousse le plus loin cet examen de conscience minutieux, obsessionnel, tyrannique. Et cela le mène tout naturellement vers l'indécision et l'impuissance (à agir, en tout cas). Beaucoup de Genevois (et d'écrivains français) se sont reconnus dans cette attitude passive face aux décisions importantes qu'il faut prendre dans sa vie. Là encore, Amiel est un grand défricheur de chemin. Son Journal est une exploration minutieuse des méandres psychologiques des relations humaines, mais aussi une plongée fascinante dans l'inconscient (terme qu'Amiel fut le premier à utiliser en français). C'est encore lui, également, qui introduisit dans ses cours académiques la philosophie de Schopenhauer, inconnu du public français à son époque.
 On n'en a jamais fini avec Amiel. La preuve, parmi cent ouvrages qui lui sont consacrés, on retiendra également l'excellent livre de Luc Weibel, Les petits frères d'Amiel**, qui situe bien la postérité du diariste genevois.
On n'en a jamais fini avec Amiel. La preuve, parmi cent ouvrages qui lui sont consacrés, on retiendra également l'excellent livre de Luc Weibel, Les petits frères d'Amiel**, qui situe bien la postérité du diariste genevois. 
J'aimerais citer encore le beau livre de Jean Vuilleumier, Le Complexe d'Amiel*** qui montre la filiation romande du diariste genevois, de Jean-Pierre Monnier à Yves Velan, de Jacques Chessex à Monique Laederach.
Un dernier mot sur deux livres importants qui célèbrent la mémoire d'Amiel (né il y a tout juste deux cents ans).  Le premier imagine les derniers jours de Henri-Frédéric (dit Fritz) restitués par la plume brillante et acérée de Roland Jaccard, fan de la première heure (Les derniers jours d'Amiel****). Le second est un numéro spécial de la revue Les moments littéraires***** sous la direction de l'excellent Jean-François Duval qui en signe la préface lumineuse. On y retrouve des écrivains romands de talent comme Anne Brécart, Corinne Desarzens, Gustave Roud, Jean-Bernard Vuillème et Luc Weibel, entre autres.
Le premier imagine les derniers jours de Henri-Frédéric (dit Fritz) restitués par la plume brillante et acérée de Roland Jaccard, fan de la première heure (Les derniers jours d'Amiel****). Le second est un numéro spécial de la revue Les moments littéraires***** sous la direction de l'excellent Jean-François Duval qui en signe la préface lumineuse. On y retrouve des écrivains romands de talent comme Anne Brécart, Corinne Desarzens, Gustave Roud, Jean-Bernard Vuillème et Luc Weibel, entre autres.
Les amateurs de journaux intimes ont encore du pain sur la planche !
* Corinne Chaponnière, Seule une valse (les souffrances du jeune Amiel), Slatkine, 2021).
** Luc Weibel, Les petits frères d'Amiel, Zoé, 1997.
*** Jean Vuilleumier, Le Complexe d'Amiel, essai, l'Âge d'Homme, 1985.
**** Roland Jaccard, Les Derniers jours de Henri-Frédéric Amiel, édition Serge Safran, 2018.
***** Amiel et Compagnie, Les Moments littéraires, 2020.