par Jean-Michel Olivier
 On connaît l'état moribond de la critique littéraire en Suisse romande (et en France). La critique universitaire n'existe plus, ayant relégué ses pouvoirs et ses fonctions à la critique journalistique, de plus en plus à l'étroit, hélas, au sein de quotidiens qui — crise de la presse oblige — maigrissent de jour en jour. Pour l'Université, un bon écrivain est un écrivain mort. Les écrivains vivants se replient sur les journaux. Autrefois, ils écrivaient des livres, les publiaient, disparaissaient de la scène publique : c'était l'époque des grands poètes (Mallarmé, Baudelaire, Lautréamont) ou des avant-garde littéraires (Blanchot, Barthes, Foucauld). Aujourd'hui, ils écrivent des bouquins (ou parfois leurs nègres), les publient (ou menacent de les publier) et occupent tout le temps le devant de la scène médiatique (Angot, d'Ormesson, Amélie Nothomb, Marc Levy, etc.).
On connaît l'état moribond de la critique littéraire en Suisse romande (et en France). La critique universitaire n'existe plus, ayant relégué ses pouvoirs et ses fonctions à la critique journalistique, de plus en plus à l'étroit, hélas, au sein de quotidiens qui — crise de la presse oblige — maigrissent de jour en jour. Pour l'Université, un bon écrivain est un écrivain mort. Les écrivains vivants se replient sur les journaux. Autrefois, ils écrivaient des livres, les publiaient, disparaissaient de la scène publique : c'était l'époque des grands poètes (Mallarmé, Baudelaire, Lautréamont) ou des avant-garde littéraires (Blanchot, Barthes, Foucauld). Aujourd'hui, ils écrivent des bouquins (ou parfois leurs nègres), les publient (ou menacent de les publier) et occupent tout le temps le devant de la scène médiatique (Angot, d'Ormesson, Amélie Nothomb, Marc Levy, etc.).
Les temps, décidément, ont bien changé.
La critique littéraire n'existe plus, disais-je. Du moins en Suisse romande (qui a connu, pas si loin de nous, son âge d'Or avec des critiques comme Jean Rousset, Jean Starobinski ou Marcel Reymond). Eh bien non ! Il existe encore un critique qui sauve l'honneur de l'Université. Il s'appelle Vincent kaufmann. D'origine lausannoise, il enseigne la littérature et l'histoire des médias à l'Université de Saint-Gall.  Il est l'auteur d'une biographie incontournable de Guy Debord (La Révolution au service de la poésie, Fayard, 2001) et d'un livre passionnant sur les aventures des théories littéraires (La Faute à Mallarmé, Seuil, 2111). Aujourd'hui, Vincent Kaufmann s'attaque de manière brillante et impitoyable à la littérature entrée (malgré elle ?) dans l'ère du spectacle.
Il est l'auteur d'une biographie incontournable de Guy Debord (La Révolution au service de la poésie, Fayard, 2001) et d'un livre passionnant sur les aventures des théories littéraires (La Faute à Mallarmé, Seuil, 2111). Aujourd'hui, Vincent Kaufmann s'attaque de manière brillante et impitoyable à la littérature entrée (malgré elle ?) dans l'ère du spectacle.
Certes, cela n'est pas nouveau. Les Salons littéraires existent depuis le début du XVIIe siècle (le célèbre Salon de Catherine de Rambouillet). Il s'agissait alors de petits cercles mondains, regroupant, autour d'une hôtesse lettrée, quelques esprits remarquables. Rien à voir, me direz-vous, avec les Salons du livre d'aujourd'hui, grandes foires commerciales où l'on vend tout et n'importe quoi (« Vous aimez le vélo ? Vous allez adorer mon livre ! »), où l'écrivain, sortant pour une fois de sa tanière ou de sa grotte (voir JMO, ici), vient se mettre en représentation parmi d'autres collègues et chercher à se vendre.
Toute l'analyse de Kaufmann, grand lecteur devant l'Eternel, repose sur les intuitions développées par Guy Debord (dans La Société de spectacle, édition Quarto), mais aussi de Marshall McLuhan (« The medium is the message ») et de Régis Debray (Vie et mort de l'image, Folio).  Pour aller vite, Debray divise l'histoire des médias en trois époques distinctes : la logosphère (époque de la parole vive, l'écriture restant l'apanage d'une caste de scribes triés sur le volet) s'étendrait des origines au XVe siècle, date de l'invention de l'imprimerie ; puis, la graphosphère, née du génie de Gutenberg, qui établit pour la première fois la notion et l'autorité de l'auteur (l'auteur signe ses livres et est maître chez lui : le livre est le fruit de sa pensée individuelle); et enfin, la videosphère, époque commençant avec les débuts de la télévision et qui marque l'entrée de l'écrivain dans l'ère du spectacle. Désormais — Debray ne l'avait peut-être pas prévu — nous sommes entrés dans l'âge numérique : l'écran a remplacé l'écrit (le livre), les journaux se lisent on line, et les réseaux sociaux sont en passe de mettre tout le monde d'accord en assassinant à la fois la presse (le journal papier est bientôt obsolète) et la télévision (qu'on ne regarde plus en live, mais en replay ou en podcast).
Pour aller vite, Debray divise l'histoire des médias en trois époques distinctes : la logosphère (époque de la parole vive, l'écriture restant l'apanage d'une caste de scribes triés sur le volet) s'étendrait des origines au XVe siècle, date de l'invention de l'imprimerie ; puis, la graphosphère, née du génie de Gutenberg, qui établit pour la première fois la notion et l'autorité de l'auteur (l'auteur signe ses livres et est maître chez lui : le livre est le fruit de sa pensée individuelle); et enfin, la videosphère, époque commençant avec les débuts de la télévision et qui marque l'entrée de l'écrivain dans l'ère du spectacle. Désormais — Debray ne l'avait peut-être pas prévu — nous sommes entrés dans l'âge numérique : l'écran a remplacé l'écrit (le livre), les journaux se lisent on line, et les réseaux sociaux sont en passe de mettre tout le monde d'accord en assassinant à la fois la presse (le journal papier est bientôt obsolète) et la télévision (qu'on ne regarde plus en live, mais en replay ou en podcast).
Et la littérature dans tout ça ?
Elle est entrée, bon gré mal gré, dans le spectacle. Pour un écrivain, désormais, il ne s'agit moins d'être lu que d'être vu. Et ceux qui refusent de jouer le jeu (comme autrefois des écrivains tels que Maurice Blanchot, Pierre Bourdieu ou Michel Foucauld) sont irrémédiablement exclus du système spectaculaire. Et ceux qui se prêtent au jeu (être vu, participer à des talk-shows ou des émissions de télé-réalité) doivent obligatoirement obéir aux règles du spectacle (car tout spectacle a ses règles).
Lesquelles ?
Vincent Kaufmann en énumère quatre principales.
 1) désormais, l'écrivain ne vient plus seulement parler de ses livres à la télé, il vient comparaître devant un jury (souvent composé de collègues) : c'est l'exemple de l'émission On n'est pas couché, dans laquelle l'écrivain (mais aussi le cinéaste, le chanteur, etc.) passe devant les procureurs Christine Angot et Yann Moix.
1) désormais, l'écrivain ne vient plus seulement parler de ses livres à la télé, il vient comparaître devant un jury (souvent composé de collègues) : c'est l'exemple de l'émission On n'est pas couché, dans laquelle l'écrivain (mais aussi le cinéaste, le chanteur, etc.) passe devant les procureurs Christine Angot et Yann Moix.
2) Un bon écrivain du spectacle, comparaissant devant le tribunal populaire, doit maîtriser la culture de l'aveu : son livre doit livrer en pâture un événement tragique de sa propre existence (sous couvert d'autofiction). Les plus beaux exemples, analysés par Kaufmann, sont ici Christine Angot (et son fameux inceste), mais aussi Annie Ernaux (racontant comment son père a tenté d'assassiner sa mère ou racontant dans les moindres détails son avortement) et Serge Doubrovski (dans Le Livre brisé, il raconte la mort de sa compagne et chacun se souvient encore de la question de Bernard Pivot lors d'un Apostrophes : « C'est bien vous qui l'avez tuée, non ? »).
3) L'écrivain en représentation doit toujours se montrer authentique. Il ne doit pas mentir sur lui ou ses personnages (désormais, c'est la même chose). Il doit parler vrai, raconter sa vie, promettre de dire toute la vérité. Comme au tribunal.
4) Et bien sûr, corollaire de l'authenticité : il ne doit pas mentir. Il doit être parfaitement transparent. Pas d'effet de style. Pas de jeu sur la langue. Pas de masque ou de posture théâtrale. Le lecteur (ou plutôt le téléspectateur ne doit rien ignorer de sa vie, de ses manies, de ses vices et de ses vertus.
 Vincent Kaufmann suggère une cinquième règle, une sorte de nec plus ultra, qui rajoute un supplément de valeur au spectacle : chaque livre doit être l'objet d'un sacrifice. Annie Ernaux, par exemple, exhibe le sacrifice de son enfant (dont elle se sentira à jamais coupable) dans L'Événement. Serge Doubrovski raconte le sacrifice de sa compagne (une sacrifice réel, puisqu'elle s'est suicidée) qui donne sens à son Livre brisé.
Vincent Kaufmann suggère une cinquième règle, une sorte de nec plus ultra, qui rajoute un supplément de valeur au spectacle : chaque livre doit être l'objet d'un sacrifice. Annie Ernaux, par exemple, exhibe le sacrifice de son enfant (dont elle se sentira à jamais coupable) dans L'Événement. Serge Doubrovski raconte le sacrifice de sa compagne (une sacrifice réel, puisqu'elle s'est suicidée) qui donne sens à son Livre brisé.
Comment sortir du spectacle ? C'est une question qui me passionne depuis toujours : elle est au cœur de presque tous les livres (en particulier, L'Amour nègre, Après l'orgie et Passion noire). Vincent Kaufmann l'approfondit avec infiniment d'intelligence et d'acuité. Son livre, Dernières nouvelles du spectacle*, est un régal de lecture. Sans doute un des plus importants livres de critique (littéraire, mais aussi médiatique, philosophique, sociologique) de ces dernières années.
Qui osait dire que la critique littéraire n'existait plus ?
Certes, à Genève, à Lausanne ou à Neuchâtel, elle est moribonde. Mais à Saint-Gall, elle jouit d'une vitalité remarquable et qui fait chaud au cœur.
* Vincent Kaufmann, Dernières nouvelles du spectacle (ce que les médias font à la littérature), Le Seuil, 2017.
 Pour marquer cet événement, je l’accompagne d’un poème visionnaire. J’ai parfois l’impression étrange de voyager dans le temps, de voir défiler dans l’épaisseur des âges, des visages lointains et inconnus qu’il me semble, à force de les pister, reconnaître. C’est ici, Léo, un homme actuel (ordinaire) éclairé fugitivement par quelque éclat : un bateau lunatique, un visage peint, une cène frugale. Connaissez-vous cette excitation de suivre des apparitions sur une toile vivante, d’y lire les histoires à la fois courantes et communes, où l’on peut s’inscrire, prendre part ou se perdre ? Les êtres et les lieux se superposant à l’extrême, vibrant à l’unisson dans une transe cosmique.
Pour marquer cet événement, je l’accompagne d’un poème visionnaire. J’ai parfois l’impression étrange de voyager dans le temps, de voir défiler dans l’épaisseur des âges, des visages lointains et inconnus qu’il me semble, à force de les pister, reconnaître. C’est ici, Léo, un homme actuel (ordinaire) éclairé fugitivement par quelque éclat : un bateau lunatique, un visage peint, une cène frugale. Connaissez-vous cette excitation de suivre des apparitions sur une toile vivante, d’y lire les histoires à la fois courantes et communes, où l’on peut s’inscrire, prendre part ou se perdre ? Les êtres et les lieux se superposant à l’extrême, vibrant à l’unisson dans une transe cosmique. Entre Toronto et Genève l’océan
Entre Toronto et Genève l’océan





 Un jour j’ai craqué. J’ai rompu le lien avec le réel. Séparée, disjointe, scindée. Il y eut un avant et un après, des plats et des verticales. Un hapax. Le ciel s’est ouvert, j’ai pris la ligne de fuite, glissé dans la faille pour t’y retrouver. Toi ma vision. Mon poète aux yeux gris verts promis à un destin éclatant. C’était à Toronto, j’avais l’âge du Christ. Je remuais ciel et terre pour te voir. Je tapais le sol de ma canne pour avertir les funambules de ma présence. Je parcourais la nuit avec les semelles de Rimbaud, enveloppée dans un long imperméable vert poussière. Je croisais des inconnus qui me reconnaissaient : « on vous a annoncé, on vous attendait. » D’autres ont cru retrouver l’âme d’une aïeule, sosie des temps anciens. J’appartenais à cette folie nocturne des rues illuminantes et des salons en enfilade. Rien n’ossifiait mon regard. Je prenais place dans les cœurs sans filtre. M’invitais à la table des solitaires sans rendez-vous, sondant sans peine la masse du monde et vidant une Newcastle. Où étais-tu ?
Un jour j’ai craqué. J’ai rompu le lien avec le réel. Séparée, disjointe, scindée. Il y eut un avant et un après, des plats et des verticales. Un hapax. Le ciel s’est ouvert, j’ai pris la ligne de fuite, glissé dans la faille pour t’y retrouver. Toi ma vision. Mon poète aux yeux gris verts promis à un destin éclatant. C’était à Toronto, j’avais l’âge du Christ. Je remuais ciel et terre pour te voir. Je tapais le sol de ma canne pour avertir les funambules de ma présence. Je parcourais la nuit avec les semelles de Rimbaud, enveloppée dans un long imperméable vert poussière. Je croisais des inconnus qui me reconnaissaient : « on vous a annoncé, on vous attendait. » D’autres ont cru retrouver l’âme d’une aïeule, sosie des temps anciens. J’appartenais à cette folie nocturne des rues illuminantes et des salons en enfilade. Rien n’ossifiait mon regard. Je prenais place dans les cœurs sans filtre. M’invitais à la table des solitaires sans rendez-vous, sondant sans peine la masse du monde et vidant une Newcastle. Où étais-tu ? Les signes étaient partout. Là, dans le ciel pâle d’une douceur sans limite, j’y sentais une présence qui me réconciliait avec le passé. Là, dans la transe qui réglait mes gestes et ma démarche. Je dansais même sans claudiquer. Un miracle ! Là, dans le tableau de Folon qui me servait de bouclier. Là dans l’odeur du café sucré. Là dans les visages et les lieux superposés comme pelures d’oignon. Je traversais l’épaisseur du temps et me retrouvais au cœur de trahisons ou de scènes antiques.
Les signes étaient partout. Là, dans le ciel pâle d’une douceur sans limite, j’y sentais une présence qui me réconciliait avec le passé. Là, dans la transe qui réglait mes gestes et ma démarche. Je dansais même sans claudiquer. Un miracle ! Là, dans le tableau de Folon qui me servait de bouclier. Là dans l’odeur du café sucré. Là dans les visages et les lieux superposés comme pelures d’oignon. Je traversais l’épaisseur du temps et me retrouvais au cœur de trahisons ou de scènes antiques. 



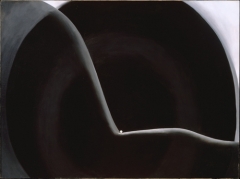 La fuite est mon mouvement. C’est comme si je trouais une brèche dans des lieux trop asphyxiants. La course à pieds est devenu mon instinct de survie. À neuf mois, je marchais. Mes genoux se sont écartés, mes os se sont arqués. Ma volonté s’est extraite de la nature et y a tracé un désir d’évasion, un goût pour les espaces lointains. Le traitement salutaire s’accompagnait de massages en eau de mer et de semelles spéciales à enfiler dans les chaussures. Mon handicap m’a donné une place dans la fratrie, en même temps qu’un regard lucide sur le monde. Plus jamais on ne m’abandonnerait l’été dans une famille d’accueil inquiétante. Plus jamais de sevrage forcé loin de la Méditerranée. J’aurai droit, me too, au bronzage, au sel sur la peau, au sable dans les cheveux. Dorénavant, je serais la petite dernière, celle qui est née après, claudiquant au bout de la ligne comme un terminus ou un bébé capote. La faille dans l’impossible, c’est mon destin.
La fuite est mon mouvement. C’est comme si je trouais une brèche dans des lieux trop asphyxiants. La course à pieds est devenu mon instinct de survie. À neuf mois, je marchais. Mes genoux se sont écartés, mes os se sont arqués. Ma volonté s’est extraite de la nature et y a tracé un désir d’évasion, un goût pour les espaces lointains. Le traitement salutaire s’accompagnait de massages en eau de mer et de semelles spéciales à enfiler dans les chaussures. Mon handicap m’a donné une place dans la fratrie, en même temps qu’un regard lucide sur le monde. Plus jamais on ne m’abandonnerait l’été dans une famille d’accueil inquiétante. Plus jamais de sevrage forcé loin de la Méditerranée. J’aurai droit, me too, au bronzage, au sel sur la peau, au sable dans les cheveux. Dorénavant, je serais la petite dernière, celle qui est née après, claudiquant au bout de la ligne comme un terminus ou un bébé capote. La faille dans l’impossible, c’est mon destin. À 17 ans, j’ai fui le prédateur, sombre corbeau au désir impératif et croque-la-mort. Fui le noir corbillard verrouillé où reposait le corps en bière. Fuir c’était d’abord sortir du corbillard. Fuir c’était marcher sans se retourner de Milhaud jusqu’à la plage de Montpellier et noyer la blessure dans la Méditerranée. Fuir c’était vivre ! Ôter la chape ! Souffler! Inspirer ! Expirer ! La fuite dans la vie, c’était ma chance.
À 17 ans, j’ai fui le prédateur, sombre corbeau au désir impératif et croque-la-mort. Fui le noir corbillard verrouillé où reposait le corps en bière. Fuir c’était d’abord sortir du corbillard. Fuir c’était marcher sans se retourner de Milhaud jusqu’à la plage de Montpellier et noyer la blessure dans la Méditerranée. Fuir c’était vivre ! Ôter la chape ! Souffler! Inspirer ! Expirer ! La fuite dans la vie, c’était ma chance. Le choc fut tel qu’il me rendit au fil du temps sans mémoire. L’angoisse est devenue une obsession comme un fil qui en croise d'autres reliant des deux côtés de l’horizon une logique de la courbature et du tissage. Marche ! Cours ! Nage ! Danse ! Chante ! Le mouvement redonne vie aux lâches tissus comme une transe tonifie les muscles pour évacuer la colère, suspendre le mal. Et, chose étrange, les brûlures s'en vont en effet, sans éclat. (2 sur 10). Et ce qui fut — idées noires, cauchemars, crampes—, reste mais érodé par l'écoulement, le flux des sens. Traversé par la foudre, le corps subsiste, cahin-caha, brûlant, sclérosé, ce cocon de soie qui absorbe l’existence.
Le choc fut tel qu’il me rendit au fil du temps sans mémoire. L’angoisse est devenue une obsession comme un fil qui en croise d'autres reliant des deux côtés de l’horizon une logique de la courbature et du tissage. Marche ! Cours ! Nage ! Danse ! Chante ! Le mouvement redonne vie aux lâches tissus comme une transe tonifie les muscles pour évacuer la colère, suspendre le mal. Et, chose étrange, les brûlures s'en vont en effet, sans éclat. (2 sur 10). Et ce qui fut — idées noires, cauchemars, crampes—, reste mais érodé par l'écoulement, le flux des sens. Traversé par la foudre, le corps subsiste, cahin-caha, brûlant, sclérosé, ce cocon de soie qui absorbe l’existence. 




 Hier encore je pensais que chanter était l’expression la plus spontanée qu’il soit, comme un don offert en partage ou une grâce inégalement distribuée. Le talent, connu des anges et des castrats uniquement, me semblait une liberté privée de toute contingence. Comment ces voix aériennes réussirent-elles depuis la nuit des temps à enchanter les plus mécréants d’entre nous, comme les plus innocents ? L’organe est sans doute taillé sur mesure, tel un instrument affûté par une nature particulièrement aimable. Le souffle circule si naturellement au-dessus de la masse de nos membres sclérosés.
Hier encore je pensais que chanter était l’expression la plus spontanée qu’il soit, comme un don offert en partage ou une grâce inégalement distribuée. Le talent, connu des anges et des castrats uniquement, me semblait une liberté privée de toute contingence. Comment ces voix aériennes réussirent-elles depuis la nuit des temps à enchanter les plus mécréants d’entre nous, comme les plus innocents ? L’organe est sans doute taillé sur mesure, tel un instrument affûté par une nature particulièrement aimable. Le souffle circule si naturellement au-dessus de la masse de nos membres sclérosés.  « Que nenni » m’affirme aujourd’hui dans sa leçon de chant, une sage pédagogue. « Respirez ! Relâchez vos muscles ! Enracinez-vous ! » Pas d’air sans muscle, pas de son sans os, pas de note sans corde vocale, pas d’amplitude sans caisse de résonnance, pas de hauteur sans voile de palais, pas de fluidité sans énergie. Autrement dit, pas de naturel sans travail, pas de grâce sans corps. La voix est organique. Elle tâtonne, se fraye des chemins multiples, se heurte aux cavités buccales et nasales, dirige minutieusement la justesse, ajuste l’emplacement, se gonfle, craque, sort, s’aiguise, se fluidifie. Elle n’évolue pas au-dessus de la matière, elle est la masse sonore qui s’élève lorsque le passage est dégagé, la voie libre ! Je prépare ainsi mon appareil au cri préhistorique : « Aïe ! Oc oye ! Grrr ! Pfffff ! Hihihi ! Ah ! Oh ! I Am ! »
« Que nenni » m’affirme aujourd’hui dans sa leçon de chant, une sage pédagogue. « Respirez ! Relâchez vos muscles ! Enracinez-vous ! » Pas d’air sans muscle, pas de son sans os, pas de note sans corde vocale, pas d’amplitude sans caisse de résonnance, pas de hauteur sans voile de palais, pas de fluidité sans énergie. Autrement dit, pas de naturel sans travail, pas de grâce sans corps. La voix est organique. Elle tâtonne, se fraye des chemins multiples, se heurte aux cavités buccales et nasales, dirige minutieusement la justesse, ajuste l’emplacement, se gonfle, craque, sort, s’aiguise, se fluidifie. Elle n’évolue pas au-dessus de la matière, elle est la masse sonore qui s’élève lorsque le passage est dégagé, la voie libre ! Je prépare ainsi mon appareil au cri préhistorique : « Aïe ! Oc oye ! Grrr ! Pfffff ! Hihihi ! Ah ! Oh ! I Am ! » Le plaisir de chanter, je le convie. Pieds nus sur le tapis, j’inspire, j’expire. Les genoux légèrement pliés pour laisser l’énergie se répandre. Les yeux posés au coin du mur laissant la nuque souple. Le chant commence pianissimo. Il se déplace crescendo dans mon corps arqué et contracté, il assouplit les muscles tendus vers la fuite imminente et il traverse les douleurs brûlantes de la profanation. C’est ainsi que je retrouve le bonheur des commencements, le babil joyeux d’avant l’abandon et des faux-semblants. Placer ma voix, là, dans le jeu! Ajuster les notes (jusqu’au la!), évaluer mon ressenti (c’est haut) et en garder une trace (c’est ici et là). Toute note qui n’est pas précédée d’une sensation m’est inutile. Ce soir, je vais à la rencontre des Sharks et des Jets, de l'amour et des corps, de l'esprit et des transes, danser et chanter !
Le plaisir de chanter, je le convie. Pieds nus sur le tapis, j’inspire, j’expire. Les genoux légèrement pliés pour laisser l’énergie se répandre. Les yeux posés au coin du mur laissant la nuque souple. Le chant commence pianissimo. Il se déplace crescendo dans mon corps arqué et contracté, il assouplit les muscles tendus vers la fuite imminente et il traverse les douleurs brûlantes de la profanation. C’est ainsi que je retrouve le bonheur des commencements, le babil joyeux d’avant l’abandon et des faux-semblants. Placer ma voix, là, dans le jeu! Ajuster les notes (jusqu’au la!), évaluer mon ressenti (c’est haut) et en garder une trace (c’est ici et là). Toute note qui n’est pas précédée d’une sensation m’est inutile. Ce soir, je vais à la rencontre des Sharks et des Jets, de l'amour et des corps, de l'esprit et des transes, danser et chanter !