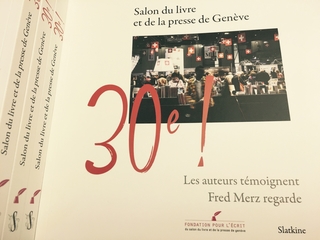Les écrivains ne meurent jamais
par Jean-Michel Olivier
Je dois vous avouer que 80% des livres que je lis me tombent des mains (un peu plus, concernant la littérature romande). Autofictions poussives, confessions pleurnichardes, polars mal ficelés, romans qui sonnent creux, best-sellers confits de niaiserie : la liste serait trop longue à établir.
« On publie trop, disait Jacques Chessex. Mais l'on n'écrit pas assez. »
 Pourtant, la littérature a d'autres trésors à offrir. Jim Harrison par exemple (1937-2016), qui vient de nous quitter, après une vie passée à boire et à écrire, à faire ripaille et à pêcher le saumon, à aimer les femmes et les Indiens, du Michigan (où il est né) à l'Arizona (où il est mort). Une œuvre d'une sauvagerie essentielle, d'une liberté totale, d'une soif de vivre communicative. Il faut relire d'urgence La Route du retour ou Entre chien et loup, ou encore son autobiographie En marge (saluons, au passage, le talent de son inégalable traducteur, Brice Matthieussent, qui a su rendre la langue rude et burinée de l'auteur).
Pourtant, la littérature a d'autres trésors à offrir. Jim Harrison par exemple (1937-2016), qui vient de nous quitter, après une vie passée à boire et à écrire, à faire ripaille et à pêcher le saumon, à aimer les femmes et les Indiens, du Michigan (où il est né) à l'Arizona (où il est mort). Une œuvre d'une sauvagerie essentielle, d'une liberté totale, d'une soif de vivre communicative. Il faut relire d'urgence La Route du retour ou Entre chien et loup, ou encore son autobiographie En marge (saluons, au passage, le talent de son inégalable traducteur, Brice Matthieussent, qui a su rendre la langue rude et burinée de l'auteur).
Parmi les auteurs essentiels, il faut relire aussi Violette Leduc (1907-1972) — peut-être la plus grande « écrivaine » française du XXe siècle.  Un style unique, une langue ciselée, une douleur qui transforme chaque phrase en flux poétique. Je relisais ces jours-ci L'Affamée, ce bref roman où Violette Leduc raconte son amour pour Simone de Beauvoir : amour, admiration, attirance — aimantation plutôt. On n'a rien écrit de plus fort sur le sujet. À part, bien sûr, L'Asphyxie ou La Bâtarde, ces chefs-d'œuvres absolus.
Un style unique, une langue ciselée, une douleur qui transforme chaque phrase en flux poétique. Je relisais ces jours-ci L'Affamée, ce bref roman où Violette Leduc raconte son amour pour Simone de Beauvoir : amour, admiration, attirance — aimantation plutôt. On n'a rien écrit de plus fort sur le sujet. À part, bien sûr, L'Asphyxie ou La Bâtarde, ces chefs-d'œuvres absolus.
Pâques est le temps d l'espoir. Les écrivains ne meurent jamais.
* Jim Harrison, Entre chien et loup, La Route du retour, En marge, Éditions 10/18.
** Violette Leduc, L'Affamée, L'Asphyxie (Folio) et La Bâtarde (L'Imaginaire, Gallimard)
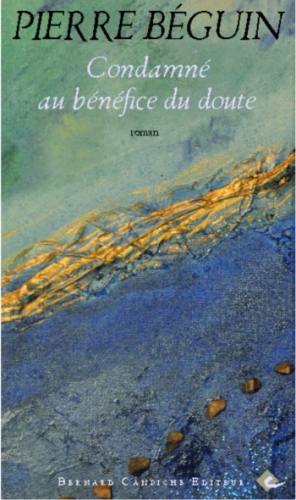
 On peut beaucoup admirer, ces temps-ci, dans les journaux et sur les réseaux sociaux, les poses viriles, tatouées, testostéronées, des jeunes auteurs romands qui squattent le devant de la scène littéraire. Ces beaux jeunes gens musclés prennent tellement de place qu'on en oublierait qu'il y a également des femmes talentueuses dans le mouvement de renouveau actuel de la littérature romande!
On peut beaucoup admirer, ces temps-ci, dans les journaux et sur les réseaux sociaux, les poses viriles, tatouées, testostéronées, des jeunes auteurs romands qui squattent le devant de la scène littéraire. Ces beaux jeunes gens musclés prennent tellement de place qu'on en oublierait qu'il y a également des femmes talentueuses dans le mouvement de renouveau actuel de la littérature romande! lle. Dans la plus grande incompréhension des valeurs de son épouse, qui, elle, voulait épouser un Occidental pour acquérir un mode de vie que son mari refuse. L'histoire douce-amère se termine de façon paradoxale, le tulou devenant finalement une discothèque branchée.
lle. Dans la plus grande incompréhension des valeurs de son épouse, qui, elle, voulait épouser un Occidental pour acquérir un mode de vie que son mari refuse. L'histoire douce-amère se termine de façon paradoxale, le tulou devenant finalement une discothèque branchée.