Par Pierre Béguin
«On ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments» paraît-il. Si l’on en croit la célèbre phrase d’André Gide, l’époque actuelle, gorgée à l’excès de bons sentiments, ne laisse aucune chance à la bonne littérature, et à la création en général. Là où le politiquement correct passe tel le cheval d’Attila, plus rien d’original ne repousse.
Prenons une comédie à succès dont on nous annonce déjà l’inévitable suite: un couple aisé genre gaulliste vieille France avec ses préjugés et sa nostalgie d’un monde propre en ordre, quatre filles éduquées selon les bons principes, destinées à perpétuer la tradition familiale mais qui, bien ancrées dans le nouveau monde multiculturel, épousent successivement, au grand désarroi des parents, un juif, un arabe, un chinois et un noir, tous par ailleurs bons français. Jusque-là pas de problème! On a les ingrédients types d’une situation potentiellement comique. Mais soumis au carcan étouffant du politiquement correct, quel développement peut-on donner à ces ingrédients? La marge de manœuvre est si retreinte que toute la suite se décline sur du convenu, du cliché, de l’attendu: «Je te donne toutes mes différences / Tous ces défauts qui sont autant de chances…» comme chante l’autre. Et nous voilà donc partis pour une heure trente d’une histoire qui ne fait qu’illustrer ces deux vers jusqu’à la niaiserie.
Entendez-moi bien! Un tel monde me conviendrait parfaitement. Là n’est pas mon propos. S’il ne suffit pas de mauvais sentiments pour faire de la bonne littérature, il est clair que l’excès de bons sentiments produit immanquablement de la mauvaise littérature. Et à voir ce pauvre Christian Clavier, bouffi par l’âge, tenter d’épicer un peu un scénario forcément affadi par la bien-pensance, on se sent envahi par une vague de nostalgie: Ah! les années 70, provocatrices, iconoclastes, foisonnantes! Si Le Père Noël est une ordure reste une référence absolue du genre, c’est avant tout parce que ce film est fondamentalement méchant: les pauvres sont ignobles, le travesti est grotesque, l’étranger est chiant et l’humanisme de façade, une fois sa fine couche de vernis grattée, laisse voir toute sa veulerie. Le paradoxe est que, si ce film est toujours encensé, il serait probablement mis à l’index aujourd’hui. Même paradoxe pour les comiques: Desproges, Coluche, risqueraient l’interdiction de salle…
Je vais peu au cinéma, découragé par la production navrante. Trois fois cette année et toujours la même histoire! En Angleterre: début des années 80, Margret Thatcher livre un combat sans merci contre les syndicats miniers en grève dans le pays de Galles. A Londres, un groupement homos lesbiennes vient en aide, idéologiquement et financièrement, aux grévistes affamés. Que croyez-vous qu’il arrive? A la fin, certains mineurs engoncés dans leur préjugés «anti pédales» s’ouvrent – non! non! pas sexuellement, tout de même! Encore que… y ‘en a un qui fait pratiquement son «coming out» ‒ s’ouvrent, disais-je, à la délicatesse morale et esthétique des homosexuels; et de l’autre côté, certains homosexuels aussi citadins que désabusés, rebutés par les mœurs grossiers des mineurs ou atteints du SIDA, s’ouvrent aux dures réalités que doit affronter la classe ouvrière, retrouvant ainsi un sens à leur vie. Et tout ce beau monde de défiler côte à côte dans une gigantesque «demo» (manifestation) anti thatchérienne. Mineurs grévistes et homosexuels, même combat!
En France: une famille d’immigrés indiens installe un restaurant indien en face d’un relais gastronomique bien français. Que croyez-vous qu’il arrive? A la fin, le relais gastronomique à la réputation déclinante obtient sa deuxième étoile tant convoitée grâce au fils de l’immigré indien, génial cuisinier, qui produit des mets originaux en mélangeant recettes traditionnelles françaises avec recettes traditionnelles indiennes. En plus, les enfants s’aiment et s’apprêtent à concevoir, à l’image de la cuisine, une nouvelle génération aussi heureuse que multi ethnique…
Je le répète – ça fait vingt lignes que je l’ai dit et certains pourraient déjà l’avoir oublié – un tel monde me conviendrait parfaitement. Mes filles, à moitié colombiennes, sont d’ailleurs un merveilleux résultat de cette multi ethnie. Encore une fois, là n’est pas mon propos! Mais quand toute forme de création s’affadit, s’appauvrit, se délite sous les coups de boutoir de la bien-pensance, là c’est mon propos! Marre! Tout simplement marre de cette inlassable production de clichés estampillés politiquement corrects!
Tenez! Mercredi soir à Plan-les-Ouates, troisième film, suisse celui-là, et loin des grands circuits de production. On aurait pu espérer un formatage moins standardisé. Que nenni non point! Un couple divorcé, un enfant capricieux, paresseux, couvé par sa mère et qui ne voit plus son père, lequel père, par ailleurs, se moque bien de son fils: écrivain en panne d’inspiration, alcoolique, désespéré, fauché, poursuivi par les huissiers, il a bien d’autres chats à fouetter. Problème: la mère doit s’absenter un mois pour une série de conférences, le père doit donc garder l’enfant. Au début, bien entendu, ça se passe très mal. Que croyez-vous qu’il arrive? A la fin, l’enfant, ayant retrouvé l’affection de son père, a mûri, il n’est plus capricieux, et le père, ayant retrouvé l’affection de son fils, a repris sa vie en main, il a cessé de boire, et tout le toutim. Au passage, quelques allusions bien senties pour soutenir les couples pacsés, une conclusion en faveur d’une garde partagée (on ne peut qu’applaudir) et on vous livre l’ensemble dégoulinant d’émotion et bien ficelé dans un emballage formel assez convenu. Et tout le monde est content à la sortie de la séance! Même moi, mais pour la garde partagée uniquement. Car pour le reste…
Le pire, c’est qu’on ne peut pas en vouloir aux réalisateurs: ils n’ont tout simplement pas le choix. Avec un scénario moins convenu, leur film ne passerait pas la rampe des circuits de production, encore moins celle d’un public admirablement dressé par trente années de politiquement correct à réagir promptement contre le moindre écart à la bien-pensance, et encore moins celle des festivals tout aussi prompts à récompenser la première velléité d’allégeance à ladite bien-pensance. Qu’on s’en rende compte: le politiquement correct, tel un vampire, est en train de vider de sa substance toute forme de création, comme il a déjà vidé toute forme de pensée! Céline, réveille-toi! Ils sont devenus fous!
«Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur!» disait Beaumarchais, par la voix de Figaro, en 1784. Plus de deux siècles plus tard, que reste-t-il de cet esprit révolutionnaire? On veut de l’iconoclaste, de la méchanceté, de la contradiction, de la provocation, de la subversion, de la perversion même! Tout, mais pas cet insipide défilé de clichés fadasses, sans cesse ressassés et vidés de leur sens! Et dire qu’en attendant, on nous propose le dernier roman de David Foenkinos…
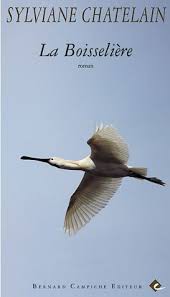 Un vieux château au cœur de la forêt, ancienne maison de retraite, perd ses pensionnaires, son personnel, sa mémoire, dans une ambiance de fin du monde. Il reste cependant pour ceux qui s'y trouvent un lieu de paix, une protection contre le monde qui l'assiège.
Un vieux château au cœur de la forêt, ancienne maison de retraite, perd ses pensionnaires, son personnel, sa mémoire, dans une ambiance de fin du monde. Il reste cependant pour ceux qui s'y trouvent un lieu de paix, une protection contre le monde qui l'assiège.





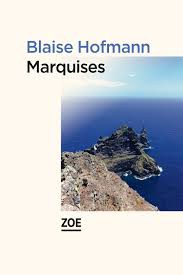 Après avoir assisté, sur l'île de Ua Huka, au Festival des arts marquisiens qui réunit quatre cents danseurs et percussionnistes venus des six îles habitées de l'archipel, Blaise Hofmann écrit ses impressions qu'il publie sur son blog avec quelques photos. Il en communique l'adresse à quelques amis de là-bas qui la diffusent sur les réseaux sociaux.
Après avoir assisté, sur l'île de Ua Huka, au Festival des arts marquisiens qui réunit quatre cents danseurs et percussionnistes venus des six îles habitées de l'archipel, Blaise Hofmann écrit ses impressions qu'il publie sur son blog avec quelques photos. Il en communique l'adresse à quelques amis de là-bas qui la diffusent sur les réseaux sociaux. Mais un écrivain voyageur ne doit pas craindre d'affronter les visions les plus illustrées, semble penser Blaise Hofmann. Il fait ainsi le grand écart avec Estive, son succès, un livre qui se passait dans un alpage où notre homme gardait des moutons.
Mais un écrivain voyageur ne doit pas craindre d'affronter les visions les plus illustrées, semble penser Blaise Hofmann. Il fait ainsi le grand écart avec Estive, son succès, un livre qui se passait dans un alpage où notre homme gardait des moutons.