La trilogie de Karla
Par Alain Bagnoud
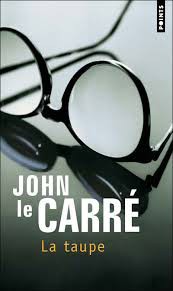 Ça fait du bien, quelquefois, de se replonger dans des polars éprouvés. Par exemple La Taupe, de John Le Carré (1974). Dans les services secrets anglais, après la deuxième guerre mondiale, un agent soviétique a réussi à grimper jusqu'aux premières places de la hiérarchie. Toute ressemblance avec les Cinq de Cambridge n'est évidemment pas un hasard.
Ça fait du bien, quelquefois, de se replonger dans des polars éprouvés. Par exemple La Taupe, de John Le Carré (1974). Dans les services secrets anglais, après la deuxième guerre mondiale, un agent soviétique a réussi à grimper jusqu'aux premières places de la hiérarchie. Toute ressemblance avec les Cinq de Cambridge n'est évidemment pas un hasard.
Pour donner du ressort à son histoire, Le Carré soigne le contexte. Pas d'épisodes flamboyants, mais une recherche sourde et une qualité particulière de mystère. Le sentiment qu'il excelle à transmettre est que tous les individus sont d'une richesse insoupçonnables, que sous la façade, derrière la couverture, il y a une seconde vie, voire une troisième, en chacun.
Smiley, espion mis à la retraite, n'a pas le profil des héros. Corpulent, myope, réservé, il a pourtant des atouts. C'est un remarquable joueur d'échec qui sait faire oublier son intelligence pour tromper ses ennemis.
La Taupe est l'amant de la femme de Smiley, qui est chargé de le démasquer. Et Karla, le soviétique qui dirige tout à distance, est son ennemi personnel et son double. Ils se sont rencontrés lors d'un interrogatoire où Smiley était chargé de le retourner, sans succès. Carla lui a volé son briquet.
 Le Carré, après le succès de son premier livre, reprend ses personnages dans Comme un collégien (1977). Il s'agit d'y capturer une taupe soviétique, une autre, infiltrée celle-là en Chine communiste. C'est un gros gibier, qui se négocie sur fond d'intrigues dans les différents services secrets alliés.
Le Carré, après le succès de son premier livre, reprend ses personnages dans Comme un collégien (1977). Il s'agit d'y capturer une taupe soviétique, une autre, infiltrée celle-là en Chine communiste. C'est un gros gibier, qui se négocie sur fond d'intrigues dans les différents services secrets alliés.
Il y a dans ce livre beaucoup plus d'action, plus de mouvement et moins de combat intellectuel à distance. L'agent de Smiley, « le collégien », ressemble d'avantage aux agents secrets convenus. Il est aventureux, entreprenant, séducteur, assoiffé d'action. Les épisodes se succèdent, à Hong Kong et dans la Chine. La ligne de l'intrigue est parfois tortueuse mais le sort réservé à Smiley ne change pas.
Les intrigues ont finalement raison du chef espion bedonnant, brillant mais d'apparence médiocre. Il avait été mis à la retraite dans La Taupe. Il est écarté à nouveau du service dans Comme un collégien, parce que son agent a foiré à la fin, mais surtout parce que le marigot politique est favorable aux crocodiles et pas du tout aux hommes intègres.
On le retrouve pourtant dans Les gens de Smiley (1980). Désabusé, nostalgique, allusif, elliptique, le livre apporte quelques éléments parfois obscurs que le lecteur doit développer et reconstituer. Un exercice fascinant.
Ça se termine par la victoire discrète mais définitive de Smiley sur son vieil adversaire soviétique, dans un monde de vieux agents mis à la retraite, d'indicateurs au rebut, d'ancien collaborateurs écartés.
Ces gens méprisés par les nouveaux services de renseignement découvrent, grâce à leurs réseaux et à leur mémoire, le moyen de coincer Karla dont la fille un peu folle est la faiblesse. Le stratège russe a pris des risques pour la mettre à l'abri en Suisse. On se retrouve ainsi à Berne, nid d'espion, et mémoire de la guerre froide. Berne, où Le Carré a étudié à l'université de Berne de 1948 à 1949. Berne, plaque tournante de l'espionnage. Qui l'eût cru ?







 Au milieu de La vérité sur Marie, quelle scène ! Un cheval dans un avion au milieu de l'orage. On ne sait pas si on est au ciel ou dans les enfers. Onirique, somptueux, fulgurant. Ça soulève tout le livre, emporte les doutes du lecteur qui, comme moi, trouve parfois chez Toussaint quelque chose de minutieux qui fait frôler l'ennui.
Au milieu de La vérité sur Marie, quelle scène ! Un cheval dans un avion au milieu de l'orage. On ne sait pas si on est au ciel ou dans les enfers. Onirique, somptueux, fulgurant. Ça soulève tout le livre, emporte les doutes du lecteur qui, comme moi, trouve parfois chez Toussaint quelque chose de minutieux qui fait frôler l'ennui. - L'Homme a le droit de vivre près de la petite rivière et la petite rivière a le droit de couler près de l'Homme
- L'Homme a le droit de vivre près de la petite rivière et la petite rivière a le droit de couler près de l'Homme