l'infâme
par antonin moeri

Parmi la trentaine de portraits fictifs que Bolaño dresse dans «La littérature nazie en Amérique», il y a celui d’un véritable salaud et, pour ce salaud-là, nulle circonstance atténuante. Il sera traqué comme un criminel de guerre.
Au moment du coup d’État au Chili, en 1973, Carlos Ramirez Hoffman participe à un atelier d’écriture. Il flirte avec deux poétesses, fume des joints avec elles, puis les assassine. Beaucoup de gens disparaissent à cette époque, parmi lesquels un Indien nabot qui traduit Jouffroy, Denis Roche, Claude Pélieu, et qui reparaîtra en RDA. Le narrateur est alors emprisonné. Dans la cour d’un centre de détention, il joue aux échecs avec des détenus. Il voit un avion écrire un poème dans le ciel avec des fumigènes (allusion en forme d’hommage à l’avion qui écrit des lettres dans le ciel de Londres, au début du roman de Virginia Woolf, «Mrs Dalloway», ce bijou narratif que Thomas Bernhard admirait). Le narrateur de Bolaño apprendra que Hoffman pilotait cet avion. Homme audacieux, Hoffman accomplit d’autres prouesses aériennes. Lors d’un meeting, il exécute des acrobaties puis écrit des phrases dans le ciel du genre: «La mort est Chili». Les gens pensent que le pilote est devenu fou.
Après ce meeting, Hoffman organise une exposition de photos dans sa chambre. Les visiteurs doivent y accéder l’un après l’autre. Une femme en ressort le visage décomposé et vomit dans le couloir. À partir de cette nuit-là, les informations sont confuses. Il aurait changé de nom. Il aurait été expulsé des forces aériennes. Il aurait organisé des happenings, écrit une bizarre pièce de théâtre, «où le sadisme et le masochisme sont des jeux d’enfants», publié divers textes dans des revues au Chili, en Uruguay, au Brésil, en Argentine. La piste de Hoffman se perd en Afrique du Sud, en Allemagne, en Italie, au Japon où il est considéré comme un précurseur dans le domaine de l’art.
«En 1992, son nom est cité dans une enquête judiciaire sur les tortures et les disparitions». Un officier de l’armée affirme que «Hoffman avait raison quand il disait qu’on ne devait pas laisser vivant un prisonnier qu’on avait préalablement torturé». On oublie Hoffman jusqu’au jour où un ancien policier de l’époque d’Allende se rend chez le narrateur à Barcelone pour essayer de retrouver la piste du criminel. L’ex-flic apporte des revues que le narrateur doit parcourir. Dans l’une d’elles, le narrateur croit reconnaître le style de Hoffman. C’est l’organe officiel d’un mouvement appelé «écriture barbare», qui organise des messes noires où l’on maltraite les livres classiques, couvre de merde des pages de Chateaubriand, urine sur les romans de Stendhal, tache de sang des exemplaires de Flaubert.
Dans une revue, il est question d’un photographe qui passait ses nuits à «observer l’amour dans ses manifestations les plus variées: couples, trios, groupes». L’ex-policier apporte des vidéos porno dans lesquelles on sent la présence de Hoffmann, qui est sans doute derrière la caméra. Le lecteur apprend «l’histoire d’un groupe qui faisait des films porno dans une ville. Un beau matin, on les retrouve tous morts». Deux mois plus tard, l’ex-flic réussit à localiser la bête immonde non loin de Barcelone, dans un immeuble de huit étages. Le narrateur doit se poster dans un bar en face de cet immeuble, pour essayer de reconnaître l’homme. Il lit Bruno Schulz, puis voit entrer dans le bar Hoffman qui a beaucoup vieilli. «Il ne ressemble ni à un poète ni à un ancien officier des Forces aériennes».
Assuré qu’il s’agit de la cible, l’ex-flic va monter dans l’immeuble. Le narrateur lui demande de ne pas le tuer. «Ce type ne peut plus faire de mal à personne». Mais l’ordre doit être exécuté. Ils se quitteront sur le quai de la gare Plaza Catalunya, à Barcelone. Bon, le lecteur est satisfait. Justice est rendue. L’infâme a été supprimé. À 48 ans, il aurait pu encore faire du mal. L’auteur ajoute pourtant: «Nous pouvons tous faire du mal». Les registres vont du fantastique au polar en passant par le roman d’espionnage. L’auteur prend un malin plaisir à dresser le portrait de Carlos, portrait moins convaincant que les autres (car Bolaño ne laisse aucune chance à Carlos Ramirez Hoffman), qui correspond plutôt à l’image du criminel de guerre véhiculée par les médias.
Roberto Bolaño: La littérature nazie en Amérique, Bourgois, 2011



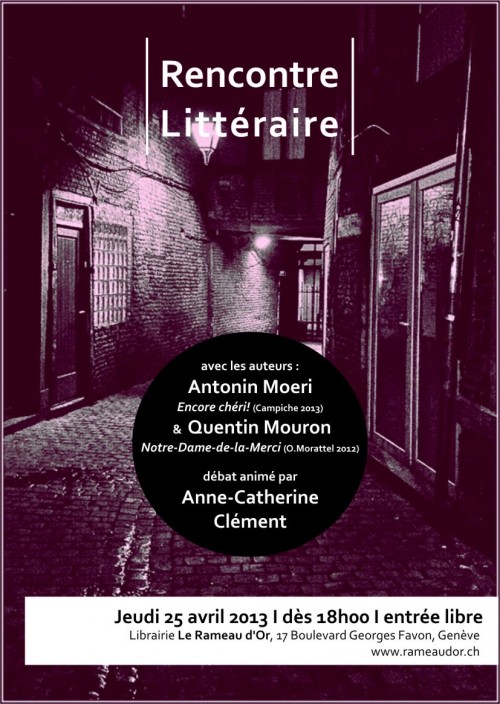



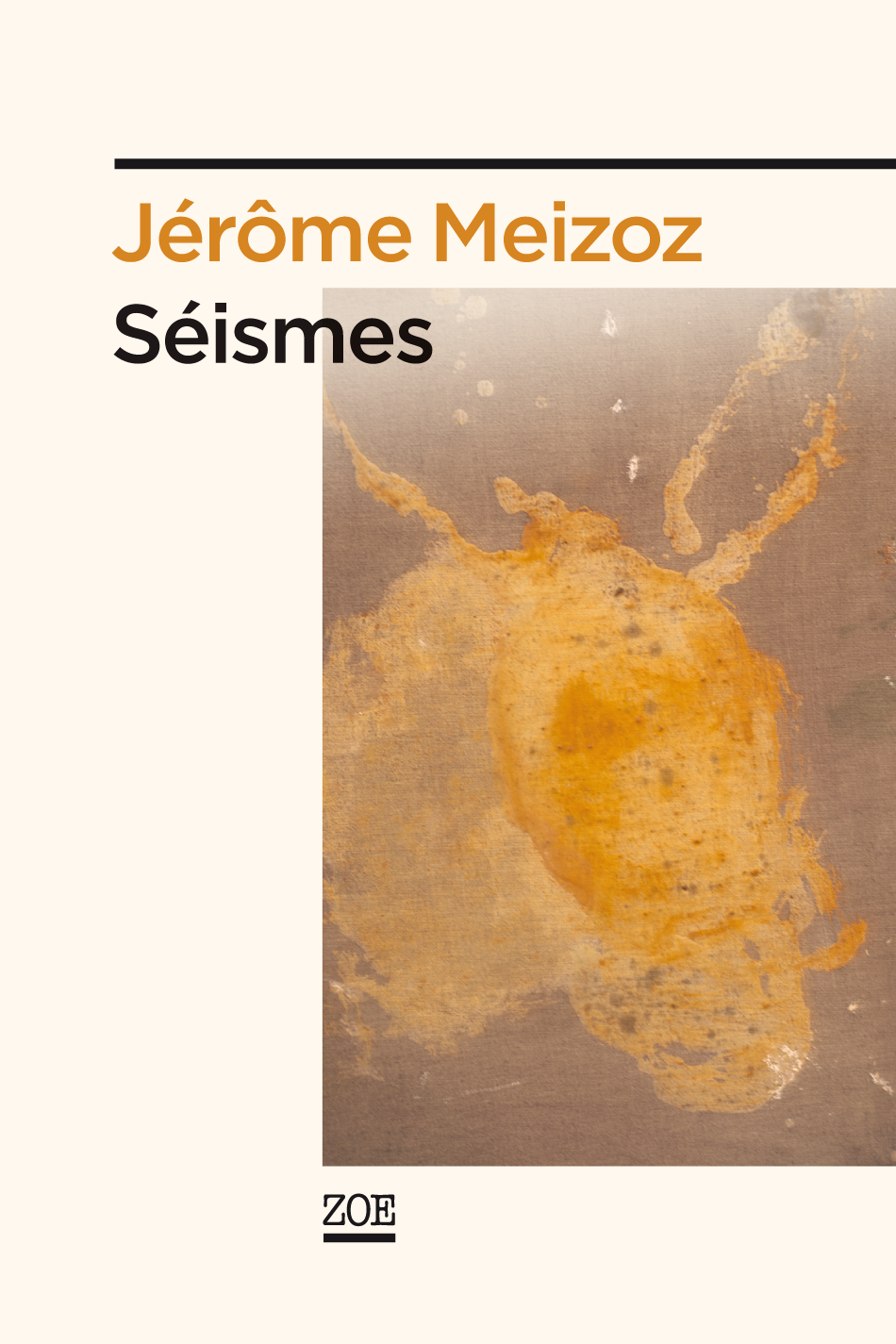 De livre en livre, Jérôme Meizoz construit ce qu'il faut bien appeler une œuvre. On la voit se bâtir au fil des parutions, comme un puzzle de textes courts dont les pièces s'ajustent de façon cohérente. L'image globale est celle d'un Valais du passé, d'une famille bouleversée par un drame, d'un village avec ses personnages curieux, pathétiques ou touchants, dits dans une écriture pudique, travaillée et juste, qui convoque l'émotion retenue et l'humour, allie quelques termes du vocabulaire suisse romand (« bardoufler ») avec une haute tenue littéraire,
De livre en livre, Jérôme Meizoz construit ce qu'il faut bien appeler une œuvre. On la voit se bâtir au fil des parutions, comme un puzzle de textes courts dont les pièces s'ajustent de façon cohérente. L'image globale est celle d'un Valais du passé, d'une famille bouleversée par un drame, d'un village avec ses personnages curieux, pathétiques ou touchants, dits dans une écriture pudique, travaillée et juste, qui convoque l'émotion retenue et l'humour, allie quelques termes du vocabulaire suisse romand (« bardoufler ») avec une haute tenue littéraire, En relisant, presque trente ans après ma première lecture, ce gros roman de l’écrivain anglais, c’est surtout à son premier chapitre que sont allées mes réflexions. Un énorme mur de 80 pages, pour tout dire souvent ennuyeux, qui se dresse, tel le Palais de Cortés, comme une longue et pénible ascension, véritable chemin de croix à gravir avant de pouvoir goûter à l’étonnant chemin de ronde de l’édifice, où l’on a vue sur tous les carrefours des destinées tragiques qui se nouent en cette unique journée de novembre 1938 (jour des morts bien entendu). Lowry a justifié ce chapitre en prétextant qu’il contenait tous les thèmes, les symboles, les ingrédients et le décor de l’histoire qui suit. Certes. Pour ma part, tout en subissant ma lecture, je me demandais quel éditeur aujourd’hui accepterait un livre qui exige 80 pages d’introduction avant que l’histoire ne commence, et quel lecteur, habitué au rythme haletant du cinéma, accepterait un tel pensum d’un roman inconnu. On sait que le texte a été refusé trois fois avant de s’imposer, grâce surtout a sa traduction française («Une œuvre prodigieuse!» s’exclama Maurice Nadeau) et, plus tard (1984), grâce au film éponyme de John Huston. A l’époque déjà (fin des années 40), ce premier chapitre devait être pour beaucoup dans ces refus successifs. Mais comme Lowry lui-même invite son lecteur à sauter des pages s’il le désire (preuve qu’il n’était pas lui-même convaincu de leur pertinence), n’hésitez pas, si elle vous ennuie, à occulter cette longue et parfois ennuyeuse introduction. La suite en vaut la peine.
En relisant, presque trente ans après ma première lecture, ce gros roman de l’écrivain anglais, c’est surtout à son premier chapitre que sont allées mes réflexions. Un énorme mur de 80 pages, pour tout dire souvent ennuyeux, qui se dresse, tel le Palais de Cortés, comme une longue et pénible ascension, véritable chemin de croix à gravir avant de pouvoir goûter à l’étonnant chemin de ronde de l’édifice, où l’on a vue sur tous les carrefours des destinées tragiques qui se nouent en cette unique journée de novembre 1938 (jour des morts bien entendu). Lowry a justifié ce chapitre en prétextant qu’il contenait tous les thèmes, les symboles, les ingrédients et le décor de l’histoire qui suit. Certes. Pour ma part, tout en subissant ma lecture, je me demandais quel éditeur aujourd’hui accepterait un livre qui exige 80 pages d’introduction avant que l’histoire ne commence, et quel lecteur, habitué au rythme haletant du cinéma, accepterait un tel pensum d’un roman inconnu. On sait que le texte a été refusé trois fois avant de s’imposer, grâce surtout a sa traduction française («Une œuvre prodigieuse!» s’exclama Maurice Nadeau) et, plus tard (1984), grâce au film éponyme de John Huston. A l’époque déjà (fin des années 40), ce premier chapitre devait être pour beaucoup dans ces refus successifs. Mais comme Lowry lui-même invite son lecteur à sauter des pages s’il le désire (preuve qu’il n’était pas lui-même convaincu de leur pertinence), n’hésitez pas, si elle vous ennuie, à occulter cette longue et parfois ennuyeuse introduction. La suite en vaut la peine.

