Moravia et l'Ennui (19/01/2014)
Par Pierre Béguin
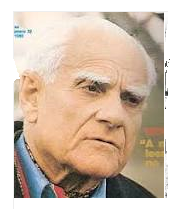
«Mal sans forme» selon l’expression d’Alain, «brouillard silencieux» selon Heidegger, «longs corbillards sans tambour ni musique», (Baudelaire), contagieux comme la lèpre (Flaubert ou Bernanos), l’ennui est aussi difficile à définir qu’à cerner puisqu’il se présente essentiellement comme une absence de traits positifs: il est inappétence ou, dans son sens étymologique, anorexie. Au XIXe, sous l’influence romantique, il est perçu comme l’inévitable conséquence de toute civilisation avancée: «grand monstre moderne» (Théophile Gautier) ou «fils des civilisations excessives» (Barbey d’Aurevilly), il se glisse dans tous les interstices de la société et «dans un bâillement aval[e] le monde» (Baudelaire). Mais s’il n’épargne plus personne, ses proies favorites restent l’intellectuel et le riche. Pour les autres, la société moderne a développé, pour combattre le monstre, un monstrueux attirail de divertissements: sports ou variétés, comme le décrivait déjà Céline bien avant l’invention de la télévision: «Et puis des artistes en plus, de nos jours, on en mis partout par précaution tellement qu’on s’ennuie. Même dans les maisons on a mis des artistes avec leurs frissons à déborder partout et leurs sincérités à dégouliner à travers les étages. Les portes en vibrent. C’est à qui frémira davantage et avec le plus de culot... » On se croirait dans une émission de variétés sur TFI ou France2! (Et au concours de l’artiste qui «frémira davantage et avec le plus de culot», c’est incontestablement Patrick Bruel qui a gagné...)
Ce n’est pas de cet ennui assimilable au manque de distractions que nous parle Alberto Moravia. Paru en 1961, L’Ennui est considéré comme le meilleur livre de l’écrivain italien. Et c’est précisément un intellectuel riche qui en est le héros narrateur, un bourgeois romain de 37 ans, prénommé Dino, peintre abstrait raté méprisant une richesse qu’il tient de sa mère, qu’il rejette tout en en vivant, et qui s’ennuie depuis l’aube de son existence. Le premier chapitre est entièrement occupé par la définition que le narrateur s’est peu à peu forgée d’une maladie qui l’a accablé dès l’enfance comme un mal de tête dont il ignorait la cause et contre lequel les distractions habituelles n’offraient aucun remède. Car son ennui, on l’a dit, n’est pas le contraire de l’amusement ou du divertissement. Il est insuffisance, voire carence totale de réalité. Il ne vient pas de l’intérieur mais d’un manque de rapports avec l’extérieur, d’une incommunicabilité radicale entre le sujet et le monde, d’une impossibilité ontologique à établir un lien quelconque entre les choses et lui: «La sensation de l’ennui naît en moi de l’impression d’absurdité d’une réalité insuffisante, c’est-à-dire incapable de me persuader de sa propre existence effective». D’où probablement le choix de la peinture abstraite. Apathique et renfermé, il est muré vivant en lui-même comme dans une prison hermétique et étouffante. Jusqu’au jour où il est distrait du vide de son atelier par une jeune modèle, Cécilia, qui posait pour – avant de coucher avec – un vieux peintre voisin de palier. Une relation si intense que le vieux en est mort. Intrigué par ce suicide déguisé, Dino essaie de comprendre les motivations d’un homme qui s’est servi érotiquement d’une adolescente pour hâter sa fin. Inconsciemment d’abord, puis de plus en plus lucidement, il va marcher sur les traces du vieux peintre et décider d’entamer une liaison avec Cécilia...
Très vite pourtant, il projette de renoncer. Il s’ennuie déjà, malgré les aptitudes sexuelles manifestes de sa jeune maîtresse. Cécilia n’a guère plus de réalité pour lui que, dans son adolescence, n’en avaient les empereurs romains, les fleuves d’Amérique ou les hexamètres de Virgile. Mais, au moment où il décide de rompre, Cécilia, sans explication, ne vient pas au rendez-vous. De banal, insignifiante, sans consistance, la personnalité de la jeune fille, tout à coup, se révèle insaisissable, trouble, fuyante. Elle devient promesse de sens pour Dino qui, mû par une passion devenue incontrôlable et autodestructrice, va dès lors s’efforcer obstinément et vainement d’en cerner les contours.
L’histoire, qui pourrait avoir des accents proustiens, suit en réalité un tout autre cours. Swann, qui trouvait Odette vulgaire, s’est pris d’une passion douloureuse pour la courtisane dès le moment où il a pu l’assimiler à une œuvre d’art. Il s’en libérera en s’efforçant de ramener Odette aux dimensions d’une amante infidèle, puis d’une banale épouse bourgeoise, c’est-à-dire à ce qu’elle est fondamentalement. Ce stratagème ne réussit pas à Dino malgré tous les pièges qu’il tend à Cécilia pour la rabaisser au commun, au vulgaire, ou pour faire entrer la Muse en ménage. La jeune fille reste toujours aussi énigmatique, non pas tant parce qu’elle est intrinsèquement mystère, mais parce que Dino s’ingénie à la parer de sens alors qu’elle n’est qu’une huître qui s’est refermée sur la banalité affligeante de sa vie, confiant à son corps et à l’immédiateté les seuls plaisirs que lui procure l’existence. Lorsqu’il se plaint de ne pouvoir posséder son intériorité en même temps que son corps, elle lui répond: «Dedans, il n’y a que mes poumons, mon cœur, mon foie, mes intestins. Qu’en ferais-tu?» Là où Dino l’intellectuel postule du sens, Cécilia l’animal robot ne voit que tautologies: «– Qu’éprouves-tu quand tu t’ennuies? – J’éprouve de l’ennui. – Qu’est-ce donc que l’ennui? – L’ennui c’est l’ennui».
On comprend alors mieux les tourments du narrateur: il y a chez cet intellectuel, comme peut-être chez tout intellectuel, une nécessité d’un système explicatif global auquel confronter la réalité, un questionnement incessant, une tyrannie du sens qui consiste à sommer les choses de lui livrer complètement une signification que, de toute évidence, elles n’ont pas. Cet activisme (forcément) doctrinaire engendré par l’esprit de système peut déboucher sur une forme de terrorisme de la pensée, susceptible d’investir violemment le champ politique à l’image des Brigades Rouges pour anéantir une bourgeoisie capitaliste devenue, après l’achèvement de sa mission historique, conservatrice et rétrograde, incapable de produire du sens autrement que dans un absurde amas d’objets. Une telle société doit disparaître – d’où la haine de Dino pour la classe sociale dont il est issu – au profit d’une autre susceptible de générer du sens.
Chez l’intellectuel donc, l’inacceptable, le crime absolu est l’absence de sens. En conséquence, pour lui, l’ennui ne serait pas rupture avec le réel ou carence de désir, mais désir fatalement inassouvi. A l’image de Dino, l’intellectuel ne vit que s’il comprend; et l’impuissance à comprendre entraîne l’impuissance à vivre, le dégoût, la nausée, l’inappétence. En un mot, l’Ennui... Et à l’image de Cécilia, la réalité n’est qu’éclats insaisissables, vides, fuyants; elle est dépourvue de toute signification autre que celles dont on s’efforce de la parer...
Le narrateur, comme de bien entendu, finira sa vaine quête de sens – son désir impossible de posséder entièrement Cécilia – contre la dure réalité d’un arbre sur lequel il jette intentionnellement sa vieille voiture. Mais non, voyons! Il n’en meurt pas puisqu’il raconte son histoire. Mais il découvrira dans cet affrontement physique avec la mort le chemin de sa rédemption: il se contentera de regarder Cécilia vivre sans plus vouloir la posséder. La contemplation du monde, si elle est renoncement à la tyrannie de l’ordre et du système, n’en offre pas moins des ouvertures qui font sens pour celui qui sait la patience et l’humilité...
Quant au lecteur, en refermant le roman, il ne peut s’empêcher de penser que le génie de Moravia c’est aussi d’avoir écrit 400 pages sur l’Ennui sans jamais être ennuyant une seule ligne...
Alberto Moravia, L’Ennui, Flammarion, 1986
08:25 | Lien permanent | Commentaires (2)
Commentaires
Très belle analyse du roman de Moravia au coeur duquel on trouve l'appréhension de l'absurde, de l'impossibilité d'être concerné, d'où découle ce type d'ennui, qui guette beaucoup de nos congénères. On ne s'ennuie jamais dans les récits de cet immense auteur, dont la lecture vaut mieux que les adaptations cinématographiques. Merci.
Écrit par : Micheline P. | 20/01/2014
io e lui , très jeune j'avais adoré lire "moi et lui" de Moravia , depuis c'est plutôt lui et moi.
Écrit par : briand | 22/01/2014