Par Pierre Béguin
Un virus est fondamentalement démocratique. Il se propage de manière aléatoire dans toutes les couches de la société, il ne reconnaît ni genre ni race ni frontières politiques, sociales ou géographiques. Or, les épidémies censées être causées par le VIH-SIDA diffèrent tant du point de vue clinique qu’épidémiologique: tandis qu’en Afrique elles semblent aléatoires, en Europe et aux Etats-Unis, elles sont fortement non aléatoires, touchant 80% des hommes et se limitant principalement à des groupes marginaux à risque.
Un virus n’est ni polyvalent ni polymorphe. Le virus de la rougeole, par exemple, n’est présent que chez les rougeoleux, celui de la grippe que chez les grippés. Avec la VIH-SIDA, une nouvelle ère a commencé: celle des virus polyvalents, polymorphes et tout-puissants, capables de causer une importante variété de maladies infectieuses dues à l’immunodéficience, mais aussi des pathologies n’ayant rien à voir avec le système immunitaire.
En se basant sur les mêmes critères que pour toutes les autres maladies de type viral, le VIH devrait provoquer le SIDA dans les semaines suivant l’infection. Or, il nécessite, prétend-on, une période de latence de 5 à 10 ans après l’apparition de la réaction immunitaire antivirale. De même, toutes les maladies vénériennes, dès qu’elles ont été sexuellement transmises, provoquent une infection dont les symptômes sont manifestes après quelques jours, contrairement au «virus» du SIDA qui ne provoquerait une séroconversion qu’après plusieurs semaines ou mois.
Voici trois constatations parmi beaucoup d’autres que d’éminents scientifiques toujours plus nombreux – et parmi eux plusieurs prix Nobel – formulent pour mettre en cause la version officielle qui veut qu’un virus, appelé virus de l’immunodéficience humaine (VIH), soit la cause de l’épidémie SIDA. Ces opposants à la thèse officielle, qu’ils suspectent d’être manipulée par les grands groupes pharmaceutiques, sont appelés les «dissidents». Des illuminés?
Rappelons tout d’abord que, de 1981 à 1984, en considérant que l’immunodéficience constituait le dénominateur commun à cette apparition d’une nouvelle épidémie qui semblait frapper les milieux homosexuels de manière non aléatoire, de nombreux chercheurs de pointe, confrontés à ces cas soudain d’effondrement du système immunitaire, ont suspecté plusieurs causes pour expliquer cette nouvelle pathologie, parmi les plus évidentes l’utilisation de substances toxiques et le style de vie des malades (malnutrition par exemple). Ce n’est qu’à partir de 1984 que des chercheurs du gouvernement américain ont émis l’hypothèse qu’un virus était la cause de cette nouvelle pathologie. Bientôt, on annonça, aux Etats-Unis et en France (on se souvient de la controverse entre les professeurs Gallo et Montagnier, le premier se voyant finalement contraint de partager son petit pactole avec le second), avoir découvert un agent infectieux, le VIH, à qui l’on attribua la responsabilité exclusive du syndrome.
Dès lors, en 1985, le public fut averti qu’un terrible fléau menaçait le genre humain, par un battage médiatique – «fort bien orchestré» prétendent les dissidents, et qui fit dire à Coluche que «le SIDA est une maladie qui se transmet médiatiquement» – dont le résultat fut de susciter un vent de panique dans la population.
Pourquoi, alors que la malnutrition et l’usage de substances dangereuses pour le système immunitaire (drogues, certains médicaments, sang transfusé) étaient parfaitement connus et documentés comme causes d’immunodéficience, l’hypothèse du virus seule prévalut? Pourquoi, alors que les premiers cas de SIDA observés et décrits faisaient tous mention d’usage de drogues dures (poppers) et qu’il était connu que ces malades, tous homosexuels, ne s’étaient jamais rencontrés, donc n’auraient pas pu se contaminer l’un l’autre, contre toute évidence a-t-on privilégié la thèse de la maladie infectieuse? Parce que les recherches, principalement aux Etats-Unis, devenaient un big business qui exigeait des crédits énormes. Selon les dissidents, tant que les malades étaient seulement des homosexuels drogués, leur nombre n’était pas suffisant pour justifier des crédits monumentaux. D’où «l’invention» du SIDA hétérosexuel, soi-disant échappé du premier groupe à risque par le chaînon des bisexuels. Sonnèrent alors les clairons du malheur: ainsi libéré de ses premières frontières, le fléau, sous la forme d’un monstrueux virus, allait faire des ravages dans le monde, décimant des populations entières. Dès lors, les crédits publics se mirent à pleuvoir… et ils pleuvent toujours. Voici venu le temps du SIDA business. Quant aux scientifiques, comme le concède l’un d’entre eux, ils vont naturellement là où se trouvent les crédits. D’autant plus que l’omerta contre les opposants à la thèse du virus fut radicale: suppression des crédits de recherche, censure des principales revues scientifiques, statut universitaire contesté, etc.
Sauf que… Trente ans plus tard, toujours pas le moindre petit vaccin en vue. «Et pour cause» ironisent les dissidents. Pire: non seulement il n’existe à ce jour, toujours selon nos dissidents, très strictement aucune preuve de la contagiosité du SIDA, aucune investigation n’a jamais réussi à mettre directement en évidence, chez un malade du SIDA, la moindre particule virale, ni la moindre particule de rétrovirus. En clair, le VIH reste insaisissable. Trente ans de recherche et des montagnes de dollars plus tard, le microbe est toujours virtuel. Mais le plus monstrueux, accusent les dissidents, c’est que la communauté scientifique n’a rien trouvé de mieux que de traiter des patients immunodéficients à l’aide de produits immunodépresseurs, aggravant ainsi leur état au lieu de l’améliorer, et que cette médication dangereuse est parfois prescrite à des personnes en parfaite santé, sous le prétexte qu’un test sérologique positif les avait classées dans la catégorie des victimes d’une prétendue infection. Un test dont la pertinence est bien évidemment contestée.
Voici fortement schématisés et résumés les principaux postulats énoncés par le Docteur Etienne de Harven, professeur d’anatomopathologie à l’Université de Toronto, dans son livre Les dix plus gros mensonges sur le SIDA, paru aux éditions Dangles en 2005. Il y aborde entre autres les questions suivantes:
-
Si le VIH est la cause du SIDA, pourquoi le SIDA touche-t-il de nombreuses personnes qui s’obstinent à rester séronégatives?
-
Pourquoi, même chez un malade en phase terminale, les chercheurs détectent-ils si peu d’activité virale qu’elle serait incapable d’affaiblir le système immunitaire?
-
Comment se fait-il qu’aucun rétrovirus n’ait jamais provoqué la moindre maladie chez l’homme, sauf le VIH?
-
Pourquoi le fait de posséder des anticorps contre un virus est-il le signe que le corps réagit favorablement, excepté dans le cas du VIH?
-
Comment le VIH peut-il provoquer des dizaines de maladies dont certaines n’ont rien à voir avec l’immunodéficience?
-
Pourquoi les personnes séropositives correctement nourries, n’absorbant ni stupéfiants ni médicaments antiviraux et ayant correctement géré leur stress ne développent-elles pas de SIDA?
-
Pour quelle raison le SIDA touche-t-il massivement les hommes dans les pays développés et préfère-t-il les femmes dans les pays pauvres?
Et bien d’autres questions pertinentes encore. Que les choses soient bien claires: parfaitement béotien en la matière, je ne saurai prendre parti. Mais puisque nous avons deux yeux, deux oreilles, et même deux lobes de cerveau, nous pouvons entendre deux sons de cloche et appréhender deux théories opposées sans que ne s’embrouillent nos neurones. Comme le disait Scott Fitzgerald cité en exergue par l’éditeur: «Le signe d’une intelligence supérieure est de pouvoir entretenir simultanément deux idées contradictoires dans son esprit, et de continuer d’agir». A celles ou ceux capables d’une telle ouverture, je recommande vivement cette lecture.
Les dix plus gros mensonges sur le SIDA, Etienne de Harven, Jean-Claude Roussiez, Dangles éditions, 2005
 Céline Cerny fait parler les enfants. Mais on n'est pas dans un paradis vert et rose. Les enfants seuls rappelle plutôt que les bambins sont des radars sensibles, intelligents, fragiles et implacables.
Céline Cerny fait parler les enfants. Mais on n'est pas dans un paradis vert et rose. Les enfants seuls rappelle plutôt que les bambins sont des radars sensibles, intelligents, fragiles et implacables. Mais les impressions qu'en reçoivent les enfants sont lucides. Ils vivent dans un système de règles qui s'imposent, qui se contredisent, qu'il n'est pas possible de contester mais qu'ils perçoivent clairement, et auquel ils s'adaptent. On ne juge pas – ou on commence de juger à l'adolescence, comme Valentine, quatorze ou quinze ans.
Mais les impressions qu'en reçoivent les enfants sont lucides. Ils vivent dans un système de règles qui s'imposent, qui se contredisent, qu'il n'est pas possible de contester mais qu'ils perçoivent clairement, et auquel ils s'adaptent. On ne juge pas – ou on commence de juger à l'adolescence, comme Valentine, quatorze ou quinze ans. Le beau Géo était plein de promesses. Auteur de théâtre à succès, manieur de mots, cultivé, Prix Schiller. Et antisémite virulent. Cette haine l'a poussé vers la politique. Fondant un journal satirique, Le Pilori, qui s'attaquait aux juifs, aux francs-maçons aux politiques, aux élites, il a également créé un parti fasciste, dont il est devenu le chef unique et incontesté. Sa devise : « une doctrine, une foi, un chef ». C'est ce parti qui a mis en accusation deux socialistes, Léon Nicole et Jacques Dicker, l'arrière-grand-père de l'écrivain, en 1932. Dans la contre-manifestation qui suit, l'armée tire sur la foule.
Le beau Géo était plein de promesses. Auteur de théâtre à succès, manieur de mots, cultivé, Prix Schiller. Et antisémite virulent. Cette haine l'a poussé vers la politique. Fondant un journal satirique, Le Pilori, qui s'attaquait aux juifs, aux francs-maçons aux politiques, aux élites, il a également créé un parti fasciste, dont il est devenu le chef unique et incontesté. Sa devise : « une doctrine, une foi, un chef ». C'est ce parti qui a mis en accusation deux socialistes, Léon Nicole et Jacques Dicker, l'arrière-grand-père de l'écrivain, en 1932. Dans la contre-manifestation qui suit, l'armée tire sur la foule.
 Nouaison. « Nouer (verbe intransitif): passer à l'état de fruit. » Il s'agit dans ce livre de Sylvia Härri de conception, d'enfantement, de naissance. Mais rien de niais, rien de mièvre. (On peut le craindre avec de tels sujets.) Rien de poético-précieux. (On pourrait le craindre avec ce titre.) Tout est profond, signifiant. De courts chapitres ramassés évoquent les difficultés physiques à concevoir, l'envie d'enfant, le corps, ses troubles, ses dérèglements, la médecine, l'intervention, la grossesse. La forme est allusive, l'écriture dense. Nouaison est un de ces livres qui parviennent à saisir du sens, de la gravité, à refléter ce qui fait l'importance, l'intérêt et le tragique de la vie.
Nouaison. « Nouer (verbe intransitif): passer à l'état de fruit. » Il s'agit dans ce livre de Sylvia Härri de conception, d'enfantement, de naissance. Mais rien de niais, rien de mièvre. (On peut le craindre avec de tels sujets.) Rien de poético-précieux. (On pourrait le craindre avec ce titre.) Tout est profond, signifiant. De courts chapitres ramassés évoquent les difficultés physiques à concevoir, l'envie d'enfant, le corps, ses troubles, ses dérèglements, la médecine, l'intervention, la grossesse. La forme est allusive, l'écriture dense. Nouaison est un de ces livres qui parviennent à saisir du sens, de la gravité, à refléter ce qui fait l'importance, l'intérêt et le tragique de la vie.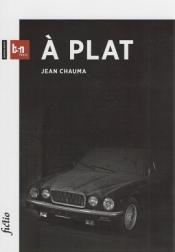 Livre après livre, Jean Chauma creuse son sillon. Il a un champ bien à lui, nourri par des expériences antérieures, du temps où il était voyou. Ce milieu-là, celui des années 70 et 80, est son Combray.
Livre après livre, Jean Chauma creuse son sillon. Il a un champ bien à lui, nourri par des expériences antérieures, du temps où il était voyou. Ce milieu-là, celui des années 70 et 80, est son Combray. Jean a cent kilos, une gueule de brute, des complets bien coupés. Il est bien intégré dans sa banlieue, boit l'apéro avec les flics, visite ses beaux-frères, un Arabe qui tient un boui-boui, un autre qui possède une salle de jeux, fait la tournée de ses sœurs, dont celle qui est assez mal vue dans la famille parce qu'elle a décidé de s'élever socialement et de faire des études : elle a passé un CAP de coiffeuse-esthéticienne.
Jean a cent kilos, une gueule de brute, des complets bien coupés. Il est bien intégré dans sa banlieue, boit l'apéro avec les flics, visite ses beaux-frères, un Arabe qui tient un boui-boui, un autre qui possède une salle de jeux, fait la tournée de ses sœurs, dont celle qui est assez mal vue dans la famille parce qu'elle a décidé de s'élever socialement et de faire des études : elle a passé un CAP de coiffeuse-esthéticienne.