Par Pierre Béguin
Les plus de soixante ans s’en souviennent-ils?
En 1971, une communiste italienne, une certaine Maria-Antonietta Macciocchi, en rédigeant le journal de son voyage en Chine, publie le best seller de l’année qui va bouleverser, en occident, la perception politique des plus grands intellectuels de la décennie. C’est ce que nous rappelle Pierre Bayard dans un merveilleux petit essai paru aux éditions de Minuit: Comment parler des faits qui ne se sont pas produits?
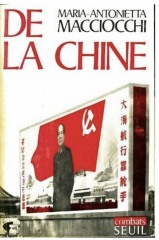 A cette époque, la Chine est un pays complètement fermé. Macciocchi, par son appartenance au parti communiste, fut l’une des premières à y obtenir un visa pour un séjour de plusieurs semaines. Dans son livre De la Chine, elle révèle l’existence d’un monde extraordinaire où la révolution industrielle et la modernisation font des miracles. La production a centuplé, sans que les ouvriers ne soient soumis aux cadences infernales de l’occident. Toutes les femmes sont naturellement belles et ont retrouvé leur place à part entière dans la société, bien loin de la femme objet telle que le capitalisme l’a conçu. Comme Jésus, Mao fait des miracles: «Quand j’avais deux ans, j’étais sourde et muette (…) Mao a envoyé les soldats de l’armée populaire de libération pour guérir la surdité et le mutisme. Après un an de traitement, je puis entendre et je peux crier: Vive le Président Mao!» (témoignage d’une jeune chinoise). Le système de répartition des tâches entre travailleurs manuels et intellectuels fait lui aussi des miracles. Des professeurs expliquent «le grand bouleversement intérieur», la cure de jouvence et l’incommensurable bonheur que leur a apporté la fatigue physique du travail dans les rizières. Et si on ne trouve aucun témoignage d’un travailleur manuel s’extasiant sur les bienfaits que lui auraient procuré la fréquentation des grands penseurs et le monde abscons de l’astrophysique, il n’en reste pas moins que cette union de la théorie et de la pratique, au cœur de la pensée maoïste, semble résoudre comme par enchantement, à en croire Macciocchi, tous les problèmes sociaux et économiques, même ceux du quotidien, en ce qu’elle permet de lutter contre toute forme de hiérarchisation et d’établir un égalitarisme absolu. Le grand rêve de la gauche enfin exaucé! Même dans l’armée chinoise, les grades ont disparu, ce qui n’empêche pas cette armée d’être l’une des plus disciplinée au monde. Et le plus incroyable: toute cette révolution s’est opérée sans violence.
A cette époque, la Chine est un pays complètement fermé. Macciocchi, par son appartenance au parti communiste, fut l’une des premières à y obtenir un visa pour un séjour de plusieurs semaines. Dans son livre De la Chine, elle révèle l’existence d’un monde extraordinaire où la révolution industrielle et la modernisation font des miracles. La production a centuplé, sans que les ouvriers ne soient soumis aux cadences infernales de l’occident. Toutes les femmes sont naturellement belles et ont retrouvé leur place à part entière dans la société, bien loin de la femme objet telle que le capitalisme l’a conçu. Comme Jésus, Mao fait des miracles: «Quand j’avais deux ans, j’étais sourde et muette (…) Mao a envoyé les soldats de l’armée populaire de libération pour guérir la surdité et le mutisme. Après un an de traitement, je puis entendre et je peux crier: Vive le Président Mao!» (témoignage d’une jeune chinoise). Le système de répartition des tâches entre travailleurs manuels et intellectuels fait lui aussi des miracles. Des professeurs expliquent «le grand bouleversement intérieur», la cure de jouvence et l’incommensurable bonheur que leur a apporté la fatigue physique du travail dans les rizières. Et si on ne trouve aucun témoignage d’un travailleur manuel s’extasiant sur les bienfaits que lui auraient procuré la fréquentation des grands penseurs et le monde abscons de l’astrophysique, il n’en reste pas moins que cette union de la théorie et de la pratique, au cœur de la pensée maoïste, semble résoudre comme par enchantement, à en croire Macciocchi, tous les problèmes sociaux et économiques, même ceux du quotidien, en ce qu’elle permet de lutter contre toute forme de hiérarchisation et d’établir un égalitarisme absolu. Le grand rêve de la gauche enfin exaucé! Même dans l’armée chinoise, les grades ont disparu, ce qui n’empêche pas cette armée d’être l’une des plus disciplinée au monde. Et le plus incroyable: toute cette révolution s’est opérée sans violence.
La vraie question ici n’est pas de savoir comment notre communiste italienne a gobé, sans aucun recul critique, la propagande maoïste orchestrée pour leurrer l’idiote utile qu’elle fut en la circonstance. Il est vrai qu’elle n’a jamais travaillé dans les rizières chinoises et que son témoignage constituait alors une avancée non négligeable pour sa carrière. Mais ceci n’explique pas tout. Les sciences cognitives ont depuis longtemps développé la notion de biais de confirmation, à savoir la propension de l’être humain à sélectionner a priori, dans sa perception du réel, tous les éléments allant dans le sens de la représentation initiale qu’il s’en était faite, et bien entendu à évacuer en toute bonne conscience tous ceux qui pourraient la contredire et qui lui rendraient alors le monde trop complexe, voire illisible ou incohérent.
Non. La vraie question consiste à comprendre comment une telle fable a pu trouver un terrain aussi fertile à sa propagation chez les plus grands penseurs et intellectuels occidentaux (– ce que j’appelle «la bêtise des intelligents» est un des phénomènes qui a depuis longtemps monopolisé en moi la plus grande charge d’étonnement). Tant on peine à imaginer l’engouement qu’a suscité alors le livre de Macciocchi. Ainsi Philippe Sollers, qui a fait publier ce texte au Seuil et qu’on n’imagine pourtant très mal travailler dans les rizières, de s’enthousiasmer dans un jargon très marqué «intello seventies»: «De la Chine représente aujourd’hui non seulement un admirable témoignage sur la Chine révolutionnaire, mais encore une source d’analyses théoriques qu’il serait illusoire de croire refoulées. De la Chine, c’est la puissance et la vérité du «nouveau» lui-même, c’est l’un des très rares livres d’aujourd’hui, de demain. Le travail de Maria-Antonietta Macciocchi a devant lui toute l’histoire.» Quel exceptionnel visionnaire, ce Sollers, n’est-il pas! Imaginez l’étendue de ses lumières si, en plus, il avait pu profiter des bienfaits du maoïsme en travaillant dans les rizières!
Mais il n’est pas seul, loin s’en faut. Tous les membres du groupe d’avant garde Tel Quel décident in corpore de rompre avec le parti communiste français pour se rallier à la doctrine maoïste, les philosophes – rappelons-le – ayant cette propension, qu’ils partagent avec les mages et les enfants, pour les systèmes déconnectés de la réalité. C’est ainsi qu’une délégation d’intellectuels composée des inévitables Philippe Sollers, Julia Kristeva, Roland Barthes, Marcelin Pleynet, et j’en passe et des pires, se rendent en Chine pour un mois. A leur retour, aucun ne semble avoir pris conscience d’avoir visité un pays totalitaire. Au contraire, le concert de louanges est tel que le maoïsme devient l’idéologie à la mode, transformant le collectivisme chinois en une utopie romanesque. Une idéologie d’autant plus consistante qu’elle est bientôt soutenue par des milliers de personnes qui se confortent mutuellement dans leur croyance pour construire ce qu’il faut bien appeler un délire collectif. Toujours prompte à l’emballement, et jamais avare de sottises prétentieuses, une bonne partie de la jeunesse estudiantine se convertit à la nouvelle religion, des affiches Vive Mao fleurissent aussitôt sur les murs des chambres d’adolescents dont la révolte a trouvé son Dieu. La première moitié des seventies, avant que la vague disco, entre autres, ne balaie cette hérésie (qu’ABBA soit béni!), est maoïste ou n’est pas.
On me rétorquera que nous vivons dans une civilisation où des millions de personnes admettent encore sans sourcilier, et sans même convoquer une explication symbolique, qu’une femme mariée et vierge puisse enfanter un fils par immaculée conception, que ledit fils fasse des miracles à la pelle, et qu’après avoir été crucifié et dûment authentifié comme mort, il ressuscite, «ôte la pierre» de son tombeau et rejoigne son véritable père au ciel. A côté d’une telle croyance, l’idéalisation de la Chine dans les années 70 semble une fiction finalement assez banale, et les intellectuels qui y adhérèrent des esprits touchés par la grâce des Lumières. Certes...
Pour que de tels aveuglements généralisés puissent se produire, il faut admettre comme incontournable chez l’être humain une disposition psychique si puissante qu’elle peut balayer comme fétu de paille toute forme de bon sens. Ce «besoin de croire» est d’autant plus fort qu’il place le sujet au plus profond de lui-même par le biais du mécanisme inconscient de l’idéalisation. Nous devons croire, et croire dans la possibilité d’une œuvre parfaite, qu’elle émane de Dieu, de Michel Angelo, de Lionel Messi, du collectivisme chinois ou d’un monde purifié par la transition écologique. L’«objet» de ce besoin de croire étant finalement aléatoire, volatile, un autre objet peut aisément lui être substitué si l’idéalisation s’étiole. Et elle finit toujours par s’étioler. A ce propos, il n’est pas anodin de préciser que Macciocchi, après s’être éloignée du communisme, est tombée en fascination pour la figure de Jean-Paul II, auquel elle a consacré un livre aussi élogieux pour le pape et le Vatican que De la Chine l’était pour le régime de Mao. Dans le même ordre d’idée, un chantre de mai 68, qui avait rejoint un autre Jean-Paul sanctifié (Sartre) devant les usines Renault, est devenu plus tard PDG de ces mêmes usines Renault. Si le besoin de croire est inamovible, l’objet idéalisé de ce besoin est parfaitement interchangeable, et ne craint pas les pires contradictions.
Puisqu’il faut admettre comme intangible cette double pulsion de croyance et d’idéalisation, à titre personnel (mais ceci est anecdotique), je rejoins Montaigne dans son pragmatisme et je fais mien le pari de Pascal. Tout en précisant que, par naissance et par éducation, je penche vers une église chrétienne, jusqu’à nouvel avis moins dangereuse pour les petits enfants que celle dont Macciocchi, qui avait un talent pour se tromper proportionnel à son besoin de croire, a fait l’éloge via sa plus haute autorité spirituelle.
Quand se produit un affaiblissement, pour ne pas dire un effondrement, de l’adhésion populaire à la croyance officielle et à ses valeurs, en l’occurrence le christianisme pour l’occident, la masse se retrouve sans véritable modèle de référence et saute alors sur toute proposition de substitution, politique ou autres, aussi délirantes soient-elles, ne serait-ce que pour éviter d’affronter ce moment de dépression inhérent à la perte des illusions. Des modèles qui filtrent et fleurissent à souhait d’autant plus que la digue «officielle» se fissure de partout. C’est ainsi que le XXIe siècle, pourtant si jeune, se voit proposer, ou plutôt imposer à coups d’anathèmes, des fictions ou des processus d’idéalisation qui sont autant de croyances douteuses se cachant, pour mieux ancrer leur fragile légitimité, sous un jargon pseudo scientifique et culpabilisant. Mais quand ce processus s’installe dans les esprits, il est quasiment impossible de le déprendre de l’objet investi, car cette opération impliquerait, pour un sujet converti qui s’est projeté dans l’objet de sa croyance, de s’attaquer lui-même. D’où l’extrême difficulté de cesser de croire à ses idéaux, le cas échéant de reconnaître que l’on s’est trompé, l’enjeu étant ici non pas intellectuel mais psychologique. Ainsi, faire débattre un climato-sceptique avec un réchauffiste urgentiste serait aussi vain que de mettre en confrontation un agnostique avec un témoin de Jéhovah. Ainsi, contester à un adepte de la gauche sociétale, convaincu d’appartenir à l’Empire du Bien et de propager la bonne parole progressiste, le bien-fondé de la philosophie genre, dont il n’a le plus souvent aucune idée des fondements philosophiques très discutables, relève d’une entreprise périlleuse, voire suicidaire, si cette personne compte parmi vos amis.
Maîtriser la dangerosité potentielle d’une croyance à laquelle on adhérerait, c’est d’abord admettre qu’il ne s’agit, ni plus ni moins, que d’une croyance, pour nécessaire qu’elle soit à notre psychisme. Le problème avec les grandes vagues sociétales, politiques ou idéologiques qui, actuellement, agitent et déconstruisent méthodiquement l’occident (car le régime chinois, lui, si idéalisé par nos grands intellectuels de gauche des 70’s, non seulement s’en contrefiche mais s’en frotte les mains), c’est qu’elles ne se reconnaissent pas pour ce qu’elles sont fondamentalement – des croyances – en se donnant, avec la foi du charbonnier, un soi-disant fondement scientifique, sérieusement colporté par une multitude de Homais.
Mutatis mutandi, le mécanisme qui a produit le délire collectif d’une vision idéale de la Chine et alimenté la propagande maoïste en occident dans les années 70 est symptomatique des mêmes délires qui, de nos jours, submergent et menacent d’engloutir le peu de valeurs sur lesquelles repose notre désormais fragile civilisation.
Tout comme je m’interroge en ce moment sur les raisons qui ont vu des intellectuels, des philosophes, des milliers de gens «intelligents», disserter sérieusement pendant des années sur une Chine imaginaire et totalement fantasmée, il est certain que, dans 30 ou 40 ans, on s’interrogera sur les délires collectifs de gens très sérieux qui s’affolent à la perspective d’une fin du monde programmée au pire en 2030, au mieux à la fin du siècle (alors que c’est plus vraisemblablement notre civilisation occidentale qui s’effondre, logiquement, tant on ne cesse d’en déconstruire tous les fondements); ou encore sur les raisons qui ont poussé des intellectuel(le)s, soutenu(e)s avec opportunisme par nombre de politicien(ne)s, à croire sérieusement qu’hommes et femmes - pardon, «personnes avec vagin» - sont non seulement des notions variables dans le temps et l’espace, mais aussi des notions arbitraires, conventionnelles dont on peut se passer, et des militant(e)s fanatiques à proclamer que le «genre» n’a pas à se laisser dicter sa loi par la nature, niant ainsi toute limite biologique à la liberté humaine au motif que toute réalité est strictement intra-langagière.
Et tout comme nous faisons maintenant le procès des débordements sexuels d’alors, on fera celui des délires actuels. Quelle réflexion portera-t-on en l’an de grâce 2050 sur une idéologie visant à destituer l’hétéronormativité pour lui substituer une société dans laquelle tout est légitime (du moins en ce qui concerne le choix identitaire, car pour le reste...)? Comment jugera-t-on l’action politique laissant des enfants, parfois dès l’école primaire, choisir librement leur identité sexuelle en fonction d’un ressenti, certes fluctuant, mais érigé en norme absolue? Des personnes (avec ou sans vagin) auront-elles à payer le prix de leurs actes, comme on demande maintenant des comptes à celles qui, il y a 40 ans, ont transgressé des limites qu’on voulait ignorer alors?
Pour autant qu’il reste quelque chose de notre civilisation, et qu’un tel constat jouisse encore de conditions propices à sa réalisation, je souhaite bonne chance à cette personne, tant sa tâche paraît plus ardue que la mienne: à côté des délires collectifs d’une insondable bêtise qui nous submergent actuellement, le délire qui fantasmait avec un sérieux grotesque une Chine idéale ne semble plus que de la simple roupille de sansonnet…
Pierre Bayard, Comment parler des faits qui ne se sont pas produits? Les éditions de Minuit, 2020
Maria-Antonietta Macciocchi, De la Chine, Seuil, 1971
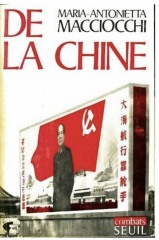 A cette époque, la Chine est un pays complètement fermé. Macciocchi, par son appartenance au parti communiste, fut l’une des premières à y obtenir un visa pour un séjour de plusieurs semaines. Dans son livre De la Chine, elle révèle l’existence d’un monde extraordinaire où la révolution industrielle et la modernisation font des miracles. La production a centuplé, sans que les ouvriers ne soient soumis aux cadences infernales de l’occident. Toutes les femmes sont naturellement belles et ont retrouvé leur place à part entière dans la société, bien loin de la femme objet telle que le capitalisme l’a conçu. Comme Jésus, Mao fait des miracles: «Quand j’avais deux ans, j’étais sourde et muette (…) Mao a envoyé les soldats de l’armée populaire de libération pour guérir la surdité et le mutisme. Après un an de traitement, je puis entendre et je peux crier: Vive le Président Mao!» (témoignage d’une jeune chinoise). Le système de répartition des tâches entre travailleurs manuels et intellectuels fait lui aussi des miracles. Des professeurs expliquent «le grand bouleversement intérieur», la cure de jouvence et l’incommensurable bonheur que leur a apporté la fatigue physique du travail dans les rizières. Et si on ne trouve aucun témoignage d’un travailleur manuel s’extasiant sur les bienfaits que lui auraient procuré la fréquentation des grands penseurs et le monde abscons de l’astrophysique, il n’en reste pas moins que cette union de la théorie et de la pratique, au cœur de la pensée maoïste, semble résoudre comme par enchantement, à en croire Macciocchi, tous les problèmes sociaux et économiques, même ceux du quotidien, en ce qu’elle permet de lutter contre toute forme de hiérarchisation et d’établir un égalitarisme absolu. Le grand rêve de la gauche enfin exaucé! Même dans l’armée chinoise, les grades ont disparu, ce qui n’empêche pas cette armée d’être l’une des plus disciplinée au monde. Et le plus incroyable: toute cette révolution s’est opérée sans violence.
A cette époque, la Chine est un pays complètement fermé. Macciocchi, par son appartenance au parti communiste, fut l’une des premières à y obtenir un visa pour un séjour de plusieurs semaines. Dans son livre De la Chine, elle révèle l’existence d’un monde extraordinaire où la révolution industrielle et la modernisation font des miracles. La production a centuplé, sans que les ouvriers ne soient soumis aux cadences infernales de l’occident. Toutes les femmes sont naturellement belles et ont retrouvé leur place à part entière dans la société, bien loin de la femme objet telle que le capitalisme l’a conçu. Comme Jésus, Mao fait des miracles: «Quand j’avais deux ans, j’étais sourde et muette (…) Mao a envoyé les soldats de l’armée populaire de libération pour guérir la surdité et le mutisme. Après un an de traitement, je puis entendre et je peux crier: Vive le Président Mao!» (témoignage d’une jeune chinoise). Le système de répartition des tâches entre travailleurs manuels et intellectuels fait lui aussi des miracles. Des professeurs expliquent «le grand bouleversement intérieur», la cure de jouvence et l’incommensurable bonheur que leur a apporté la fatigue physique du travail dans les rizières. Et si on ne trouve aucun témoignage d’un travailleur manuel s’extasiant sur les bienfaits que lui auraient procuré la fréquentation des grands penseurs et le monde abscons de l’astrophysique, il n’en reste pas moins que cette union de la théorie et de la pratique, au cœur de la pensée maoïste, semble résoudre comme par enchantement, à en croire Macciocchi, tous les problèmes sociaux et économiques, même ceux du quotidien, en ce qu’elle permet de lutter contre toute forme de hiérarchisation et d’établir un égalitarisme absolu. Le grand rêve de la gauche enfin exaucé! Même dans l’armée chinoise, les grades ont disparu, ce qui n’empêche pas cette armée d’être l’une des plus disciplinée au monde. Et le plus incroyable: toute cette révolution s’est opérée sans violence. La tradition littéraire anglo-saxonne consiste à produire des biographies qui tendent vers l’objectif, l’exhaustif, le factuel. Ce qui peut engendrer de gros pavés à la lecture parfois un peu fastidieuse pour le profane.
La tradition littéraire anglo-saxonne consiste à produire des biographies qui tendent vers l’objectif, l’exhaustif, le factuel. Ce qui peut engendrer de gros pavés à la lecture parfois un peu fastidieuse pour le profane.