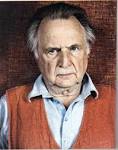Régis Debray, fin de siècle
par Jean-Michel Olivier
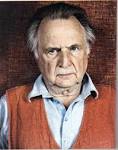 Comme l'ornithorynque ou le panda, l'Intellectuel Français (ou I.F. pour reprendre le sigle inventé par Régis Debray dans un livre passionnant*) est une espèce en voie de disparition. Héritier lointain de l'Intellectuel Originel (ou I.O.), dont les plus fameux spécimens s'illustrèrent lors de l'affaire Dreyfus, l'I.F. voit aujourd'hui sa fin venir, supplanté par l'I.T. (ou Intellectuel Terminal) qui ne pense plus en terme en droit ou d'éthique, mais exprime ses humeurs au jour le jour — de préférence dans les pages “ Débats ” de Libération ou du Monde — dans l'espoir d'en tirer un bénéfice médiatique immédiat, et d'occuper la scène intellectuelle.
Comme l'ornithorynque ou le panda, l'Intellectuel Français (ou I.F. pour reprendre le sigle inventé par Régis Debray dans un livre passionnant*) est une espèce en voie de disparition. Héritier lointain de l'Intellectuel Originel (ou I.O.), dont les plus fameux spécimens s'illustrèrent lors de l'affaire Dreyfus, l'I.F. voit aujourd'hui sa fin venir, supplanté par l'I.T. (ou Intellectuel Terminal) qui ne pense plus en terme en droit ou d'éthique, mais exprime ses humeurs au jour le jour — de préférence dans les pages “ Débats ” de Libération ou du Monde — dans l'espoir d'en tirer un bénéfice médiatique immédiat, et d'occuper la scène intellectuelle.
Intervenir dans la vie politique, pour un écrivain ou un philosophe, aura toujours été, depuis un siècle au moins, une spécialité française. On se rappelle Zola accusant, dans l'Aurore, l'Etat d'avoir condamné injustement Dreyfus. Accusation reprise par Anatole France, Barrès, Péguy, Proust et quelques autres I.O., lesquels, après maintes attaques, polémiques et menaces, eurent enfin gain de cause.
Cet engagement de l'intellectuel, qui se doit de toujours prendre position dans le débat politique de son époque, va se développer au cours du XXe siècle. En France, ses grandes figures morales seront tour à tour Gide, lorsqu'il dénonce au retour d'un voyage en URSS les conditions de vie de ce pays ; Sartre, bien sûr, qui force l'I.F. à s'engager dans le débat politique et à choisir son camp, souvent de manière péremptoire ; Raymond Aron qui, au sortir de la deuxième guerre mondiale, s'oppose à Sartre en défendant des positions tout autres ; mais aussi David Rousset ou Pierre Vidal-Naquet.
 Le point de rupture, qui pour Régis Debray marque la fin de l'I.F et sa transformation en I.T. (ou Intellectuel Terminal), advient au début des années 70 avec l'arrivée sur la scène médiatique des “ Nouveaux Philosophes ”. Plus de débat d'idées, désormais, plus d'affrontements de haute tenue, comme les querelles entre Sartre et Camus, mais des opinions assénées tels des coups de gourdin. Même si Debray cite peu de noms, on reconnaît sans peine ici la bande à Bernard-Henri Lévy, Glucksmann et autres Finkelkraut qui représentent les nouveaux maîtres du prêt-à-penser. Leur coup de génie ? Occuper les media et faire du débat d'idées un spectacle permanent. Ê“ L'I.T. a un ton judiciaire, mais un ton au-dessus du juridique. Il fait métier de juger, et non d'élucider : plutôt dénoncer qu'expliquer. Sa question préférée ? " Est-il bon, est-il mauvais ? " Elle en cache une autre, beaucoup plus grave à ses yeux : " Et moi, me retrouverais-je, ce faisant, du bon ou du mauvais côté ? "”
Le point de rupture, qui pour Régis Debray marque la fin de l'I.F et sa transformation en I.T. (ou Intellectuel Terminal), advient au début des années 70 avec l'arrivée sur la scène médiatique des “ Nouveaux Philosophes ”. Plus de débat d'idées, désormais, plus d'affrontements de haute tenue, comme les querelles entre Sartre et Camus, mais des opinions assénées tels des coups de gourdin. Même si Debray cite peu de noms, on reconnaît sans peine ici la bande à Bernard-Henri Lévy, Glucksmann et autres Finkelkraut qui représentent les nouveaux maîtres du prêt-à-penser. Leur coup de génie ? Occuper les media et faire du débat d'idées un spectacle permanent. Ê“ L'I.T. a un ton judiciaire, mais un ton au-dessus du juridique. Il fait métier de juger, et non d'élucider : plutôt dénoncer qu'expliquer. Sa question préférée ? " Est-il bon, est-il mauvais ? " Elle en cache une autre, beaucoup plus grave à ses yeux : " Et moi, me retrouverais-je, ce faisant, du bon ou du mauvais côté ? "”
Etre toujours là où quelque chose se passe (quitte à faire du tourisme médiatique comme BHL ou Bernard Kouchner). Toujours du bon côté, bien sûr — c'est-à-dire des bons sentiments ou du politiquement correct. Ne jamais s'engager sur le terrain du vrai débat philosophique (laissé aux purs spécialistes, philosophes de métier, réputés illisibles), mais raisonner en termes de chiffres plus ou moins trafiqués, de slogans péremptoires et de comparaisons démagogiques (voir les chroniques de Jacques Julliard, Alain Minc ou Jean-François Revel).
* Régis Debray, I.F. suite et fin, Folio, Gallimard, 2001.





 Dans L’immortalité, Milan Kundera met en scène une rencontre entre Goethe et Hemingway, dialoguant sur les chemins de l’au-delà. Rien, mais absolument rien de commun entre Goethe et Hemingway, me direz-vous! Il faut croire que, dans l’au-delà, Goethe (comme chacun d’entre nous, je suppose) préfère deviser avec d’autres voix que celles – Herder, Höderlin, Bettina – qu’il a entendues sa longue vie durant. Quoi qu’il en soit, comme Hemingway se plaint des innombrables biographies plus ou moins fantasques qu’on lui consacre, Goethe lui répond: «C’est l’immortalité, que voulez-vous. L’immortalité est un éternel procès». Et Hemingway de renchérir: «L’homme peut mettre fin à sa vie. Mais il ne peut mettre fin à son immortalité. Une fois qu’elle vous a pris à bord, vous ne pouvez plus jamais redescendre, et même si vous vous brûlez la cervelle, comme moi, vous restez à bord avec votre suicide, et c’est l’horreur. J’étais mort, couché sur le pont, et autour de moi je voyais mes quatre épouses accroupies, écrivant tout ce qu’elles savaient de moi, et derrière elles était mon fils qui écrivait aussi, et Gertrude Stein était là et écrivait, et tous mes amis étaient là et racontaient tous les cancans, toutes les calomnies qu’ils avaient pu entendre à mon sujet, et dans toutes les universités d’Amérique une armée de professeurs classaient tout cela, l’analysaient, le développaient, fabriquant des milliers d’articles et des centaines de livres…» Des biographies et des cancans, et encore des cancans et des biographies… Mais qui s’intéresse encore aux livres du célèbre romancier américain?
Dans L’immortalité, Milan Kundera met en scène une rencontre entre Goethe et Hemingway, dialoguant sur les chemins de l’au-delà. Rien, mais absolument rien de commun entre Goethe et Hemingway, me direz-vous! Il faut croire que, dans l’au-delà, Goethe (comme chacun d’entre nous, je suppose) préfère deviser avec d’autres voix que celles – Herder, Höderlin, Bettina – qu’il a entendues sa longue vie durant. Quoi qu’il en soit, comme Hemingway se plaint des innombrables biographies plus ou moins fantasques qu’on lui consacre, Goethe lui répond: «C’est l’immortalité, que voulez-vous. L’immortalité est un éternel procès». Et Hemingway de renchérir: «L’homme peut mettre fin à sa vie. Mais il ne peut mettre fin à son immortalité. Une fois qu’elle vous a pris à bord, vous ne pouvez plus jamais redescendre, et même si vous vous brûlez la cervelle, comme moi, vous restez à bord avec votre suicide, et c’est l’horreur. J’étais mort, couché sur le pont, et autour de moi je voyais mes quatre épouses accroupies, écrivant tout ce qu’elles savaient de moi, et derrière elles était mon fils qui écrivait aussi, et Gertrude Stein était là et écrivait, et tous mes amis étaient là et racontaient tous les cancans, toutes les calomnies qu’ils avaient pu entendre à mon sujet, et dans toutes les universités d’Amérique une armée de professeurs classaient tout cela, l’analysaient, le développaient, fabriquant des milliers d’articles et des centaines de livres…» Des biographies et des cancans, et encore des cancans et des biographies… Mais qui s’intéresse encore aux livres du célèbre romancier américain?