Par Pierre Béguin
On aura tout entendu!
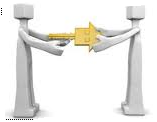 De la proposition la plus cyniquement stupide, celle de l’UDC qui veut rendre l’assurance maladie facultative, à la plus inutilement lancinante, celle des socialistes et leur incontournable caisse unique, en passant par la suppression des hautes franchises, l’interdiction de modifier une franchise pendant trois ans, l’établissement de réseaux de soins (qui aboutiraient inévitablement à un rationnement desdits soins et à une médecine à plusieurs vitesse), chacun y va de sa solution. La plupart du temps au seul bénéfice des compagnies d’assurance.
De la proposition la plus cyniquement stupide, celle de l’UDC qui veut rendre l’assurance maladie facultative, à la plus inutilement lancinante, celle des socialistes et leur incontournable caisse unique, en passant par la suppression des hautes franchises, l’interdiction de modifier une franchise pendant trois ans, l’établissement de réseaux de soins (qui aboutiraient inévitablement à un rationnement desdits soins et à une médecine à plusieurs vitesse), chacun y va de sa solution. La plupart du temps au seul bénéfice des compagnies d’assurance.
Le peuple, lui, reste sceptique. Il a raison. Il a mis au rancart les réseaux de soins. Seuls quelques illuminés soutiennent la proposition udécéiste, et moins de 40% des sondés penchent pour la solution socialiste. Dont on ne voit pas par quel tour de magie elle pourrait contribuer à régler le problème essentiel de l’assurance maladie: empêcher les primes de grimper (on voit très bien en revanche comment elle pourrait contribuer à les faire exploser). Les deux solutions tiennent d’ailleurs davantage du dogme que du pragmatisme (les socialistes, sous couvert de caisse unique, espèrent en réalité étatiser le système). Et c’est bien pour cette raison qu’elles ne séduisent pas. Les gens veulent des soins et des primes qui ne grèvent pas leur budget en peau de chagrin. On n’est pas sorti de l’auberge! Malgré toutes ces incantations lénifiantes, les primes vont continuer d’augmenter. Bientôt, la moitié de la population sera subventionnée. Totale schizophrénie d’un système qui prévoit une assurance sociale à but non lucratif gérée par des entreprises privées, avec actionnaires et dividendes, et qui confie l’offre (générant la demande) à des médecins dont on ne voit pas pourquoi l’éthique serait supérieure à celle d’un garagiste (il faut bien faire tourner la baraque, non!)
Oui, on aura tout entendu. Sauf (à ma connaissance du moins) une proposition pourtant évidente qui, certes, ne règlera pas à elle seule le problème, mais qui pourrait donner un cadre plus stable à la Lamal: unifier les fonds de réserve, confier leur gestion à la Confédération et lier leur répartition en fonction du nombre d’affiliés à chaque caisse maladie. Actuellement, la gestion des fonds de réserve reste floue, et au seul pouvoir des assurances. La polémique sur les réserves des caisses maladie dure pourtant depuis des années. Rien ne bouge. On n’ose imaginer ce qui se trame dans ce puits à milliards. Et on craint le scandale national qui pourrait éclater un jour...
Dans tous les cas, leur gestion est absurde. Il est facile de démontrer comment elle contribue à l’augmentation des primes. Logique: plus une caisse maladie comprend d’adhérents, plus elle augmente ses fonds de réserve. Illogique: en cas d’exode vers une autre caisse maladie, la première conserve ses fonds de réserve, la seconde se voit dans l’obligation de les augmenter et, donc, d’augmenter ses primes. De là à en conclure que la première aurait intérêt à des exodes successifs, aussi massifs que ponctuels... C’est du moins la question que je me posais lorsque Mme Ruth Dreifuss, par ailleurs femme intelligente, sage et respectable, expliquait l’augmentation des primes d’assurance maladie par l’immobilisme des assurés qui, selon elle, ne jouaient pas le jeu de la concurrence. Et d’encourager le peuple dans cette voie qui ne peut qu’aggraver le problème. Nous prenait-elle pour des idiots? A titre d’exemple, en 2010, Assura, le vent en poupe grâce à des primes compétitives, craignait un rush de nouveaux clients, estimant que son taux de réserve de 35% pourrait alors fondre à moins de 12% et entraîner d’importantes hausses de primes menaçant sa compétitivité.
Car, en plus des frais administratifs engendrés par tout changement d’assurance, les fonds de réserve ajoutent aux dépenses à chaque mouvement. J’ai payé des primes depuis trente ans à l’assurance X. Qu’on m’explique pourquoi la part de fond de réserve que mes primes ont accumulé ne me suit pas automatiquement en cas de changement de caisse! Allez donc! Cadeau à l’assurance! Pire. Formidable – et inadmissible – transfert de propriété qu’on peut sans autre assimiler au vol légalisé d’un bien qui devrait de facto appartenir aux citoyens assurés.
Dans certains cantons – c’est le cas à Genève – des assurances ont transféré le surplus des fonds de réserve dans d’autres cantons pour éviter des augmentations de primes. La solidarité, d’accord! Mais tout de même, faudrait voir à ne pas exagérer! Si les primes sont calculées au niveau cantonal, pourquoi les réserves le sont-elles au niveau national? Seul le parti radical genevois, avant de devenir libéral, avait déposé une résolution demandant au canton de Genève d’exiger la transmissibilité des réserves accumulées par un assuré lorsqu’il change de caisse maladie. On a même pensé à prendre des mesures d’urgence consistant à faire introduire par le législateur fédéral une disposition dans la Lamal prévoyant l’appartenance strictement cantonale des fonds de réserve et l’interdiction de tout transfert dans d’autres cantons (qu’est-il advenu de tout cela?) Mais d’unification des fonds de réserve, il n’en fut jamais fait mention. On n’en veut pas, tout simplement. La véritable question est de savoir pourquoi.
Non pas une caisse unique donc, mais un fond de réserve unique, propriété des assurés et géré par la Confédération. Si la disparité des caisses maladie, et la concurrence qui s’ensuit, reste un garde-fou à l’explosion des primes, la gestion des fonds de réserve doit leur être retirée de toute urgence. Qu’on commence par là! On verra ensuite quel autre pas il convient de faire.
A moins que, privées de la manne des fonds de réserve, les compagnies d’assurance ne tiennent plus vraiment aux caisses maladie, si coûteuses et peu rentables, paraît-il...
Tiens, j’y pense! Moi qui croyais encore que les compagnies tenaient mordicus à conserver les primes d’assurance maladie de base pour servir d’appel d’offre aux assurances complémentaires, j’en viens à me poser cette question: la gestion privée des fonds de réserve, absurde pour le citoyen mais si profitable aux caisses, ne serait-elle pas pour quelque chose dans cette volonté de conserver, par tous les relais politiques possibles, la main mise sur les assurances maladie? Un scandaleux transfert de propriété? Non!? No me digas...


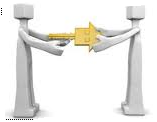 De la proposition la plus cyniquement stupide, celle de l’UDC qui veut rendre l’assurance maladie facultative, à la plus inutilement lancinante, celle des socialistes et leur incontournable caisse unique, en passant par la suppression des hautes franchises, l’interdiction de modifier une franchise pendant trois ans, l’établissement de réseaux de soins (qui aboutiraient inévitablement à un rationnement desdits soins et à une médecine à plusieurs vitesse), chacun y va de sa solution. La plupart du temps au seul bénéfice des compagnies d’assurance.
De la proposition la plus cyniquement stupide, celle de l’UDC qui veut rendre l’assurance maladie facultative, à la plus inutilement lancinante, celle des socialistes et leur incontournable caisse unique, en passant par la suppression des hautes franchises, l’interdiction de modifier une franchise pendant trois ans, l’établissement de réseaux de soins (qui aboutiraient inévitablement à un rationnement desdits soins et à une médecine à plusieurs vitesse), chacun y va de sa solution. La plupart du temps au seul bénéfice des compagnies d’assurance.
 David Foenkinos (avec qui j’aurai le plaisir de dialoguer samedi 8 à 15 heures dans la grande salle du Casino). Et parmi les auteurs indigènes, il faut relever l’impressionnante cohorte des jeunes loups talentueux, tels qu’Antonio Albanese, Joël Dicker (dont l'épatant dernier roman* fait partie de la première liste du Goncourt), Sabine Dormond, Anne-Sylvie Sprenger ou encore Quentin Mouron. Quelle fougue ! Il y a bien longtemps que la littérature romande n’avait été aussi vivace et prometteuse !
David Foenkinos (avec qui j’aurai le plaisir de dialoguer samedi 8 à 15 heures dans la grande salle du Casino). Et parmi les auteurs indigènes, il faut relever l’impressionnante cohorte des jeunes loups talentueux, tels qu’Antonio Albanese, Joël Dicker (dont l'épatant dernier roman* fait partie de la première liste du Goncourt), Sabine Dormond, Anne-Sylvie Sprenger ou encore Quentin Mouron. Quelle fougue ! Il y a bien longtemps que la littérature romande n’avait été aussi vivace et prometteuse ! Cette année, l’invité d’honneur est la Wallonie-Bruxelles, qui enverra quelques-uns de ses meilleurs écrivains (dont Patrick Roegiers). Et la présidente d’honneur sera Nancy Huston, Canadienne installée à Paris, dont le dernier livre, Reflets dans un œil d’homme*,
Cette année, l’invité d’honneur est la Wallonie-Bruxelles, qui enverra quelques-uns de ses meilleurs écrivains (dont Patrick Roegiers). Et la présidente d’honneur sera Nancy Huston, Canadienne installée à Paris, dont le dernier livre, Reflets dans un œil d’homme*,