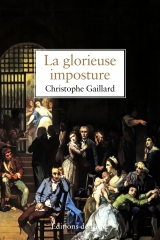Par Pierre Béguin
Dans la griserie de son libre vol – nous dit Emmanuel Kant –, la colombe fend l’air en même temps qu’elle en sent la résistance. Elle en déduit fort logiquement qu’avec un peu moins de résistance de l’air, elle volerait plus vite, et mieux encore. Poussant son raisonnement jusqu’au bout de sa logique, elle en conclut naturellement que, dans le vide, son vol serait parfait*.
Ce paradoxe guette tous les esprits systémiques, et ils sont nombreux à y succomber. L’oeuvre d’André Gide, par exemple, rend compte de ce mécanisme qui voit, immanquablement, toute personne pousser la logique de son système toujours plus loin, jusqu’au point où, sans s’en rendre compte, cette dernière se met à agir à l’encontre des valeurs même qu’elle prétend défendre. Ainsi de Michel dans L’Immoraliste, du pasteur de La Symphonie pastorale, ou de Lafcadio, qui enclenche à son insu un gigantesque réseau de causalités déterminantes en voulant expérimenter, par un meurtre, la théorie de l’acte gratuit (Les Caves du Vatican).
Dans les années 80, le néo libéralisme, aveuglé par sa foi stupide dans la capacité d’autorégulation des marchés financiers, a poussé toujours plus loin la logique de la déréglementation, justifiant tout objectif non atteint par la survivance de nombreuses règles soi-disant obsolètes, et pensant logiquement que seule la suppression de toutes les réglementations permettrait au marché d’atteindre son plein rendement et son parfait équilibre. On connaît la suite…
Aujourd’hui, le dogme du tout à l’électrique offre un bel exemple de ce mécanisme: sous prétexte de neutralité carbone et de bonne conscience, on est simplement en train de créer une nouvelle forme de «colonialisme écologique» (je gage que, dans quelques années, l’expression va faire son chemin) contre lequel très peu de voix s’élèvent. Pire encore: on lui ajoute un système d’indulgences qu’on croyait révolu depuis la Réforme. Les délires actuels sont riches en exemples du même ordre, pour ceux qui savent les interroger...
A Genève, comme on pouvait s’y attendre, le DIP, qui n’en rate décidément pas une, succombe une fois de plus au paradoxe de la colombe. Le projet visant à supprimer les regroupements par niveau au Cycle d’orientation relève de cette même tendance absurde à pousser encore plus loin, avec une foi de charbonnier, une logique qui s’est montrée jusque là inefficace à remplir les objectifs qu’on lui avait assignés. D’une structure à quatre sections, latine, scientifique, générale, pratique, – instituée à l’origine du Cycle par le chantre de la démocratisation des études, André Chavanne –, (et dont le coulissement d’une section à l’autre se faisait alors presque systématiquement vers le bas, de latine en générale, par exemple), nous voici donc arrivés, à coups de réformes successives consistant à éroder toujours plus la rigueur des sections, et toujours sous l’éternel motif que le système en cours ne fait que renforcer les inégalités, à un système de quasi mixité. «Quasi», car on conserve tout de même, comme si on ne pouvait pas se résoudre à supprimer toutes traces du système originel (preuve qu’on y croit encore, malgré tout), des cours à niveaux dans les deux disciplines qui, justement, posent le plus de problèmes, le français et les mathématiques.
Pas besoin d’être Jérémie ou Cassandre pour prédire que, dans une décennie, la nouvelle conseillère d’État (socialiste) en charge du DIP parviendra, avec cette réformette, énième réplique des précédentes, au même constat que Mme Torracinta: ces nouvelles mesures se révèlent non seulement inefficaces à gommer les inégalités, mais elles les renforcent (ce qu’on ne dira pas, en revanche, c’est que la situation s’est encore détériorée entre temps). Il lui restera alors à aller, cette fois, jusqu’au fin bout de la logique et à éradiquer les derniers vestiges d’hétérogénéité que sa collègue d’aujourd’hui n’a pas osé supprimés. Pour s’apercevoir, inévitablement, une dizaine d’années plus tard (nous serons alors dans les années 2040, et moi je serai mort), que l’instauration de la mixité totale dans les classes a complètement échoué à satisfaire les objectifs de lutte contre les inégalités scolaires. On décrétera alors la mort clinique du Cycle d’Orientation, prétextant qu’après plus de 80 ans d’existence, il a fait son temps. Et l’on donnera naissance à une autre structure «miraculeuse», investie des mêmes missions délirantes et soumise au même destin. C’est écrit, comme chante l’autre, et je m’étonne qu’il se trouve des gens sérieux pour croire que ce genre de réformes puissent aboutir à un autre scénario (le croient-ils vraiment?).
Mais on ne dira pas que cette lutte entêtée contre toute forme d’hétérogénéité, non seulement a été échec, mais a aussi détruit le système. D’autant plus que le seul argument – ou l’unique profession de foi – du DIP se limite à brandir le sempiternel postulat idiot, attesté bien entendu par des études dites «scientifiques», que les deux ou trois têtes pensantes de la classe vont naturellement tirer tous les autres vers le haut, comme si un bon élève, par la seule puissance de son comportement et de ses bons résultats, pouvait réussir là où les enseignants et le département ont échoué. Ça se passe peut-être ainsi chez les Bisounours ou dans le merveilleux microcosme de la recherche pédagogique, mais pas dans le monde réel. Quiconque possède un brin d’expérience, ou même un peu de bon sens, sait que, le plus souvent, c’est exactement le contraire qui se produit. Mais «c’est le sort ordinaire de la raison humaine, dans la spéculation, de construire son édifice en toute hâte, et de ne songer que plus tard à s’assurer si les fondements sont solides» (E. Kant).
Eh oui! On ne se refait pas: être socialiste, c’est croire, même dans la soixantaine, en dépit de l’expérience, que la réalité va se plier avec complaisance aux idéologies, parfois stupides, qu’on veut lui imposer contre nature; par exemple, croire qu’un système scolaire peut gommer toutes les inégalités. Et dans quel but, d’ailleurs, si ce n’est pour satisfaire à la sotte idéologie de l’égalitarisme?
Ce que je constate, entre mai 2020 et mai 2021, c’est que les changements instaurés par le DIP vont tous dans le sens d’une détérioration des conditions d’étude pour les élèves les plus motivés. L’année dernière au collège, c’était, entre autres, la suppression du choix latin – grec, qui entraînera, dans les prochaines années, la mort annoncée du grec au collège, et celle, un peu plus tard, du latin. En couple, ils pouvaient encore espérer résister. Séparés, ils n’ont plus aucune chance. Pour le plus grand plaisir de la gauche qui ne voit, dans le choix latin – grec, que le seul privilège d’une caste favorisée. De même, les classes mixtes systématisées se feront aux dépens des élèves – et il y en a, croyez-moi – qui demandent légitimement des conditions d’enseignement à la hauteur de l’investissement qu’ils sont prêts à accorder à leurs études. Des conditions qu’ils ne trouveront pas dans une classe où les trois quarts de l’effectif ne sont guère motivés. De quoi décourager ceux-là même dont on attend qu’ils motivent les autres!
Faute de pouvoir élever la base, on se contente donc de couper les têtes qui ont l’ignoble prétention de s’élever au-dessus de la moyenne. Tout au plus, leur accorde-t-on, dans la nouvelle réforme, la possibilité d’effectuer le cursus du CO en deux ans au lieu de trois, preuve indiscutable, par ailleurs, que le DIP reconnaît, dans le même temps, que cette réforme pourrait placer les bons élèves dans une galère qu’il serait malsain de prolonger inutilement. Mais alors comment prétendre que les plus motivés vont tirer les autres vers le haut, tout en leur donnant la possibilité d’abréger leur cursus? Quelqu’un pourrait-il m’expliquer la logique?
Ce qui manque peut-être le plus à notre époque délirante, et au DIP par la même occasion, c’est un peu de bon sens, de pragmatisme, et de temps de réflexion s’exerçant loin des systèmes, des dogmes dangereux ou des croyances stupides qui façonnent l’opinion publique, à grands coups de propagandes, de peurs et de culpabilités.
J’ai toujours détesté les systèmes, les dogmes, les clans, et les personnes à l’esprit systémique, dogmatique ou clanique (on dirait maintenant «communautariste»). Quand ce ne sont pas des opportunistes ou des Tartuffes, ce sont, le plus souvent, des faibles qui s’accrochent à leur système comme un estropié à sa béquille. Et une pensée prête-à-porter est tellement plus confortable!
Bien entendu, les peurs et les culpabilités avec lesquelles on matraque les populations ont pour effet de les affaiblir et de les rendre perméables aux croyances imbéciles et à l’esprit de système. Et ça marche! Oui, même si ce n’est pas sous la forme qu’on imaginait, le XXIe siècle sera bel et bien religieux. En tout cas, il en prend le chemin, hélas!
Pendant ce temps, au milieu de tous ces délires, La Critique de la raison pure repose dans quelque bibliothèque poussiéreuse où tant de vérités oubliées demeurent. Allons! Ouvrons le texte un instant à la page 36:
«Entraîné par cette preuve de la puissance de la raison, notre penchant à étendre nos connaissances ne voit plus de bornes. La colombe légère qui, dans son libre vol, fend l’air dont elle sent la résistance, pourrait s’imaginer qu’elle volerait bien mieux encore dans le vide. C’est ainsi que Platon, quittant le monde sensible, qui renferme l’intelligence dans de si étroites limites, se hasarda, sur les ailes des idées, dans les espaces vides de l’entendement pur. Il ne s’apercevait pas que, malgré tous ses efforts, il ne faisait aucun chemin parce qu’il n’avait pas de point d’appui, de support sur lequel il pût faire fonds et appliquer ses forces pour changer l’entendement de place. C’est le sort ordinaire de la raison humaine, dans la spéculation, de construire son édifice en toute hâte, et de ne songer que plus tard à s’assurer si les fondements sont solides.»
*Kant E., 1781, Critique de la raison pure, trad. A. Tremesaygues et B. Pacaud, PUF, Paris, 1980 (9e éd.), Introduction, p. 36.
 Metin Arditi publie chez BSN, maison d'édition émergente et très intéressante, un recueil de trois nouvelles, destinées au théâtre ou à la radio. On retrouve les thèmes chers à cet écrivain prolifique qui convoque, ici, dans Freud, les démons*, ses fantômes familiers.
Metin Arditi publie chez BSN, maison d'édition émergente et très intéressante, un recueil de trois nouvelles, destinées au théâtre ou à la radio. On retrouve les thèmes chers à cet écrivain prolifique qui convoque, ici, dans Freud, les démons*, ses fantômes familiers. 
 Le désir est présent, bien sûr, mais contrarié, mutilé, dans la deuxième nouvelle du recueil qui raconte le déclin d'un maestro, le grand chef d'orchestre Grégoire Karakoff qui, peu à peu, perd la mémoire et s'égare dans ses partitions. Dans cette nouvelle, Arditi, qui a bien connu le milieu musical, est très à l'aise pour décrire les avanies de l'âge (perte de mémoire, impuissance) et développe certains thèmes qu'il a traités dans d'autres livres. Son maestro est saisissant de vérité et touchant de sincérité.
Le désir est présent, bien sûr, mais contrarié, mutilé, dans la deuxième nouvelle du recueil qui raconte le déclin d'un maestro, le grand chef d'orchestre Grégoire Karakoff qui, peu à peu, perd la mémoire et s'égare dans ses partitions. Dans cette nouvelle, Arditi, qui a bien connu le milieu musical, est très à l'aise pour décrire les avanies de l'âge (perte de mémoire, impuissance) et développe certains thèmes qu'il a traités dans d'autres livres. Son maestro est saisissant de vérité et touchant de sincérité.