 Participant, en 2013, à la première édition de Parrains-Poulains (où elle était associée à Amélie Plume, à gauche sur la photo), Anne-Frédérique Rochat (née en 1977 à Vevey) n’en est pas à son coup d’essai. Comédienne de formation, elle a écrit près d’une dizaine de pièces de théâtre dont la plupart ont été jouées sur les scènes romandes. Parallèlement à l’écriture scénique, Anne-Frédérique Rochat construit, livre après livre, sa maison romanesque.
Participant, en 2013, à la première édition de Parrains-Poulains (où elle était associée à Amélie Plume, à gauche sur la photo), Anne-Frédérique Rochat (née en 1977 à Vevey) n’en est pas à son coup d’essai. Comédienne de formation, elle a écrit près d’une dizaine de pièces de théâtre dont la plupart ont été jouées sur les scènes romandes. Parallèlement à l’écriture scénique, Anne-Frédérique Rochat construit, livre après livre, sa maison romanesque.
Son premier livre, en 2012, Accident de personne*, invitait le lecteur à découvrir un univers parfaitement singulier, entre rêve et réalité, tout à la fois ancré dans les réalités matérielles et dérivant, à la moindre occasion, vers les contrées sauvages de l’imaginaire. Car les personnages d’Anne-Frédérique Rochat sont tous hantés par un rêve douloureux, le plus souvent ignoré d’eux-mêmes, qui prend la forme d’un souvenir d’enfance ou d’un secret de famille.
Ainsi, dans ce premier roman, l’histoire de Charline, qui perd le goût d’aimer, de vivre et de créer  (elle est peintre) et croit le retrouver en s’immisçant dans la famille de Viviane, une camarade de classe qui vient de mourir. Ce qu’elle va découvrir, en entrant dans cette nouvelle famille, c’est un souvenir oublié (ou refoulé) : lorsqu'elle était enfant, Charline a perdu sa sœur jumelle, qui s'est jetée du balcon de la maison familiale en croyant qu'elle pourrait s'envoler.
(elle est peintre) et croit le retrouver en s’immisçant dans la famille de Viviane, une camarade de classe qui vient de mourir. Ce qu’elle va découvrir, en entrant dans cette nouvelle famille, c’est un souvenir oublié (ou refoulé) : lorsqu'elle était enfant, Charline a perdu sa sœur jumelle, qui s'est jetée du balcon de la maison familiale en croyant qu'elle pourrait s'envoler.
 Le deuxième roman d’Anne-Frédérique Rochat, Le sous-bois**, est encore une histoire de famille — non anormale, mais atypique. Le père et la mère ne songent qu’à s’envoyer en l’air, tandis que la fille aînée, quarante ans et vivant toujours avec eux, semble tenir le gouvernail de la famille d’une main de fer. C’est elle qui va mener son petit monde en vacance dans une maison perdue au milieu de la forêt. Et là, bien sûr, dans ce nouveau décor, à la fois naturel et fantastique, l’abcès familial va crever…
Le deuxième roman d’Anne-Frédérique Rochat, Le sous-bois**, est encore une histoire de famille — non anormale, mais atypique. Le père et la mère ne songent qu’à s’envoyer en l’air, tandis que la fille aînée, quarante ans et vivant toujours avec eux, semble tenir le gouvernail de la famille d’une main de fer. C’est elle qui va mener son petit monde en vacance dans une maison perdue au milieu de la forêt. Et là, bien sûr, dans ce nouveau décor, à la fois naturel et fantastique, l’abcès familial va crever…
Le dernier roman d’Anne-Frédérique Rochat, À l’abri des regards (2014)***, repose lui aussi sur un secret de famille, mais abordé, ici, par quatre voix différentes, car il s’agit d’un roman polyphonique.
Le premier personnage à prendre la parole, c’est Anäis, mère de deux petites filles, qui décide de quitter, provisoirement, sa famille, parce qu’elle n’en peut plus de « faire semblant », de jouer un rôle, ou même plusieurs rôles (mère, épouse, fille) qui ne lui conviennent plus. Elle est mal dans sa peau et souffre de troubles alimentaires : « j’essaie de me convaincre que ce n’est pas la mer à boire de mettre ces aliments dans ma bouche et de les avaler. » Brusquement étrangère à elle-même, elle regarde son mari et ses deux filles comme des extraterrestres, projetant sur elles ses pensées les plus sombres et les plus intimes : « tu es un gouffre, un puits sans fond, une mer noire, un ventre vide qui aspire et qui engloutit. » Cette crise, Anaïs devra la surmonter en prenant ses distances d’avec les siens, pour mieux respirer, et tenter de comprendre ce qui lui noue la gorge.
C’est sa petite fille, Maëlis, sept ans, qui prend ensuite la parole. La cellule familiale est passée au scanner de son regard aigu. Des détails apparaissent, des images, des obsessions enfantines.  On perd un peu le fil, non d’Ariane, mais d’Anaïs. Pourquoi cette crise ? Ce mal de mère ? Le secret, évoqué en fin de chapitre, n’est pas encore dévoilé. Il surgit lors d’une conversation entre les grands-parents.
On perd un peu le fil, non d’Ariane, mais d’Anaïs. Pourquoi cette crise ? Ce mal de mère ? Le secret, évoqué en fin de chapitre, n’est pas encore dévoilé. Il surgit lors d’une conversation entre les grands-parents.
« On devrait lui dire la vérité au sujet de sa mère. »
Ainsi lâchée, cette phrase apparaît comme une bombe à retardement dont Maëlis est la dépositaire involontaire et qu’elle va transporter, avec angoisse, jusqu’à l’explosion du secret.
Dans la troisième partie, c’est Basile, un veuf sexagénaire ne se consolant pas de la mort de sa femme, qui prend la parole. Il partage son appartement avec Anaïs qu’il a recueillie comme un oiseau blessé. Taxidermiste de formation, il aime à s’enfermer dans son atelier pour embaumer ses animaux. C’est ainsi, également, par une jolie métaphore, qu’il va « redonner vie » à sa colocataire. Il lui prépare de bons plats, lui rend le goût de vivre et de manger. « Je suis un peu son sauveur, écrit-il. Une sorte de prince charmant. Il est temps qu’elle se réveille de son sommeil, la belle au bois dormant. » Ces deux « naufragés de la vie » vont insensiblement se rapprocher — un peu, beaucoup, mais sans se brûler les ailes à la flamme d’un amour impossible.
On change de style et de ton, encore une fois, dans la quatrième partie du roman en découvrant les lettres que la mère d’Anaïs lui a écrites, en 1979, quelques semaines après sa naissance.
« Je ne suis pas un monstre, juste une femme fragile, à un moment donné, dépassé par la vie et ses responsabilités. »
En même temps qu’elle apprend que sa mère est vivante (on lui avait toujours dit le contraire), Anaïs apprend que cette mère l’a abandonnée. Pas tout à fait, pourtant, car elle lui écrit encore, de temps en temps, des lettres qui tentent de garder le contact, mais qu’elle n’ose pas lui envoyer.
« S’il te plaît, donne-moi de tes nouvelles. J’ai besoin de savoir ce que tu penses de moi. Si tu m’aimes un peu. Si tu m’as pardonné. »
Le secret de famille, entretenu par la coalition des proches, c’est le mal de mère, thème filé tout au long du roman. Dès la naissance, la mère manque, ou disparaît, laissant une blessure inguérissable : Gilda, abandonne sa fille pour poursuivre ses rêves de comédienne et lui transmet, comme un fardeau maudit, ce mal-être vital, encrypté dans son inconscient.
Les lettres de Gilda, tantôt émouvantes et tantôt pathétiques, essaient de renouer des liens avec sa fille abandonnée. Elles sont écrites sur le ton de la confidence et de la complicité, mais elles sonnent faux, car elles sont adressées à une fille imaginaire, non de chair et de sang, une fille dont la vie a été empoisonnée par l’abandon et le mensonge.
En fin de compte (et de conte), la vérité est révélée, c’est-à-dire rétablie, le secret dévoilé, tout semble rentrer dans l’ordre.
Moment de la catharsis : la vérité agit comme une délivrance, un pas de plus vers la liberté : pour Anaïs, c’est une seconde naissance.
Mais la lumière (et la violence) de cette révélation n’a laissé personne indemne.
* Anne-Frédérique Rochat, Accident de personne, roman, éditions Luce Wilquin, 2012.
** Le sous-bois, roman, éditions Luce Wilquin, 2013.
*** À l’abri des regards, roman, éditions Luce Wilquin, 2014.
 Antoinette Rychner n'a pas choisi la facilité avec le personnage principal de son roman Le Prix. C'est un sculpteur dont on suit le monologue intérieur. Sa grande ambition est de recevoir un prix qu'on comprend être prestigieux, et toute son existence, toute son activité tournent autour de cette marque de reconnaissance. Mais ce qui pourrait sembler une histoire réaliste et cruelle devient, grâce à la fantaisie et à l'écriture d'Antoinette Rychner, une fable drolatique. Et faute de se sentir proche du personnage principal, on finit par se moquer de lui comme on se moquerait de nous-même...
Antoinette Rychner n'a pas choisi la facilité avec le personnage principal de son roman Le Prix. C'est un sculpteur dont on suit le monologue intérieur. Sa grande ambition est de recevoir un prix qu'on comprend être prestigieux, et toute son existence, toute son activité tournent autour de cette marque de reconnaissance. Mais ce qui pourrait sembler une histoire réaliste et cruelle devient, grâce à la fantaisie et à l'écriture d'Antoinette Rychner, une fable drolatique. Et faute de se sentir proche du personnage principal, on finit par se moquer de lui comme on se moquerait de nous-même... narcissisme, les questionnements sur sa propre valeur, le sentiment d'injustice parce que quelqu'un dont on n'estime pas le travail a obtenu une récompense que nous pensions mériter, tout ça fait partie de la vie artistique. De même, l'égocentrisme du personnage est fondé sur quelque chose de noble, la volonté de créer une œuvre qui chante, qui soit une réussite, et son combat pour trouver le temps de créer est celui de beaucoup de gens.
narcissisme, les questionnements sur sa propre valeur, le sentiment d'injustice parce que quelqu'un dont on n'estime pas le travail a obtenu une récompense que nous pensions mériter, tout ça fait partie de la vie artistique. De même, l'égocentrisme du personnage est fondé sur quelque chose de noble, la volonté de créer une œuvre qui chante, qui soit une réussite, et son combat pour trouver le temps de créer est celui de beaucoup de gens.










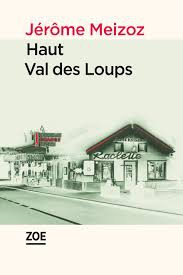 Il y a un drame à la base du livre de Jérôme Meizoz, Haut Val des loups, un drame hautement politique et très symptomatique.
Il y a un drame à la base du livre de Jérôme Meizoz, Haut Val des loups, un drame hautement politique et très symptomatique. ... D'autres rappels tentent une explication. L'accueil en Valais des fascistes traqués après la deuxième guerre mondiale... La prédominance longtemps absolue d'un PDC pas à gauche du tout...
... D'autres rappels tentent une explication. L'accueil en Valais des fascistes traqués après la deuxième guerre mondiale... La prédominance longtemps absolue d'un PDC pas à gauche du tout...