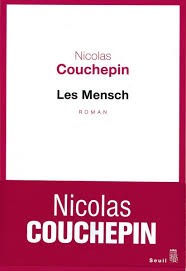Emmanuel Carrère versus Édouard Limonov
 Parmi les écrivains français contemporains, Emmanuel Carrère est sans conteste l'un des plus importants. Chacun de ses livres est un étonnement. Qu'il trace le portrait de Jean-Claude Romand, serial killer et imposteur de nos contrées, dans L'Adversaire*, ou qu'il nous promène de France et en ex-URSS, dans Un roman russe**, sur les traces de son grand-père mystérieusement disparu pendant la guerre (parce que collabo), Carrère a le chic pour embarquer le lecteur dans un voyage qui le ne laisse jamais indemne. Ni l'écrivain, ni le lecteur, d'ailleurs. Écrire, pour Carrère, c'est mener une enquête sans compromis à la fois sur les autres et sur soi. C'est rechercher une vérité inavouable. Et affronter, au cours de l'instruction, tous les démons qu'on porte dans son âme (un mot très russe et carrérien).
Parmi les écrivains français contemporains, Emmanuel Carrère est sans conteste l'un des plus importants. Chacun de ses livres est un étonnement. Qu'il trace le portrait de Jean-Claude Romand, serial killer et imposteur de nos contrées, dans L'Adversaire*, ou qu'il nous promène de France et en ex-URSS, dans Un roman russe**, sur les traces de son grand-père mystérieusement disparu pendant la guerre (parce que collabo), Carrère a le chic pour embarquer le lecteur dans un voyage qui le ne laisse jamais indemne. Ni l'écrivain, ni le lecteur, d'ailleurs. Écrire, pour Carrère, c'est mener une enquête sans compromis à la fois sur les autres et sur soi. C'est rechercher une vérité inavouable. Et affronter, au cours de l'instruction, tous les démons qu'on porte dans son âme (un mot très russe et carrérien).
C'est le cas de Limonov***, le dernier livre d'Emmanuel Carrère, Prix Renaudod 2011. Le projet de départ est simple, mais ambitieux : dessiner la figure d'un poète russe, fils d'un agent de renseignement, devenu clochard, puis majordome d'un milliardaire à New York,  coqueluche littéraire à paris, mercenaire dans les Balkans, opposant à Poutine, prisonnier, pendant quatre ans, d'un camp de redressement, etc. Ce poète s'appelle Édouard Limonov****. Il est né en 1943. Dans son pays, c'est un star. Il pourrait être le grand frère d'Emmanuel carrère.
coqueluche littéraire à paris, mercenaire dans les Balkans, opposant à Poutine, prisonnier, pendant quatre ans, d'un camp de redressement, etc. Ce poète s'appelle Édouard Limonov****. Il est né en 1943. Dans son pays, c'est un star. Il pourrait être le grand frère d'Emmanuel carrère.
Car c'est bien de fraternité qu'il s'agit ici. Comme dans L'Adversaire, mais en plus réussi encore, Carrère dresse le portrait d'un monstre qui le fascine. Ici un poète génial et débauché ; là, un homme qui a tué femme et enfants pour ne pas (s')avouer la vérité. Limonov est un personnage de roman. Sa vie aventureuse se prête à tous les types de récits : l'épopée, la tragédie, la comédie, la fable burlesque. Et Carrère joue de toutes les ficelles, sur tous les registres, aidé en cela par les écrits autobiographiques de Limonov qui a tenu la chronique scrupuleuse de ses excès et de ses égarements.
 Suivant son modèle pas à pas (Carrère a lu tous les livres de Limonov et passé beaucoup de temps à parler avec lui), l'auteur retrace sa vie de l'intérieur. Une vie en miroir, qui reflète la sienne et l'éclaire d'une lumière crue. Carrère aussi s'est rêvé voyou et poète génial, mais, fils de bonne famille (sa mère, Hélène Carrère-d'Encausse, est secrétaire de l'Académis française), il a été élevé dans le caviar et la soie, a suivi des études classiques et n'est jamais allé faire le coup de poing en Serbie ou en Tchétchénie.
Suivant son modèle pas à pas (Carrère a lu tous les livres de Limonov et passé beaucoup de temps à parler avec lui), l'auteur retrace sa vie de l'intérieur. Une vie en miroir, qui reflète la sienne et l'éclaire d'une lumière crue. Carrère aussi s'est rêvé voyou et poète génial, mais, fils de bonne famille (sa mère, Hélène Carrère-d'Encausse, est secrétaire de l'Académis française), il a été élevé dans le caviar et la soie, a suivi des études classiques et n'est jamais allé faire le coup de poing en Serbie ou en Tchétchénie.
La grande force de Carrère, c'est cette tension, jamais abolie, entre le sujet et l'objet. La vie qu'il raconte n'est pas la sienne (pour reprendre le titre d'un de ses livres) ; et pourtant, combien d'échos, de références, de passerelles entre la vie de Limonov et celle de Carrère, qui s'est rêvé agitateur d'idées et sans doute terroriste !
C'est un grand livre que ce Limonov, empathique, violent, profond, drôle, romanesque à souhait (on pense à Alexandre Dumas), plein de rebondissements et de fausses pistes. L'histoire d'un homme qui rêve de révolution et de littérature et essaie de mener de front ces deux combats. Un voyou perdu dans l'immense bordel de l'après-communisme en Russie, et suivi comme son ombre par l'inspecteur Carrère, qui relève les preuves et les indices.
Le plus curieux et le plus fascinant : cette histoire, qui est celle d'un homme seul — marginal, desperado au grand cœur, poète maudit — est aussi notre histoire. Elle raconte Limonov, la Russie et le chaos moderne, la Roumanie et la guerre des Balkans. En un mot, c'est notre histoire à tous depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Un livre à ne pas manquer !
* Emmanuel Carrère, L'Adversaire, P.O.L. et Folio, 2000.
** Emmanuel Carrère, Un roman russe, P.O.L., 2007.
*** Emmanuel Carrère, Limonov, P.O.L. et Folio, 2011.
**** Édouard Limonov a écrit une trentaine de livres, dont la plupart sont traduits en français. Je recommande Le poète russe préfère les grands nègres (Ramsay, 1980), Journal d'un raté (Albin Michel 1982) ; Oscar et les femmes (Ramsay, 1985) ; La Sentinelle assassinée (L'Âge d'Homme, 1995).